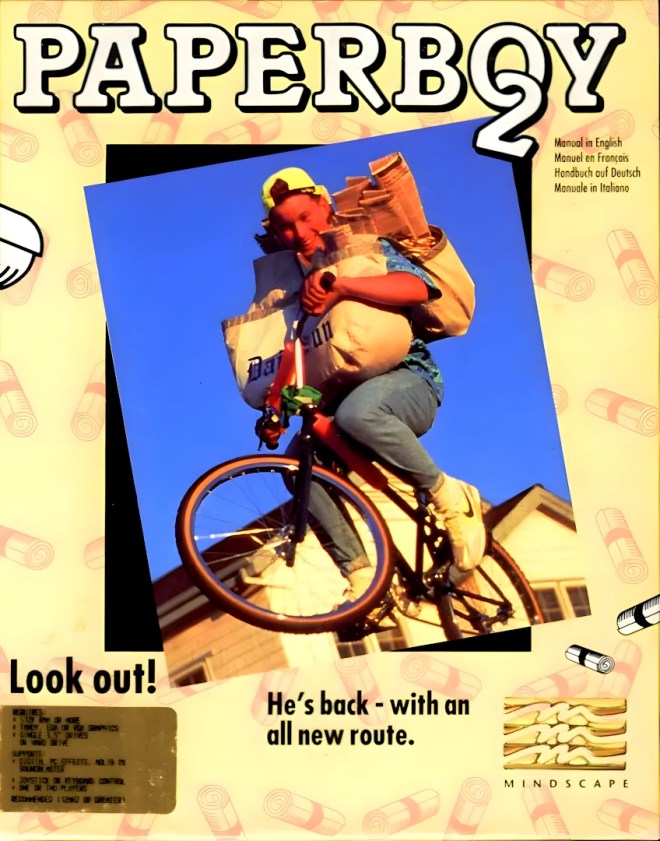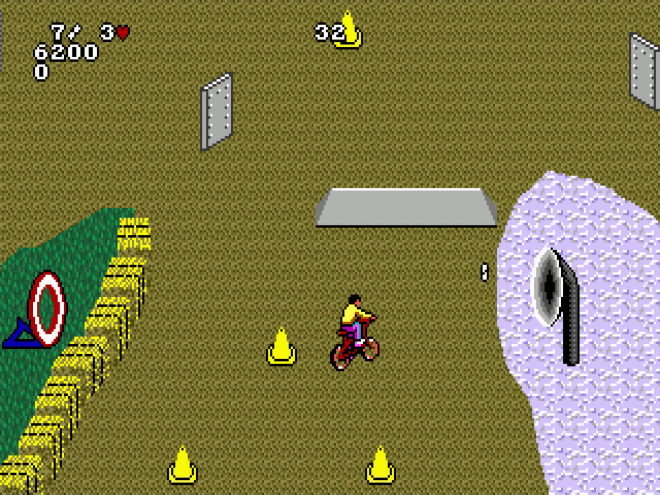Développeurs : Alexei Pajitnov et Vadim Gerasimov
Éditeur : AcademySoft
Testé sur : PC (DOS)
Également testés :
- Tetris : The Soviet Challenge (Spectrum Holobyte) (PC (DOS), Amiga, Apple II, Apple IIgs, Macintosh, Atari ST)
- Tetris (Mirrosoft) (Amiga, Amstrad CPC, Amstrad PCW, Atari ST, BBC Micro, Commodore 64, Electron, ZX Spectrum)
- Tetris (Atari Games Corporation) (Arcade, NES)
- Tetris (Bullet-Proof Software) (PC-88, Famicom, FM-7, MSX, PC-98, Sharp X1, Sharp X68000)
- Tetris : The Soviet Challenge (Tandy Corporation) (TRS-80 CoCo)
- Tetris (SEGA Enterprises) (Arcade, Mega Drive, Arcade (Mega-tech))
- Tetris (Nintendo) (Game Boy, NES)
- Tetris (Philips P.O.V. Entertainment Group) (CD-i)
- Tetris Classic (PC (DOS/Windows 3.x))
- Tetris & Dr. Mario (Super Nintendo)
- Superlite 1500 Series : The Tetris (PlayStation)
La série Tetris (jusqu’à 2000) :
- Tetris (1984)
- Welltris (1989)
- Faces… tris III (1990)
- Tetris 2 + Bombliss (1991)
- Super Tetris (1992)
- Tetris 2 (1993)
- Tetris Battle Gaiden (1993)
- Super Tetris 3 (1994)
- Tetris Blast (1995)
- V-Tetris (1995)
- 3-D Tetris (1996)
- Tetris Attack (1996)
- Tetris Plus (1996)
- Tetris S (1996)
- Tetrisphere (1997)
- Tetris : The Grand Master (1998)
- Tetris DX (1998)
- Tetris 64 (1998)
- Magical Tetris Challenge (1998)
- Tetris 4D (1998)
- Sega Tetris (1999)
- The Next Tetris (1999)
- The New Tetris (1999)
- Kids Tetris (1999)
- Tetris with Carcaptor Sakura : Eternal Heart (2000)
- Tetris the Absolute : The Grand Master 2 (2000)
Version PC (DOS)
| Date de sortie : 1986 |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Anglais |
| Support : Dématérialisé |
| Contrôleur : Clavier |
| Version testée : Version shareware émulée sous DOSBox |
| Configuration minimale : Processeur : Intel 8088/8086 Modes graphiques supportés : Mode texte (40×25 ; 80×25) |
L’histoire vidéoludique a quand même un fameux sens de l’humour.
Tetris est peut-être, de nos jours, le logiciel le plus célèbre du monde. En quelques années à peine, il est devenu une sorte d’icône du jeu vidéo, un symbole récurrent, une citation obligée, au-delà même de monuments ayant rejoint les rives convoitées de la culture populaire, tels Pac-Man, Super Mario Bros. ou Zelda.

Même quelqu’un n’ayant absolument aucune curiosité vis-à-vis du medium vidéoludique connait le nom de Tetris – il y a même de fortes chances qu’il en connaisse le principe. Et l’Histoire aura donc voulu que cette légende intemporelle continuant aujourd’hui encore à égrainer régulièrement les épisodes comme des perles sans avoir altéré en rien son principe d’origine – et à peine sa jouabilité – ne soit pas la création d’un développeur génial à la Shigeru Miyamoto, à la Richard Garriott ou à la Peter Molyneux, ni même celle d’un studio de développement mythique façon Bitmap Brothers ou Rare, mais bien le fruit de l’imagination d’un chercheur soviétique de l’Académie des sciences de l’U.R.S.S. dont la mission n’était même pas de programmer des jeux vidéo. Entre ici, donc, Alekseï Pajitnov (parfois orthographié Alexei Pazhitnov, question de retranscription), l’homme qui aura conçu un programme si addictif qu’il en aura fait chuter la productivité de ses collègues, puis celle de tous les chercheurs de Moscou, puis celle d’une partie de l’Europe de l’Est, avant de se répandre comme une trainée de poudre sur toute la planète. Pas mal, pour un début.

Est-il encore franchement nécessaire d’expliquer le principe de Tetris ? Inspiré du Pentomino, puzzle consistant à réaliser des formes géométriques via l’assemblage de dominos constitués de cinq carrés de taille égale accolés les uns aux autres, soit douze combinaisons possibles au final, Pajitnov l’aura simplifié en partant de forme plus réduites, constituées pour leur part de seulement quatre blocs, prenant ainsi fort logiquement le nom de « tetramino ».

L’idée, inspirée du tennis (d’où le nom du jeu, contraction des deux termes), n’est pas ici de réaliser des formes géométriques mais simplement des lignes via les sept formes possibles de tetraminos (devenu depuis « tétriminos » dans les guides officiels) dans un espace donné. Les pièces tombant de plus en plus vite, obligeant le joueur à réagir sous peine d’être débordé par l’accumulation des tétriminos, une partie ne s’achève que par la défaite – l’objectif n’est donc que le score. Le principe est assimilable par n’importe qui en une poignée de secondes, et c’est ce qui fait sa force. Et le mieux ? C’est qu’il continue d’être amusant au bout de plusieurs heures. Je ne sais même pas pourquoi je me fatigue à vous expliquer tout cela : vous y avez déjà joué. Tout le monde y a déjà joué. Littéralement.

Il est quand même fascinant de penser que ce phénomène planétaire dont le succès ne s’est simplement jamais tari n’était originellement qu’un programme coincé sur une massive unité centrale soviétique (un « mainframe », comme disent les anglosaxons), un Elektronika 60 qui était déjà une machine rare à l’époque. Porté par son succès dans les bureaux de l’Académie des sciences, le jeu aura rapidement commencé à circuler dans tous les services équipés pour l’accueillir, poussant parfois des chercheurs devenus littéralement accros à cesser de travailler pour s’y plonger.

Vladimir Pokhilko, ami de Pajitnov, ira même jusqu’à faire supprimer le programme de l’institut médical de Moscou pour combattre son addiction et rétablir la productivité. Encouragé par cet emballement ciblé, Pajitnov décide alors d’adapter son programme sur PC (car oui, la machine d’IBM s’était fait une place jusque dans le bloc de l’Est) et demande pour cela l’aide d’un prodige de seize ans, Vadim Guerasimov, lequel ajoutera la couleur et le tableau des scores. Le jeu va alors commencer à se répandre sous toutes les formes, y compris les clones – après tout, le concept de « propriété intellectuelle » n’existait pas dans le bloc communiste, et les chercheurs de l’Académie des sciences n’étaient pas exactement censés développer des jeux vidéo.

Il faudra attendre 1986 pour qu’une copie du jeu atterrisse sur le bureau de Novotrade et attire l’œil de Robert Stein, un agent international de vente de logiciels de passage en Hongrie, qui décèlera immédiatement le potentiel du programme. Confronté à l’indifférence de l’Académie des sciences, Stein contacte alors directement Pajitnov et Victor Brjabrin, l’homme par qui Pajitnov a décidé de passer pour la gestion des droits, par fax. En dépit de l’absence d’un accord formel, Stein s’envole avec les droits dans son escarcelle, les deux chercheurs russes ignorant qu’un simple fax a une valeur légale en occident. Ce malentendu engendrera une situation juridique confuse qui verra de nombreuses compagnies revendiquer les droits du jeu lors des années à suivre, mais il participera également au succès planétaire du jeu. Le reste fait partie de l’histoire – et vous pourrez d’ailleurs en suivre le détail au gré des (très nombreuses) versions abordées dans cet article.

Le plus fascinant, en lançant cette première version PC de 1986 (on se doute que la version originale de Pajitnov, n’ayant jamais été commercialisée officiellement et n’ayant existé que sur des unités centrales moscovites, est aujourd’hui à peu près introuvable), c’est surtout de constater à quel point tout est déjà là.

La réalisation est pour le moins spartiate – le jeu emploie le mode texte plutôt qu’un affichage graphique –, il n’y a pas la moindre forme de son, un seul mode de jeu (l’illimité, celui que tout le monde connait), la seule option se limite au choix du niveau de départ, l’unique objectif est le score et le tout ne peut être joué qu’au clavier, mais ça fonctionne déjà – et ça fonctionne encore. On notera que cette version donne une prime à la hauteur des combinaisons (plus une ligne effacée est haute sur la grille, plus elle rapporte de points) et qu’on peut choisir de se priver de l’affichage de la prochaine pièces, là encore pour un bonus au score. Une grande partie des versions commerciales des années à suivre ne feront finalement que peaufiner la réalisation sans modifier en rien la jouabilité, et ce constat est finalement toujours vrai près de quarante ans plus tard, ou ce fameux mode illimité figure encore à l’identique (en termes de gameplay, s’entend) dans toutes les versions du jeu. C’est dire à quel point l’idée était bonne.
Vidéo – Cinq minutes de jeu :
NOTE FINALE : 14,5/20 Est-il encore réellement nécessaire de présenter Tetris ? Concept vidéoludique si génial qu'il n'a pour ainsi dire pas eu à évoluer en quarante ans, le titre originellement imaginé par Alexei Pajitnov a la force de son évidence : un subtil mélange d'adresse, de réflexion et de planification avec pour seul objectif le score. La seule chose qui ait fait vieillir le principe est ironiquement son formidable succès, qui l'aura vu décliné à toutes les sauces jusqu'à devenir son propre genre avec ses propres clones, sous-clones, faux frères et héritiers, de Puyo Puyo à Columns en passant par Pac-Panic ou Block Out, pour n'en citer qu'une infime poignée, et cette version de 1986 n'aura depuis été supplantée que dans les domaines de la réalisation et des modes de jeu – mais le cœur de l'expérience est toujours aussi efficace. Et ça, c'est quand même un signe. CE QUI A MAL VIEILLI : – Une réalisation forcément spartiate... – ...avec un unique mode de jeu solo en guise de contenu
Tetris : The Soviet Challenge

Développeurs : Alexei Pajitnov et Vadim Gerasimov
Éditeur : Spectrum Holobyte, Inc.
Testé sur : PC (DOS) – Amiga – Apple II – Apple IIgs – Macintosh – Atari ST
Après ses débuts en Union Soviétique, Tetris aura rapidement attiré l’attention des éditeurs occidentaux… lesquels se seront parfois montrés excessivement méfiants face au concept – et surtout face à son origine –, certaines compagnies comme Brøderbund ou Mastertronic estimant qu’un jeu soviétique ne pouvait tout simplement pas rencontrer le succès hors de l’U.R.S.S. Néanmoins, au CES de Las Vegas, en 1987, Robert Stein parvient à signer deux accords : les droits européens du jeu tomberont dans l’escarcelle de Mirrorsoft – après que son dirigeant y a joué plusieurs heures dès sa première partie – tandis que les droits américains échoiront à Spectrum Holobyte. Les droits sont vendus alors que Stein n’a même pas encore signé un contrat avec les soviétiques. Pour la version américaine – celle qui nous intéresse ici, donc – le PDG de la compagnie demande une refonte de la réalisation, tout en cherchant à capitaliser sur l’aspect « russe » du programme, au point d’aller jusqu’à afficher le Kremlin sur la boîte du jeu en écrivant son nom en alphabet cyrillique. Le principe n’a bien évidemment pas changé d’un iota, mais c’est néanmoins via ces deux premières versions que le programme de Pajitnov va faire son chemin vers sa renommée mondiale… pour laquelle son créateur ne sera originellement même pas crédité dans la version européenne, sans même parler de toucher un centime de royalties, la création intellectuelle des chercheurs de l’Académie des sciences revenant à l’Académie elle-même.
Version PC (DOS)
| Date de sortie : Janvier 1988 |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Anglais |
| Supports : Disquettes 5,25″ et 3,5″ |
| Contrôleurs : Clavier, joystick |
| Version testée : Version disquette émulée sous DOSBox |
| Configuration minimale : Processeur : Intel 8088/8086 – OS : PC/MS-DOS 2.0 – RAM : 256ko Modes graphiques supportés : CGA, EGA, Hercules, Tandy/PCjr Carte son supportée : Haut-parleur interne |

Tetris aura donc entamé sa carrière internationale là où il avait connu son essor dans le bloc de l’est : sur PC. Le programme tire pour l’occasion parti des capacités des systèmes de l’époque, à savoir des différents modes graphiques jusqu’à l’EGA et de pas grand chose d’autre, l’AdLib n’étant pas encore commercialisée en janvier 1988. Le résultat, comme on peut le voir, a le mérite de rendre l’habillage un peu plus séduisant, le décor changeant à chaque niveau – ce n’est pas toujours sublime, mais c’est déjà moins triste qu’un simple écran noir. Il n’y a pas de musique, ce qui n’est sans doute pas un tort, et les bruitages sont particulièrement discrets. En termes de gameplay, une nouveauté a fait son apparition : la possibilité de commencer la partie avec un certain nombre de lignes d’obstacles histoire de compliquer les choses. Rien de franchement bouleversant – d’autant qu’il n’est toujours pas question de jouer à deux – mais le titre reste plus agréable à l’usage que la version originale.

NOTE FINALE : 15,5/20
Pour sa deuxième itération sur PC, Tetris aura surtout tenté de soigner l’habillage, avec une certaine réussite. Si les nouveaux décors rendent l’expérience moins austère, le gameplay ne s’enrichit pour sa part que d’un mode de jeu très dispensable – mais bon, à tout prendre, on s’en contentera.
Version Amiga
| Développeur : Spectrum Holobyte, Inc. |
| Éditeur : Spectrum Holobyte, Inc. (Amérique du Nord) – Infogrames Multimedia SA (Europe) |
| Date de sortie : Décembre 1988 |
| Nombre de joueurs : 1 à 6 (à tour de rôle) |
| Langue : Anglais |
| Support : Disquette 3,5″ |
| Contrôleurs : Clavier, souris |
| Version testée : Version disquette testée sur Amiga 1200 |
| Configuration minimale : Système : Amiga 500/2000 – OS : Kickstart 1.2 – RAM : 512ko Modes graphiques supportés : OCS/ECS |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Il aura fallu pratiquement un an pour que Tetris fasse le trajet du PC jusqu’à l’Amiga. Rien de neuf à attendre du côté du contenu – à ce niveau, on est face à l’exact équivalent de la version DOS – mais la réalisation est, comme on peut s’en douter, un peu moins fade que sur la machine d’IBM. Les illustrations ont été refaites, c’est bien plus coloré, et on a cette fois un thème musical pendant la partie plutôt que de composer uniquement avec les bruitages. L’interface est intégrée directement dans l’OS – un peu à la façon de Windows – et laisse donc apparaître les options en déplaçant le curseur dans la partie supérieure de l’écran, mais pour le reste, c’est le même jeu d’un bout à l’autre. On remarquera quand même l’apparition d’un mode tournoi permettant à plusieurs joueurs de s’escrimer chacun leur tour exactement de la même façon que s’il n’y avait pas de mode tournoi.

NOTE FINALE : 16/20
Aucune surprise pour Tetris sur Amiga, mais le fait de bénéficier d’une réalisation colorée – et surtout d’un thème musical – fait quand même un bien fou. Le type même de jeu qu’on peut lancer aujourd’hui avec un plaisir égal.
Version Apple II
| Développeur : Spectrum Holobyte, Inc. |
| Éditeur : Spectrum Holobyte, Inc. |
| Date de sortie : Juillet 1988 |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Anglais |
| Support : Disquette 5,25″ |
| Contrôleurs : Clavier, joystick |
| Version testée : Version disquette testée sur Apple IIe |
| Configuration minimale : Systèmes : Apple II+/e/c – RAM : 48ko Modes graphiques supportés : Haute résolution, double haute résolution |

L’Apple II aura également eu le droit à sa version de Tetris, dans un portage s’efforçant de tirer parti des capacités des derniers modèles de la machine, et notamment du mode double haute résolution. Le résultat est objectivement très correct – vraiment pas à des kilomètres, en fait, de ce que pouvait afficher le mode EGA d’un PC ! Le jeu permet l’usage du joystick, contrairement à la version Amiga, et la musique est bien évidemment aux abonnés absents. Le contenu n’a, pour sa part, pas changé d’un pouce, et les sensations restent très bonnes. Bref, la version qu’on était en droit d’attendre.
NOTE FINALE : 15,5/20
Paru dans une version s’efforçant de tirer le meilleur de la machine, Tetris sur Apple II constitue un portage jouable et bien réalisé, où seule l’absence de la musique se fait réellement sentir. Un bon portage.
Version Apple IIgs
| Développeur : Spectrum Holobyte, Inc. |
| Éditeur : Spectrum Holobyte, Inc. |
| Date de sortie : Juillet 1988 |
| Nombre de joueurs : 1 à 6 (à tour de rôle) |
| Langue : Anglais |
| Support : Disquette 3,5″ |
| Contrôleurs : Clavier, joystick |
| Version testée : Version disquette |
| Configuration minimale : RAM : 512ko |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Petite curiosité, cette itération Apple IIgs de Tetris était vendue directement en bundle avec la version Apple II du jeu, un bon moyen pour les joueurs passant d’une machine à l’autre de jauger les capacités du nouvel ordinateur comparé à celles de l’ancien. Le jeu préfigure pour l’occasion de ce que donnerait la version Amiga quelques mois plus tard, avec les mêmes illustrations et la même interface, sans oublier l’apparition des thèmes musicaux. Ce portage comporte même un mode avancé inédit, qui se limite à doubler la vitesse de tous les niveaux – mais hé, pourquoi pas. Le reste n’a pas changé et constitue toujours un très bon moyen de découvrir un jeu qui n’a pas pris une ride.

NOTE FINALE : 16/20
Mission accomplie pour l’itération Apple IIgs de Tetris, qui se hisse pratiquement à la hauteur de la version Amiga – et pour cause, il est facile de deviner qu’elle lui a servi de modèle. Rien ne manque, la réalisation est à la hauteur, et on hérite même d’un mode de jeu supplémentaire. Que du bonheur
Version Macintosh
| Développeur : Spectrum Holobyte, Inc. |
| Éditeur : Spectrum Holobyte, Inc. |
| Date de sortie : Juillet 1988 (version Macintosh) – Décembre 1988 (version Macintosh II) |
| Nombre de joueurs : 1 à 6 (à tour de rôle) |
| Langue : Anglais |
| Support : Disquette 3,5″ |
| Contrôleur : Clavier |
| Version testée : Version disquette |
| Configuration minimale : Processeur : Motorola 68000 – RAM : 512ko |

Tetris aura décidément fait le tour de toutes les machines d’Apple – et cette version Macintosh n’est pas sans rappeler celle publiée simultanément sur Apple IIgs, dont elle reprend à la fois le contenu et l’interface – mais en haute résolution, à présent. Le mode avancé est toujours de la partie, tout comme le mode tournoi, et le jeu existe à la fois dans une version monochrome pour les premiers modèles de Macintosh et en version couleur pour le Macintosh II et ultérieur. La musique est toujours de la partie, elle aussi, ce qui fait qu’on n’a vraiment aucune raison de bouder cette version.

NOTE FINALE : 16/20
Portage très solide pour Tetris sur Macintosh, avec tout le contenu et toutes les possibilités des meilleures versions 16 bits, en couleurs ou en monochrome.
Version Atari ST
| Développeur : Spectrum Holobyte, Inc. |
| Éditeur : Spectrum Holobyte, Inc. (Amérique du Nord) – Infogrames Multimedia SA (France) |
| Date de sortie : Mars 1989 |
| Nombre de joueurs : 1 à 6 (à tour de rôle) |
| Langue : Anglais |
| Support : Disquette 3,5″ simple face (x2) |
| Contrôleurs : Clavier, souris |
| Version testée : Version disquette testée sur Atari 1040 STe |
| Configuration minimale : Système : 520 ST – RAM : 512ko |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Pendant qu’Atari commençait à se frictionner avec Nintendo pour la question de savoir qui avait le droit de revendiquer les droits d’adaptation de Tetris, Spectrum Holobyte se décidait, assez tardivement (mais l’Atari ST représentait après tout un marché assez marginal aux États-Unis), à convertir le jeu sur l’ordinateur 16/32 bits. Sans surprise, on hérite pour l’occasion d’une version très proche de celle publiée sur Amiga, mais avec l’interface intégrée au GEM. Les graphismes sont en seize couleurs, la qualité de la musique est très légèrement inférieure (et elle tourne en boucle assez vite), mais dans l’ensemble on ne peut pas dire qu’il y ait de quoi être bouleversé par les quelques nuances entre les deux versions. De quoi découvrir le jeu dans de bonnes conditions, quoi qu’il arrive.

NOTE FINALE : 16/20
Transcription assez fidèle de la version Amiga, dans le contenu comme dans la réalisation – en dépit de quelques menus sacrifices tant graphiques que sonores –, la version Atari ST de Tetris offre à peu près ce qu’on était en droit d’attendre sans avoir à faire la moue face au résultat final.
Tetris (Mirrorsoft)

Développeur : Elorg
Éditeur : Mirrorsoft Ltd.
Testé sur : Amiga – Amstrad CPC – Amstrad PCW – Atari ST – BBC Micro – Commodore 64 – Electron – ZX Spectrum
Comme on l’aura vu, Tetris aura été commercialisé parallèlement en Amérique du Nord et en Europe par deux éditeurs différents – les premiers effets d’un mic-mac juridique qui ne faisait alors que commencer, Robert Stein ayant vendu des droits qu’il ne possédait pas encore, et qu’il pensait s’étendre à toutes les versions du jeu alors qu’ils ne concernaient que les versions sur ordinateurs. Quoi qu’il en soit, la version européenne aura débarqué à peu près en même temps que la version américaine, avec des adaptations un peu plus décevantes : plus question de profiter ici des illustrations en guise de décor, l’interface s’approchant nettement plus de celle de la version originale sur PC. On notera d’ailleurs que le jeu commence par défaut au niveau cinq, et que s’il est possible d’augmenter la vitesse, je n’ai pas trouvé le moyen de la réduire ! Au moins peut-on ici compter sur la participation de David Whittaker à la musique, mais dans l’ensemble cette version intéressera surtout les possesseurs de systèmes n’ayant pas hérité de la version américiane du jeu – c’est à dire les ordinateurs 8 bits.
Version Amiga
| Date de sortie : Février 1988 |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Anglais |
| Support : Disquette 3,5″ |
| Contrôleur : Joystick |
| Version testée : Version disquette testée sur Amiga 1200 |
| Configuration minimale : Système : Amiga 1000 – RAM : 512ko Modes graphiques supportés : OCS/ECS |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Comme on l’aura vu en préambule, Mirrorsoft aura vraiment procédé à des adaptations minimales au moment de porter Tetris sur les systèmes européens, et il en ressort assez rapidement que cette édition est inférieure en tous points à celle de Spectrum Holobyte. Un seul décor, un seul thème musical, une interface qui trouve le moyen d’être moins pratique que celle de la version de 1984… il y a de quoi être déçu, et ce n’est pas le vague effet de perspective ajouté aux tétriminos qui va y changer grand chose. Fort heureusement, le cœur du jeu, lui, est exactement le même, mais les modes de jeu additionnels de la version américaine n’existent pas ici, et globalement on réservera cette version aux nostalgiques ayant découvert le jeu grâce à elle – les autres peuvent foncer sans hésiter sur le portage de Spectrum Holobyte.

NOTE FINALE : 15/20
Le Tetris de Mirrorsoft est un portage assez fainéant, epnsé d’entrée de jeu pour les ordinateurs 8 bits, et n’intégrant strictement rien de neuf par rapport à la version PC de 1986. Cette version Amiga ne déroge pas à la règle, et son principal mérite est de mettre en valeur la conversion réalisée en parallèle par Spectrum Holbyte pour le marché américain. Décevant.
Version Amstrad CPC
| Développeur : Rowan Software Ltd. |
| Éditeur : Mirrorsoft Ltd. |
| Date de sortie : Avril 1988 |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Anglais |
| Supports : Cassette, disquette 3″ |
| Contrôleurs : Clavier, joystick |
| Version testée : Version disquette testée sur Amstrad CPC 6128 Plus |
| Configuration minimale : Système : 464 – RAM : 64ko |

Comme on pouvait le pressentir en 1988, Tetris à la sauce Mirrorsoft s’avère bien plus à l’aise sur les ordinateurs 8 bits que sur la génération suivante, et cette version CPC s’en tire globalement très bien. Certes, toujours aucune fioriture graphique à espérer au niveau du décor, et on est stricto sensu face à la version de 1986 en plus coloré – et surtout, avec de la musique, d’ailleurs assez réussie. L’interface est plus claire que sur Amiga (on choisit son niveau au lancement de la partie) et si toutes les idées ne sont pas heureuses (le fait d’ajouter des lignes verticales dans la fenêtre de jeu avait sans doute pour objectif de rendre les choses plus lisibles, mais c’est raté), on bénéficie au moins du jeu de base dans un portage plus que décent. Dommage que le contenu, lui, n’ai pas bougé d’un pouce et qu’il faille toujours se contenter d’un unique mode de jeu.
NOTE FINALE : 15/20
Prestation réussie pour Tetris sur CPC, qui ne croule certes ni sous les nouveautés ni sous les modes de jeu, mais qui se pare d’une réalisation qui fait honneur à la machine qui l’héberge. C’est déjà ça.
Version Amstrad PCW
| Développeur : Rowan Software Ltd. |
| Éditeur : Mirrorsoft Ltd. |
| Date de sortie : Avril 1988 |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Anglais |
| Support : Disquette 3″ |
| Contrôleur : Joystick |
| Version testée : Version disquette |
| Configuration minimale : RAM : 256ko |

Signe de son succès, Tetris aura même eu le droit à une adaptation sur PCW, machine pourtant pensée exclusivement pour la bureautique avec son écran monochrome. Le résultat, comme on peut s’en douter, est moins emballant que sur CPC, mais n’est pas ridicule comparé à ce que pouvait afficher un Macintosh à la même période – c’est même plutôt meilleur. C’est d’ailleurs largement à la hauteur de la version PC de 1986 – moins coloré, de toute évidence, mais bien plus fin, même s’il n’y a toujours pas de musique. Le contenu comme l’interface, de leur côté, sont rigoureusement les mêmes, et le résultat en fait à n’en pas douter un des très rares logiciels de la machine qu’on puisse espérer relancer aujourd’hui avec un plaisir égal. De quoi déboucher le champagne.
NOTE FINALE : 14,5/20
Tetris peut sans peine revendiquer une place au sommet de la très mince ludothèque de l’Amstrad PCW, grâce à une réalisation à la hauteur et une maniabilité sans heurt. C’est la grande force des concepts géniaux : il faut rarement des machines de compétition pour les faire tourner.
Version Atari ST
| Développeur : Elorg |
| Éditeur : Mirrorsoft Ltd. |
| Date de sortie : Mars 1988 |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Anglais |
| Support : Disquette 3,5″ simple face |
| Contrôleur : Joystick |
| Version testée : Version disquette testée sur Atari 1040 STe |
| Configuration minimale : Système : 520 ST – RAM : 512ko |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Concernant Tetris sur Atari ST, les choses vont aller vite : comme souvent à cette période, le jeu est pratiquement identique à la version Amiga. Graphiquement, faites-moi signe si jamais vous percevez une différence, et si le rendu sonore est un peu inférieur on ne peut pas dire que la différence soit franchement bouleversante. Une nouvelle fois, l’effet de perspective n’apporte rien et ce portage laisse globalement l’impression d’être plutôt inférieur que les versions 8 bits. Dans tous les cas, et quitte à découvrir le jeu sur Atari ST, mieux vaut pencher pour la version de Spectrum Holobyte.

NOTE FINALE : 15/20
Comme sur Amiga, Tetris version Atari ST n’offre strictement rien de plus que les versions 8 bits, et s’avère inférieur à la version américaine tant sur le plan de la réalisation que sur celui du contenu. Le concept de base est toujours aussi bon, mais ce n’est clairement pas la meilleure itération pour le découvrir
Version BBC Micro
| Développeur : Rowan Software Ltd. |
| Éditeur : Mirrorsoft Ltd. |
| Date de sortie : 1988 |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Anglais |
| Supports : Cassette, disquettes 5,25″ et 3,5″ |
| Contrôleur : Clavier |
| Version testée : Version disquette |
| Configuration minimale : – |

Sur BBC Micro, Tetris opère une forme de retour aux sources : oubliez tout le superflu, à commencer par la musique, on est face à la version de 1986 en aussi dépouillé. Cela ne change objectivement pas grand chose en termes de sensations de jeu, et c’est au moins aussi lisible que sur PC, ce qui fait que les utilisateurs de la machine d’Acorn n’avaient pas de raison de se sentir floués – encore une fois, dommage que le contenu se limite à ce que proposait déjà le programme originel sans même faire mine d’y ajouter quelque chose. Mais à l’échelle de la ludothèque de la machine, on peut sans doute parler d’incontournable.
NOTE FINALE : 14,5/20
Tetris sans les fioritures reste Tetris, et cette version BBC Micro offre l’essentiel de l’expérience de jeu de façon très lisible et parfaitement jouable, soit ce qui était sans aucun doute le meilleur choix. Seul l’absence de musique pénalise ce portage comparé aux autres, mais pour le reste, tout est parfaitement à sa place.
Version Commodore 64
| Développeur : Elorg |
| Éditeur : Spectrum Holobyte, Inc. (Amérique du Nord) – Mirrorsoft Ltd. (Europe) |
| Date de sortie : Janvier 1988 |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Anglais |
| Supports : Cassette, disquette 5,25″ |
| Contrôleur : joystick |
| Version testée : Version disquette |
| Configuration minimale : RAM : 64ko |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Version un peu particulière pour Tetris sur Commodore 64, en ce sens qu’elle a été commercialisée à la fois aux États-Unis et en Europe, respectivement par Spectrum Holobyte et Mirrorsoft, mais les particularités ne s’arrêtent pas là. C’est également la seule version dont la zone de jeu fasse 21 blocs de hauteur plutôt que 20, et l’affichage de la pièce suivante est ici activé en permanence plutôt que d’être en option en échange d’un bonus de score. Il n’y a qu’un seul thème musical, mais celui-ci s’étend sur la bagatelle de près de 26 minutes (!) – et il peut être désactivé pour ceux qui préfèreraient profiter des bruitages à la place. Pour le reste, on pourra surtout regretter que le jeu ne soit pas plus coloré – le décor est quasiment monochrome, et les pièces alternent entre le gris sordide et le marron poisseux – et qu’il faille une nouvelle fois se contenter d’un unique mode de jeu, mais hé, c’est Tetris et ça fonctionne toujours aussi bien.

NOTE FINALE : 15/20
Reconnaissable à l’ambition démesurée de son thème musical plus qu’à celui de son contenu, l’itération Commodore 64 de Tetris accomplit néanmoins sa mission avec sérieux, même si on pourra regretter une réalisation un peu sombre. Largement de quoi passer un aussi bon moment que sur les versions 16 bits, néanmoins.
Version Electron
| Développeur : Rowan Software Ltd. |
| Éditeur : Mirrorsoft Ltd. |
| Date de sortie : 1988 |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Anglais |
| Support : Cassette |
| Contrôleur : Clavier |
| Version testée : Version cassette |
| Configuration minimale : – |

Également débarqué sur la version « entrée de gamme » du BBC Micro, Tetris y accomplit… eh bien, une prestation exactement identique sur le plan technique – ce qui est l’avantage des concepts ne demandant pas beaucoup de ressources. En fait, la seule nuance de cette version comparé à celle parue sur BBC Micro est à aller chercher du côté de la répartition des touches du clavier, sans qu’on sache d’ailleurs trop pourquoi, les deux machines disposant des mêmes possibilités en la matière. Quoi qu’il en soit, on obtient une nouvelle fois une version très dépouillée et dépourvue de musique, mais qui n’en est pas moins aussi efficace que toutes les autres.
NOTE FINALE : 14,5/20
Tetris peut au moins se vanter de faire aussi bien sur Electron que sur BBC Micro, en opérant les mêmes sacrifices sans ternir en rien la lisibilité ni la jouabilité de l’ensemble. Encore une fois, aucune fioriture à espérer, mais ce n’est pas exactement ce qui compte quand on lance un jeu comme celui-là.
Version ZX Spectrum
| Développeur : Andromeda Software |
| Éditeur : Mirrorsoft Ltd. |
| Date de sortie : Février 1988 |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Anglais |
| Supports : Cassette, disquette 3″ |
| Contrôleur : Clavier |
| Version testée : Version cassette testée sur ZX Spectrum 128k |
| Configuration minimale : RAM : 48ko* *Existe en version optimisée pour les modèles à 128ko |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Parfois, un jeu est victime de ses qualités. Cas d’école avec ce Tetris sur ZX Spectrum : proposer une réalisation soignée avec des fioritures pour agrémenter l’écran, sur le papier, c’est une bonne idée. Là où cela en devient une moins bonne, c’est quand les fioritures en question gênent considérablement la lisibilité, deux des sept couleurs employées pour les tétriminos venant se fonde avec le décor, ce qui fait qu’on n’arrive souvent plus à savoir si certaines zones sont ou non occupées par une pièce – légèrement gênant, dans ce type de jeu ! C’est d’autant plus dommage que tout le reste est très exactement à la place où on l’attendait, même si le jeu n’est curieusement jouable qu’au clavier. Mais à tout prendre, c’est certainement la moins bonne version du jeu.

NOTE FINALE : 13/20
C’est fou comme il suffit parfois d’une mauvaise idée pour saboter inutilement un jeu qui s’en serait autrement très bien sorti, et l’ajout d’un motif de fond qui bousille la lisibilité n’était clairement pas ce dont cette version ZX Spectrum de Tetris avait besoin. Le mieux est sans doute d’aller découvrir le programme sur une autre machine.
Tetris (Atari games Corporation)

Développeur : Atari Games Corporation
Éditeur : Atari Games Corporation
Testé sur : Arcade – NES
Au fil de l’année 1988, les choses n’auront cessé de se complexifier pour l’exploitation des droits de Tetris. Atari Games aura un temps pensé les avoir récupérés via sa filiale Tengen – et pour cause, Mirrorsoft les leur avait revendus – le petit souci étant que Robert Stein n’avait en réalité obtenu les droits que pour les ordinateurs, et que les soviétiques n’étaient d’ailleurs même pas au courant de ceux-ci, les accords passés dans leur dos ne leur rapportant pas de royalties. Suivront des semaines de quiproquos et de batailles juridiques qui aboutiront au retrait à la vente le 21 juin 1989 de la version publiée par Tengen, suivi d’un procès remporté par Nintendo et qui scellera la fin des prétentions d’Atari sur la licence. La borne d’arcade, pour sa part, aura eu le temps de faire sa carrière dans les salles, en introduisant au passage une nouveauté bienvenue : le mode deux joueurs.
Version Arcade
| Date de sortie : 1988 |
| Nombre de joueurs : 1 à 2 |
| Langue : Anglais |
| Support : Borne |
| Contrôleurs : Un joystick (huit directions) et un bouton |
| Version testée : Version internationale, set 1 |
| Hardware : Processeurs : MOS Technology 6502 1,789772MHz ; Atari C012294 POKEY 1,789772MHz (x2) Son : Haut-parleur ; Atari C012294 POKEY 1,789772MHz (x2) ; 1 canal Vidéo : 336 x 240 (H) 59,922743Hz |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Pour sa première incursion dans les salles d’arcade, Tetris s’en tient à l’essentiel, dans une version qui n’a rien de plus impressionnant que celles aprues sur ordinateurs. Certes, c’est coloré et les pièces sont détaillées, tout comme l’interface, mais il n’y a pas de décors ni rien qui mette franchement en valeur ce qui se passe au-delà de la fenêtre de jeu. Le programme vous laisse dorénavant le choix entre trois niveaux de difficultés qui correspondrant à la sélection du niveau de départ, et le nombre de lignes à réaliser avant de passer au niveau suivant est clairement indiqué à chaque fois. Histoire de rester dans le thème, des morceaux de musique d’inspiration russe tournent en boucle, et un mode deux joueurs fait son apparition… lequel se limite pour le moment à laisser chacun des participants jouer tout seul dans son coin : il n’y a aucune interaction entre les deux joueurs, aucune pénalité envoyée pour avoir réussi une ligne, et au game over de l’un, l’autre continue simplement sa partie comme si de rien n’était. Bref, rien de très neuf, mais pour dépenser quelques rédits dans une borne, c’était bien suffisant.

NOTE FINALE : 15,5/20
Version fonctionnelle pour le Tetris d’Atari, qui n’introduit rien de neuf à l’exception d’un mode deux joueurs extrêmement anecdotique. La réalisation n’ayant rien d’inoubliable, elle non plus, et la partie étant toujours limitée à un unique mode de jeu solo, on peut très bien rester sur les versions informatiques de Spectrum Holobyte sans rien perdre au change.
Version NES
| Développeur : Tengen Inc. |
| Éditeur : Tengen Inc. |
| Date de sortie : Mai 1989 |
| Nombre de joueurs : 1 à 2 (simultanément ou à tour de rôle) |
| Langue : Anglais |
| Support : Cartouche |
| Contrôleur : Joypad |
| Version testée : Version américaine |
| Spécificités techniques : Cartouche de 384kb |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Un mois, c’est donc la durée pendant laquelle Atari (via Tengen) aura pu commercialiser sa propre version de Tetris – une des trois qu’aura connues la console – avant de devoir la retirer de la vente. Les ventes ayant été très prometteuses sur cette période, la firme américaine aura eu de bonnes raisons de se mordre les doigtss d’avoir fait confiance à Mirrorsoft.

Du côté des joueurs, il y aura peut-être aussi quelques regrets à nourrir, cette version étant loin de se moquer du monde en termes de contenu, avec notamment un mode deux joueurs jouable contre un humain ou contre l’ordinateur, et un mode « coopératif » inédit, lui aussi jouable avec un ami ou avec l’intelligence artificielle ! C’est d’autant plus intéressant que le mode « compétitif », lui, est toujours aussi inintéressant que sur la borne d’arcade, la prime étant de jouer le plus lentement possible sans se soucier de ce que fait l’adversaire. Sachant qu’il est également possible de choisir son niveau de difficulté et son thème musical parmi quatre morceaux, voilà une version qui aurait pu rester dans les mémoires… si seulement quelqu’un s’était un peu mieux préoccupé de la réalité de l’attribution des droits.

NOTE FINALE : 16,5/20
Il y a de quoi regretter qu’elle n’ait été disponible à la vente qu’un mois, cette version NES de Tetris par tengen, car elle était ojectivement très solide sur le plan du contenu, avec quelques modes multijoueurs bien pensés. Elle demeure aujourd’hui encore une très bonne façon de découvrir le jeu avec un ami – à condition de parvenir à mettre la main sur la cartouche.
Tetris (Bullet-Proof Software)

Développeur : Bullet-Proof Software, Inc.
Éditeur : Bullet-Proof Software, Inc.
Testé sur : PC-88 – Famicom – FM-7 – MSX – PC-98 – Sharp X1 – Sharp X68000
Pendant que Spectrum Holobyte et Mirrorsoft se partageaient les droits de Tetris en occident – avant de les revendre, entrainant le mic-mac juridique que l’on a vu et où des dizaines de compagnies auront fini par revendiquer les droits en question –, c’est Bullet-Proof Software qui aura récupéré le pactole au Japon, au moins jusqu’à ce que Nintendo le revendique à son tour. La Famicom aura d’ailleurs eu une nouvelle fois les honneurs d’une adaptation (chronologiquement, la première des trois que la machine aura hébergées), mais l’histoire ne dit pas comment les choses se seront résolues juridiquement là-bas. Retenons donc juste que cette version réservée au marché japonais fait énormément penser à celle de Spectrum Holobyte au niveau de l’interface, au détail près que le décor ne change pas d’un niveau à l’autre dans cette version.
Version PC-88
| Date de sortie : Novembre 1988 (Japon) |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Anglais |
| Support : Disquette 5,25″ |
| Contrôleur : Clavier |
| Version testée : Version japonaise |
| Configuration minimale : Système : PC-8801mkII |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Qu’importe le flacon… Dans sa version japonaise, on sent bien que Tetris sera allé à l’essentiel : un unique décor, un unique mode de jeu, et en substance rien qu’on n’ait déjà trouvé dans la version de 1986, sauf peut-être les obstacles qui apparaissent dans les stages avancés. Le résultat n’en est pas déplaisant pour autant, les graphismes étant aussi fins que colorés, et on peut profiter de trois thèmes pusicaux (là encore, d’inspiration russe) en guise d’accompagnement. La jouabilité au clavier est équivalente à celle des version occidentales, même si on remarquera que l’affichage de la pièce suivante est ici toujours activé sans avoir à appuyer sur une touche pour ce faire.

NOTE FINALE : 15,5/20
Dans sa version japonaise, Tetris ne propose pas grand chose de plus que le strict minimum, au moins le fait-il bien grâce à une réalisation très lisible, à une musique toujours aussi entêtante et à une jouabilité irréprochable. Dommage que le décor ne change jamais et que personne n’ait daigné creuser un peu le contenu.
Version Famicom
| Développeur : Bullet-Proof Software, Inc. |
| Éditeur : Bullet-Proof Software, Inc. |
| Date de sortie : 22 décembre 1988 (japon) |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Anglais |
| Support : Cartouche |
| Contrôleur : Joypad |
| Version testée : Version japonaise, révision B |
| Spécificités techniques : Cartouche de 384kb |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
La console de Nintendo aura décidément eu bien des occasions de goputer à Tetris. Pour ce premier passage, la cartouche se conforme au contenu des autres éditions proposées par Bullet-Proof Software, ce qui signifie qu’on est très loin de contenu et des options proposés par l’éphémère version américaine de Tengen cinq mois plus tard. Il faudra donc une nouvelle fois se contenter d’un unique mode de jeu solo, de trois thèmes musicaux et de pas grand chose d’autre, pas même d’un emballage graphique ayant le bon goût de se renouveler d’un niveau à l’autre. Le jeu n’en est pas moins sympathique, bien sûr, mais on n’y trouvera rien qu’on ne trouve dans une des centaines de versions disponibles depuis lors. On notera également la jouabilité un peu contre-nature, la flèche du bas servant ici à retourner les pièces et le bouton A à les faire descendre là où c’est traditionnellement l’inverse depuis.

NOTE FINALE : 15,5/20
Comme dans les autres itérations japonaises, Tetris débarque sur Famicom avec le contenu et l’habillage minimaux. La réalisation a beau être honnête, et le principe toujours aussi efficace, difficile de recommander cette version à un joueur ayant accès à un épisode plus récent – où tout simplement à la cartouche américaine, mieux dotée en la matière.
Version FM-7
| Développeur : Bullet-Proof Software, Inc. |
| Éditeur : Bullet-Proof Software, Inc. |
| Date de sortie : Novembre 1988 (Japon) |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Anglais |
| Support : Disquette 5,25″ |
| Contrôleur : Clavier |
| Version testée : Version disquette |
| Configuration minimale : – |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
À ce stade, il conviendrait d’aborder toutes les versions traitées en partant du principe que leur test commencerait tous par la même phrase : « voir version PC-88 ». Tous les portages du jeu ayant été développés par la même équipe sur des hardwares aux caractéristiques assez semblables, il ne faudra pas s’attendre ici à de grandes différences d’une machine à l’autre. Le contenu n’a pas bougé d’un pouce, pas plus que la jouabilité, le rendu sonore est à peu près équivalent ; la seule nuance sera donc à chercher du côté des graphismes, désormais affichés en 320×200 mais avec une palette un peu plus étendue ici. C’est la seule différence, alors à vous de voir quelle version à votre préférence.

NOTE FINALE : 15,5/20
Identique à la version PC-88 en termes de contenu, de jouabilité et d’interface, Tetris sur FM-7 ne s’en distingue que par une réalisation graphique moins fine mais légèrement plus colorée. Rien de bouleversant, mais ceux qui chercheraient une version du jeu à leur goût peuvent faire leur marché en toute quiétude.
Version MSX
| Développeur : Bullet-Proof Software, Inc. |
| Éditeur : Bullet-Proof Software, Inc. |
| Date de sortie : 1988 (Japon) |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Anglais |
| Supports : Cartouche, disquette 3,5″ |
| Contrôleurs : Clavier, joystick |
| Version testée : Version cartouche testée sur MSX 2+ |
| Configuration minimale : Système : MSX 2 |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Sur MSX 2, Tetris va clairement lorgner du côté de la version FM-7 – en plus fin, puisque cette version fait le choix d’une résolution en 512×212, et avec moins de couleurs en contrepartie, mais le résultat reste plaisant. Les thèmes musicaux n’ont pas bougé, pas davantage que le contenu, et la jouabilité au joystick reprend celle de la version Famicom. Bref, une autre variante de la même version.

NOTE FINALE : 15,5/20
Les résolutions et les palettes de couleurs changent, mais Tetris reste sur MSX sensiblement le même jeu que sur tous les autres systèmes japonais. Le contenu ne varie pas, et les vrais amateurs du jeu seront sans doute plus à l’aise sur la version de Spectrum Holobyte – ou sur toutes celles qui sont sorties depuis lors.
Version PC-98
| Développeur : Bullet-Proof Software, Inc. |
| Éditeur : Bullet-Proof Software, Inc. |
| Date de sortie : 18 Novembre 1988 (Japon) |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Anglais |
| Support : Disquette 5,25″ |
| Contrôleur : Clavier |
| Version testée : Version disquette |
| Configuration minimale : – |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Pour la version PC-98 de Tetris, les choses vont aller encore plus vite que pour les autres portages : cette fois, c’est littéralement la version PC-88 à l’identique, dans la même résolution et avec la même palette de couleurs. La jouabilité et le contenu étant, une fois de plus, strictement les mêmes, au moins les joueurs japonais n’auront-ils pas eu lieu de se chamailler pour décider quelle version était la meilleure.

NOTE FINALE : 15,5/20
Copie conforme de l’itération commercialisée en parallèle sur PC-88, cette version de Tetris présente donc fort logiquement exactement les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Du service minimum bien réalisé, en somme.
Version Sharp X1
| Développeur : Bullet-Proof Software, Inc. |
| Éditeur : Bullet-Proof Software, Inc. |
| Date de sortie : Décembre 1988 (Japon) |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Anglais |
| Support : Disquette 5,25″ |
| Contrôleurs : Clavier, joystick |
| Version testée : Version disquette |
| Configuration minimale : – |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Nouvelle fournée de Tetris, à présent pour les machines de chez Sharp, et dans le cas du X1 les choses vont une fois de plus être assez simples : c’est exactement le même jeu que sur PC-88 et PC-98. Contenu, réalisation, jouabilité, tout est identique ou presque (il est possible de jouer au joystick là où ce n’était pas permis sur PC-88), ce qui aura au moins le mérite de ne léser personne.

NOTE FINALE : 15,5/20
Nouveau portage de Tetris, et nouveau clone de la version PC-88 pour cette itération Sharp X1. Tout est toujours exactement à sa place dans une version qui n’a pas bougé d’un bit.
Version Sharp X68000
| Développeur : Bullet-Proof Software, Inc. |
| Éditeur : Bullet-Proof Software, Inc. |
| Date de sortie : 18 novembre 1988 (Japon) |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Anglais |
| Support : Disquette 5,25″ |
| Contrôleurs : Clavier, joystick |
| Version testée : Version disquette testée sur Sharp X68000 |
| Configuration minimale : – |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Sur ce qu’on pourrait considérer comme la « Rolls » des ordinateurs des années 80 (je laisse les passionnés s’écharper dans les commentaires à ce sujet), Tetris accomplit un peu la synthèse du meilleur des deux mondes : une résolution élevée (512×512, comme souvent sur la machine) alliée à une palette de couleurs conséquente. Conséquence: c’est indéniablement joli, même s’il n’y a toujours aucune modification à espérer du côté du contenu. Disons simplement que quitte à découvrir le jeu sur un système japonais, autant le faire ici, mais votre expérience de jeu ne devrait pas en être transcendée pour autant.

NOTE FINALE : 15,5/20
Si vous ne savez pas vous décider entre une résolution élevée et une palette de couleurs conséquente, alors optez directement pour Tetris sur Sharp X68000 : vous aurez les deux ! N’espérez rien de neuf du côté du contenu ou de la jouabilité, en revanche.
Tetris (Tandy Corporation)

Développeur : Greg Zumwalt
Éditeur : Tandy Corporation
Testé sur : TRS-80 CoCo
Au grand jeu des transferts de licence, Tandy aura acquis la sienne auprès de Spectrum Holobyte – ce qui explique que cette version partage à la fois son nom et sa couverture avec les versions américaines du jeu. Converti par Greg Zumwalt, cette version de Tetris est en fait assez proche de celle de 1986 : il n’y a qu’un seul décor et un seul mode de jeu, même si celui-ci impose quel que soit le niveau de difficulté de commencer avec des lignes de malus. C’est là la seule adaptation notable, le titre étant autrement identique, sur le plan du gameplay comme sur celui de l’interface, à celui de la version PC de 1986.
Version TRS-80 CoCo
| Date de sortie : Juillet 1988 |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Anglais |
| Support : Cartouche |
| Contrôleurs : Clavier, joystick |
| Version testée : Version cartouche testée sur TRS-80 CoCo3 |
| Configuration minimale : – |

Sur le plan technique, cette version de tetris présente une particularité : celle de tirer parti de la résolution « élevée » (comprendre : en 320×192) du TRS-80 CoCo3. En fait, c’est même la seule façon d’afficher le tableau de statistiques ou le résumé des touches présents respectivement à droite et à gauche de la fenêtre de jeu. Pour le reste, on ne prétendra pas être ébloui par l’unique décor du jeu, ni par les quelques couleurs qui se battent à l’écran (j’en ai compté quatre), mais l’essentiel est toujours à sa place et le système de score est le même que sur PC. Une version confidentielle à destination d’un public bien particulier de nostalgiques, un peu comme la version Amstrad PCW, mais une version qui n’en fait pas moins le travail pour autant.
NOTE FINALE : 14,5/20
En dépit de quelques petites fioritures qui auront objectivement peu de chances d’ébahir un joueur du XXIe siècle, l’édition TRS-80 CoCo de tetris n’est pas grand chose de plus que la retranscription de la version PC de 1986 avec l’ajout non-négociable de lignes de pénalité dans l’unique mode de jeu. Rien d’inoubliable, mais largement l’essentiel pour s’amuser.
Tetris (SEGA Enterprises)

Développeur : SEGA Enterprises Ltd.
Éditeur : SEGA Enterprises Ltd.
Testé sur : Arcade – Mega Drive – Arcade (Mega-tech)
Autre conséquence de la bataille juridique qui aura entouré Tetris à la fin des années 80 : SEGA, qui pensait avoir obtenu les droits en les acquérant auprès d’Atari aura eu à faire face aux mêmes problèmes que la firme américaine, et aura rapidement dû retirer de la vente la version Mega Drive du jeu, Nintendo ayant acquis l’exclusivité pour les versions sur consoles. On retrouve ici le fonctionnement du jeu de base (choisir d’afficher ou non la prochaine pièce, le mode principal) en plus de quelques nouveautés pour la version Mega Drive, parfois aperçues dans les autres versions, comme un mode deux joueurs en coopératif ou un mode « Time Trial » proposant de réaliser le score le plus élevé possible en trois minutes.
Version Arcade
| Date de sortie : Décembre 1988 (Japon) |
| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |
| Langue : Japonais |
| Support : Borne |
| Contrôleurs : Un joystick (huit directions) et un bouton |
| Version testée : Version japonaise, set 4 |
| Hardware : SEGA System 16B Processeurs : Hitachi FD1094 Encrypted CPU 10MHz ; Zilog Z80 4MHz Son : Haut-parleur ; YM2151 OPM 4MHz ; 1 canal Vidéo : 320 x 224 (H) 60Hz |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Probablement soucieux de publier sa version arcade le plus vite possible (tout comme Taito, impliqué dans la manoeuvre, et qui convertissait en urgence les bornes n’ayant pas rencontré le succès pour qu’elles hébergent le nouveau jeu qui cartonnait), SEGA sera visiblement allé à l’essentiel pour cette version de tetris : un seul mode de jeu, un seul thème musical (d’ailleurs vite répétitif, et que je suis à peu près certain d’avoir entendu ailleurs, sans doute dans une version de Columns), et juste le décor qui change à chaque niveau.

Bref, exactement la même chose que dans 90% des autres versions du jeu, au détail près qu’il n’est pas possible ici de choisir son niveau de départ et que la pièce suivante est toujours affichée – les amateurs de contenu ou d’options multijoueurs peuvent s’en aller voir ailleurs. À noter également, une borne sur System E au contenu équivalent mais à la réalisation inférieure (plus de changement de décor et résolution plus basse), pour un résultat assez équivalent sur un plan strictement ludique.

NOTE FINALE : 15,5/20
Tetris à la sauce SEGA ne fait même pas tout-à-fait aussi bien que la borne concurrente de chez Atari, n’ayant qu’un effet cosmétique à offrir en lieu et place du choix du niveau de départ et du mode deux joueurs. L’essentiel est là, le problème étant qu’il n’y a absolument rien d’autre.
Version Mega Drive
| Développeur : Sanritsu Denki Co., Ltd. |
| Éditeur : SEGA Enterprises Ltd. |
| Date de sortie : 1989 (Japon) |
| Nombre de joueurs : 1 à 2 |
| Langue : Anglais |
| Support : Cartouche |
| Contrôleur : Joypad |
| Version testée : Version japonaise |
| Spécificités techniques : Cartouche de 2Mb |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Au moment de voir Tetris débarquer (temporairement) sur sa (nouvelle) console phare, SEGA aura eu la bonne idée de laisser l’équipe de Sanritsu Denki apporter tout ce qui manquait à la borne : un peu de chair au concept ! Si la réalisation reprend très exactement les décors de la borne de 1988 en composant (plutôt bien) avec les limitations graphique de la machine, la véritable bonne nouvelle est pour une fois à aller chercher du côté des options : choix du niveau de départ, présence ou non de lignes de pénalités, possibilité d’afficher la prochaine pièce, mode deux joueurs en compétitif ou en coopératif (alors baptisé « Doubles » comme dans un certain… Columns), « Time Trial » en trois minutes… De quoi espérer rivaliser sur un marché décidément très concurentiel, ce que cette cartouche rapidement retirée de la vente n’aura hélas pas pu faire. Mais pour découvrir le jeu, c’est assurément un point de départ qui en vaut un autre.

NOTE FINALE : 16,5/20
En offrant un peu de contenu supplémentaire comme avaient commencé à le faire les versions occidentales de la même période, Tetris sur Mega Drive tire assurément son épingle du jeu. Désormais disponible en émulation ou sur Mega Drive Mini, le jeu se laisse découvrir avec plaisir, même s’il reste à destination des curieux – tous les autres ayant plus vite fait de se lancer via une des dizaines d’itérations plus récentes.
Version Arcade (Mega-Tech)
| Développeur : Sanritsu Denki Co., Ltd. |
| Éditeur : SEGA Enterprises Ltd. |
| Date de sortie : 1989 |
| Nombre de joueurs : 1 à 2 |
| Langue : Anglais |
| Support : Cartouche |
| Contrôleurs : Un joystick (huit directions) et trois boutons |
| Version testée : Version européenne |
| Hardware : SEGA Mega-Tech Processeurs : Motorola MC68000 7,670453MHz ; Zilog Z80 3,579545MHz ; Zilog Z80 3,579540MHz Son : Haut-parleur (x2) ; SEGA 315-5313 Megadrive VDP 53,693175MHz ; SEGA VDP PSG 3,579545MHz ; YM2612 OPN2 7,670453MHz ; SEGA 315-5246 SMS2 VDP 10,73862MHz ; SEGA VDP PSG 3,57954MHz ; 2 canaux Vidéo : 256 x 224 (H) 59.922738 Hz (x2) |

Par souci d’exhaustivité, autant en profiter pour évoquer rapidement « l’autre » version arcade du jeu, celle qui aura (très brièvement) fleuri sur les systèmes Mega-tech. Les choses vont aller vite : il s’agit ici de la retranscription parfaite de la version Mega Drive, sans la moindre forme d’adaptation au-delà du fait de payer pour du temps de jeu. De quoi découvrir la console dans de bonnes conditions, d’autant que cette version était meilleure que la borne d’arcade de SEGA qui se trouvait peut-être encore à proximité.
NOTE FINALE : 16,5/20
À version équivalente, constat équivalent : ce Tetris en version Mega-tech ne sera peut-être pas resté très longtemps dans les salles (à supposer qu’il y soit arrivé un jour), mais il l’aurait mérité.
Tetris (Nintendo)

Développeur : Nintendo R&D1
Éditeurs : Nintendo Co., Ltd. (Japon) – Nintendo of America Inc. (Amérique du Nord) – Nintendo of Europe GmbH (europe)
Testé sur : Game Boy – NES
S’avisant en 1988 du succès déjà international de Tetris, Nintendo eut également une inspiration que l’on pourra qualifier de géniale : celle de considérer que le jeu constituerait un titre de lancement idéal pour sa future console portable alors encore en préparation : la Game Boy. Mandaté par le président de Nintendo, hiroshi Yamuachi, Henk Rogers s’envole alors pour récupérer les droits auprès d’Atari et débuter une bataille juridique dont la firme japonaise ressortira victorieuse. Le reste fait partie de l’histoire : la Game Boy s’écoulera trois fois mieux que ce que prédisaient ses prévisions de ventes les plus optimistes, et la cartouche de Tetris n’y sera pas pour rien, se vendant au final à plus de trente millions d’exemplaires. La version NES, avec ses cinq millions d’exemplaires vendus, ne sera pas en reste, mais c’est généralement la version Game Boy qui demeure dans les esprits comme « la » version qui aura permis à tout le monde de découvrir le jeu.
Version Game Boy
| Date de sortie : 14 juin 1989 (Japon) – 31 juillet 1989 (Amérique du Nord) – 28 septembre 1990 (Europe) |
| Nombre de joueurs : 1 à 2 (avec deux consoles reliées par un câble Game Link) |
| Langue : Anglais |
| Support : Cartouche |
| Contrôleur : Console |
| Version testée : Version 1.1 internationale |
| Spécificités techniques : Cartouche de 256kb |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Pour fêter son arrivée sur Game Boy, Tetris débarque avec… eh bien, pas grand chose de neuf, pour être honnête. Le mode de jeu principal s’accompagne ici d’un nouveau consistant à effectuer le meilleur score possible en 25 lignes, et il est possible de choisir son niveau de départ comme d’ajouter des lignes de pénalité dans les deux cas. Les thèmes musicaux du jeu seront sans doute resté dans la tête de plusieurs millions de joueurs, mais le véritable apport de cette cartouche est aussi le plus surprenant pour la période : c’est le fameux mode deux joueurs. Contrairement à ce qui avait été observé dans les version de Tengen, où le mode compétitif n’était pas grand chose de plus que deux joueurs pratiquant le jeu tout seul dans leur coin, cette version introduit l’idée qui deviendra la clef de concepts à la Puyo Puyo un peu plus tard : celle que chaque ligne réalisée par un joueur se transforme en une ligne de pénalité pour l’autre. Et ça change tout ! Évidemment, il faut avoir deux consoles et l’indispensable câble de liaison, mais quitte à découvrir cette version, c’est clairement via ce mode qu’elle prend tout son intérêt.

NOTE FINALE : 16,5/20
Version NES
| Développeur : Nintendo Co., Ltd. |
| Éditeur : Nintendo Co., Ltd. |
| Date de sortie : Novembre 1989 (Amérique du Nord) – Octobre 1990 (Europe) |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Anglais |
| Support : Cartouche |
| Contrôleur : Console |
| Version testée : Version européenne |
| Spécificités techniques : Cartouche de 384kb |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Après la version commercialisée au Japon par Bullet-Proof Software, Nintendo aura décidé de prendre le taureau par les cornes au moment de distribuer Tetris sur le marché occidental et de débarquer avec… euh, pas grand chose de neuf comparé à la version Famicom, en fait. Certes, le mode « B » de la Game Boy a bien fait le trajet jusqu’à cette version, mais ce n’est pas le cas des lignes de pénalité et surtout du mode deux joueurs, qui était pourtant le plus intéressant du lot ! sachant qu’en plus la réalisation n’est même pas spécialement emballante, avec des pièces toutes de la même couleur et un décor qui ne change jamais, on va dire que ce n’est pas la version qu’on relancera aujourd’hui avec le plus de plaisir – sauf nostalgie, évidemment – et qu’il aurait mieux valu pour les joueurs que la version de Tengen reste commercialisée. Bon, tant pis.

NOTE FINALE : 15,5/20
Nintendo aura fait le choix de ne pas porter sur NES la plupart des ajouts les plus intéressants de la version Game Boy de Tetris, à commencer par son mode deux joueurs. En résulte une version générique avec très peu de nouveautés à offrir, et une réalisation un peu triste. Correct, mais pas inoubliable.
Tetris (Philips P.O.V. Entertainment Group)

Développeur : Philips P.O.V. Entertainment Group
Éditeur : Philips Interactive Media Systems
Testé sur : CD-i
Reconnaissons au moins un autre mérite aux succès planétaires comme tetris : celui de nous permettre de nous remémorer l’existence de systèmes comme le CD-i. Probablement débarqué comme la valeur sûre à ajouter à n’importe quelle ludothèque (à raison, d’ailleurs), le titre aura ici fait le choix de tout placer dans la réalisation plutôt que dans le contenu, ce qui est hélas un assez bon résumé de ce qui aura fini par plomber la machine de Philips à court-terme. En 1992, Tetris n’avait plus grand chose de nouveau aux yeux de quiconque, et s’il y avait peut-être de quoi fasciner mémé, le joueur moyen retiendra surtout l’absence totale de nouveauté du côté des modes de jeu comparé à la version américaine de 1988.
Version CD-i
| Date de sortie : 1992 |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Anglais |
| Support : CD-ROM |
| Contrôleur : Télécommande |
| Version testée : Version européenne |
| Spécificités techniques : – |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Tetris sur CD-i, c’est un peu la victoire du superflu. En termes de contenu, les choses sont très simples : rien d’autre à espérer que le mode principal, en solo, avec le choix du niveau de départ et la possibilité d’ajouter des lignes de pénalité et rien d’autre. C’est donc la même chose que dans la version de Spectrum Holobyte parue quatre ans plus tôt. Seule nouveauté (et encore) ? Chaque niveau possède désormais son propre décor à base de photo digitalisée et animée, ainsi que son propre thème musical qui semble tout droit tiré d’un best-of des meilleures musiques d’ascenseur libres de droits. Autant dire que cela restait un peu léger pour promouvoir le coûteux système à l’époque, surtout quand les autres machines accueillaient déjà des versions du jeu un peu plus avancées, mais bon, cela reste au moins aussi correct que ce à quoi on pouvait jouer sur Amiga.

NOTE FINALE : 16/20
Si vous désirez jouer à une version de Tetris qui n’est fondamentalement pas grand chose de plus que la version de Spectrum Holobyte de 1988 avec de jolies images et de la musique qui rende tangible le concept de mauvais goût, cette itération CD-i représente un peu le pinacle technique d’un concept qui avait hélas oublié d’évoluer en quatre ans.
Tetris Classic

Développeur : Spectrum Holobyte, Inc.
Éditeur : Spectrum Holobyte, Inc.
Testé sur : PC (DOS/Windows 3.x)
Quatre ans après la première sortie internationale de Tetris, le monde vidéoludique avait déjà bien changé, et c’était particulièrement vrai pour le système qui avait accueilli le jeu dès l’instant où il avait daigné s’évader de l’Académie des sciences de l’U.R.S.S., à savoir le PC. Spectrum Holobyte décida donc que le moment était bien choisi pour ressortir le jeu sur la machine d’IBM, mais en profitant cette fois de tout ce dont elle manquait en 1988, à savoir des capacités graphiques et sonores de pointe. Comme on s’en doute, l’idée est donc moins de révolutionner le concept de base – même si cette version en profite pour intégrer quelques nouveautés apparues entretemps, à commencer par le mode deux joueurs – que de l’offrir dans un enrobage plus soigné. Hé, tant qu’à découvrir le programme, il n’y a pas de raison qu’il soit moche, non ?
Version PC (DOS/Windows 3.x)
| Date de sortie : Septembre 1992 |
| Nombre de joueurs : 1 à 2 |
| Langue : Anglais |
| Supports : Disquette 5,25″ et 3,5″ |
| Contrôleurs : Clavier, joystick, souris |
| Version testée : Version disquette émulée sous DOSBox |
| Configuration minimale : Version DOS : Processeur : Intel 8088/8086 – OS : PC/MS-DOS 3.0 – RAM : 640 ko Modes graphiques supportés : EGA, Tandy/PCjr, VGA Cartes sons supportées : AdLib, haut-parleur interne, Pro Audio Spectrum, Roland MT-32/LAPC-I, Sound Blaster/Pro, Tandy/PCjr, Thunderboard Versions Windows 3.x : Processeur : Intel 80286 – OS : Windows 3.0 – RAM : 2 Mo Modes graphiques supportés : SVGA, VGA |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Quitte à signer son grand retour sur PC, Tetris Classic décide donc d’y mettre les formes. Comme on peut s’en douter, ce ravalement de façade n’est pas forcément ce qui fascinera le plus le joueur du XXIe siècle, qui en a vu d’autres, mais on ne pourra malgré tout qu’apprécier de bénéficier de décors colorés et détaillés changeant à chaque niveau, en 320×200 ou en 640×480 sur la version Windows, laquelle profite pour l’occasion des la gestion du mode amélioré des 386.

La musique et les effets sonores bénéficient des capacités d’à peu près toutes les cartes sons de l’époque, offrant un peu plus matière à ravir les oreilles, même si on ne peut pas dire que les thèmes musicaux soient très marquants (au moins font-il l’effort de sortir des éternels thèmes d’inspiration russe des autres versions). La meilleure nouvelle, cependant, est à trouver du côté du contenu : mode illimité ou chronométré, mode deux joueurs coopératif ou compétitif, sur une seule fenêtre ou sur deux : il y a enfin un peu de matière, surtout si on a un ami sous la main. Pour ne rien gâcher, les options de configuration sont également très nombreuses : choix du niveau de départ pour chaque joueur, mais aussi choix du handicap, de la présence ou non de lignes de pénalités en cas de combinaison adverse, savoir si les deux joueurs bénéficieront ou non des mêmes pièces, etc : à ce niveau là, le dépoussiérage est encore plus sensible que sur le plan technique, ce qui fait de cette version PC l’une des meilleures de toutes.

NOTE FINALE : 17/20
Quitte à remettre la réalisation au goût du jour, ce Tetris Classic aura surtout eu la bonne idée de revoir également le contenu, et le résultat fait plaisir à voir. La refonte graphique et sonore, appréciable, n’en est pas moins qu’un simple à-côté de la pléthore d’options de configuration et de modes de jeu, particulièrement à deux. De quoi passer des heures sur un jeu qui n’a pas pris une ride.
Tetris & Dr. Mario

Développeur : Nintendo Co. Ltd.
Éditeurs : Nintendo Co., Ltd. (Japon) – Nintendo of America, Inc. (Amérique du Nord) – Nintendo of Europe GmbH (Europe)
Testé sur : Super Nintendo
Quitte à capitaliser sur ses vieux succès, Nintendo aura décidé en 1994 de sortir une compilation exclusive de ses deux meilleurs puzzle games de la génération 8 bits dans une version remise au goût du jour pour la Super Nintendo. Bien que cette compilation propose un remake des deux jeux et un mode « Mix and Match » alternant les deux programmes, c’est surtout Tetris qui va nous intéresser ici. Le jeu est proposé pour l’occasion dans une version NES « dépoussierée », que ce soit au niveau de la réalisation, naturellement plus colorée, mais aussi du contenu, le jeu intégrant enfin le mode deux joueurs présent dans l’itération Game Boy, mais aussi et surtout un petit inédit, comme on va le constater.
Version Super Nintendo
| Date de sortie : 30 décembre 1994 (Amérique du Nord) – Mars 1995 (Europe) |
| Nombre de joueurs : 1 à 2 |
| Langue : Anglais |
| Support :Cartouche |
| Contrôleur : Joypad |
| Version testée : Version européenne |
| Spécificités techniques : Cartouche de 8Mb |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Tetris revient, et comme la version NES commençait malgré tout à accuser un petit coup de vieux, Nintendo aura décidé de briquer un peu ce portage pour lui rendre l’éclat du neuf. la refonte graphique, pour anecdotique qu’elle soit (toujours aucune illustration en guise de décor), n’en fait pas moins un bien fou en offrant enfin la couleur qui manquait à la très triste version originale : désormais englouti sous les teintes acidulées, le joueur a un peu moins l’impression de revivre en boucle un froid matin d’hiver.

Néanmoins, l’ajout véritablement salutaire est celui du mode deux joueurs, enfin praticable sur la même console, et surtout l’opportunité… de jouer contre l’ordinateur, pour ceux qui n’auraient pas un ami sous la main ! Pour l’occasion, il est non seulement possible de choisir entre trois niveaux de difficulté pour l’I.A., mais également de choisir un univeau de départ différent pour les deux joueurs, ce qui devrait permettre à tout le monde de trouver l’équilibrage adéquat. Évidemment, en 1994, on commençait vraiment à toucher là au service minimum face aux autres versions disponibles rien que sur la console, mais cette cartouche n’en contient pas moins le nécessaire pour passer un bon moment, seul ou à deux.

NOTE FINALE : 16,5/20
Ressorti des tiroirs à une époque où des Super Tetris 3 ou des Tetris Battle Gaiden avaient déjà bien plus de choses à offrir, cette itération dépoussiérée de Tetris vendue avec Dr. Mario n’en offre pas moins des ajouts salutaires permettant de s’attaquer au mode deux joueurs même en l’absence d’un ami. De quoi trouver un attrait intact à cette cartouche.
Superlite 1500 Series : The Tetris

Développeur : Success Corp.
Éditeur : Success Corp.
Testé sur : PlayStation
Tetris étant un concept increvable, il semblait tout désigné pour finir dans la collection Superlite 1500, série de titres vendus à bas prix par Success sur PlayStation, exclusivement au Japon. Pour l’occasion, le point de départ est une nouvelle fois le jeu de base d’Alexei Pajitnov, avec une série d’ajouts que la date de publication tardive (en 2000) commençait à rendre indispensables. On notera cependant que si un mode deux joueurs est bel et bien disponible, il est ici impossible d’affronter l’intelligence artificielle.
Version PlayStation
| Date de sortie : 19 juillet 2000 (Japon) |
| Nombre de joueurs : 1 à 2 |
| Langue : Anglais |
| Support :CD-ROM |
| Contrôleur : Joypad |
| Version testée : Version japonaise |
| Spécificités techniques : Système de sauvegarde par carte mémoire (1 bloc) |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Inutile de s’attendre au grand jeu pour un titre sorti en gamme budget sur une PlayStation en fin de vie : le Tetris dont il est question ici n’est pas grand chose de plus que l’équivalent de la version Game Boy parue onze ans plus tôt avec une refonte graphique, et la disparition du mode B. Les options se limitent au choix du niveau de départ (par incréments de cinq, jusqu’à trente), et basta, et ce sera mode solo ou jeu à deux en compétitif sans laisser à l’I.A. le soin de remplacer un joueur. Tant qu’à faire, on hérite de décors qui n’éblouiront personne mais qui ont le mérite d’exister, et de thèmes musicaux particulièrement oubliables, mais cela n’empêche pas cette édition de contenir l’essentiel pour découvrir le titre sans avoir à s’embarasser de fioritures.

NOTE FINALE : 16,5/20
Version volontairement datée proposée à petit prix, The Tetris n’en offre pas moins les bases indispensables de ce qu’un joueur était en droit d’attendre : un mode solo inépuisable, un mode deux joueurs efficace et une réalisation adéquate. Quelques options de configuration n’auraient pas fait de mal, mais bon, il fallait bien continuer de vendre les autres épisodes de Tetris à côté…