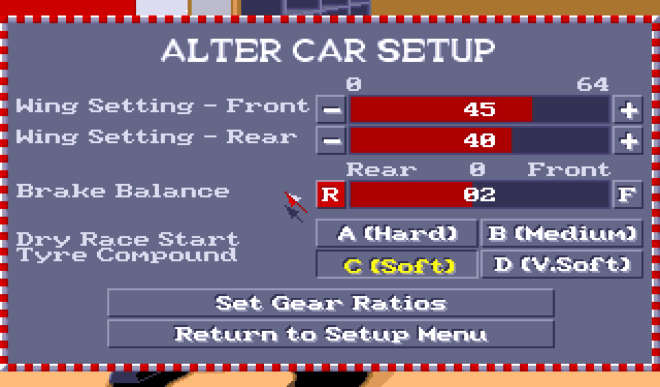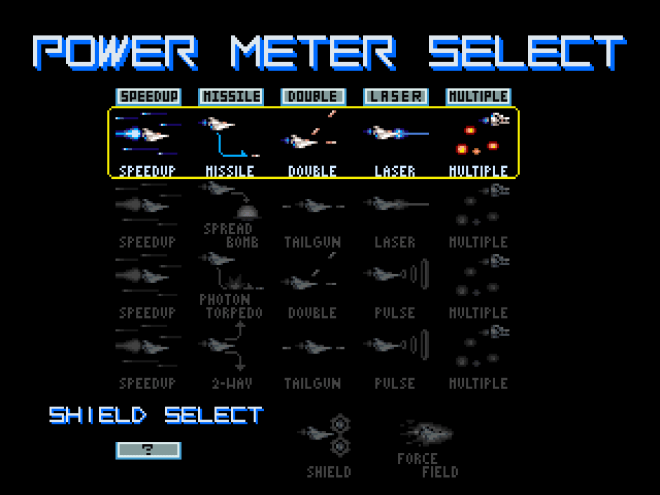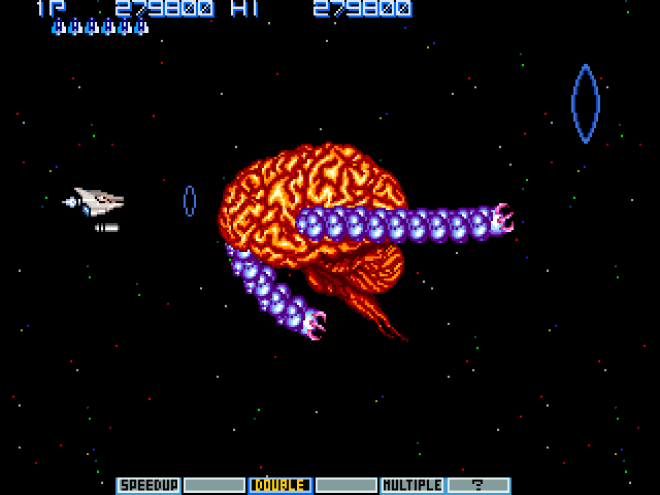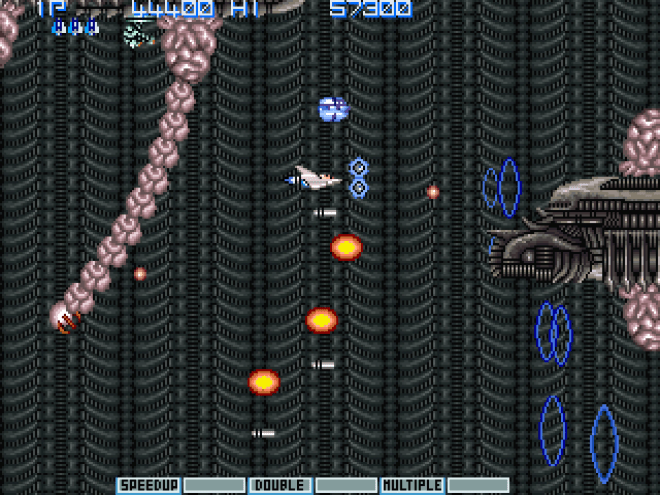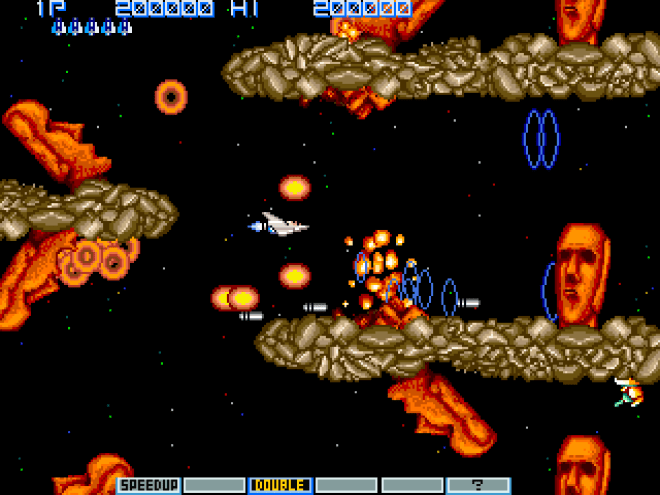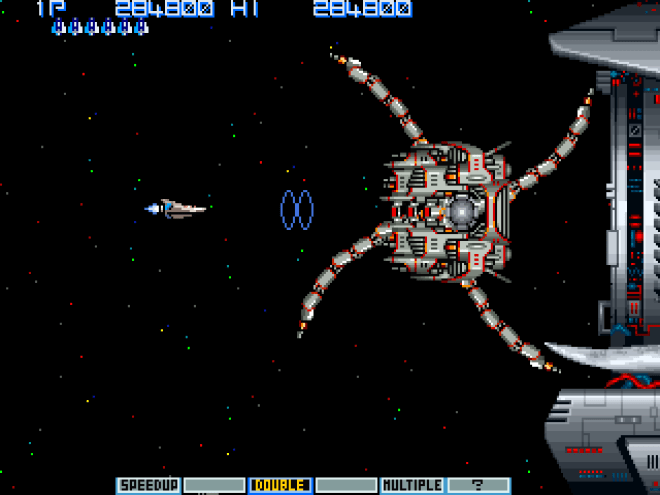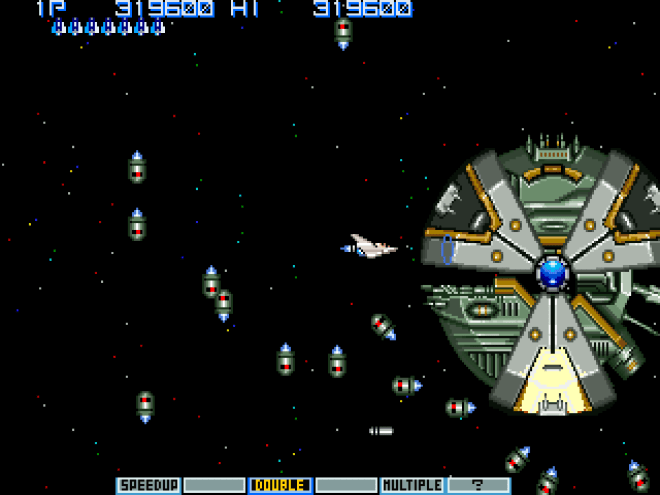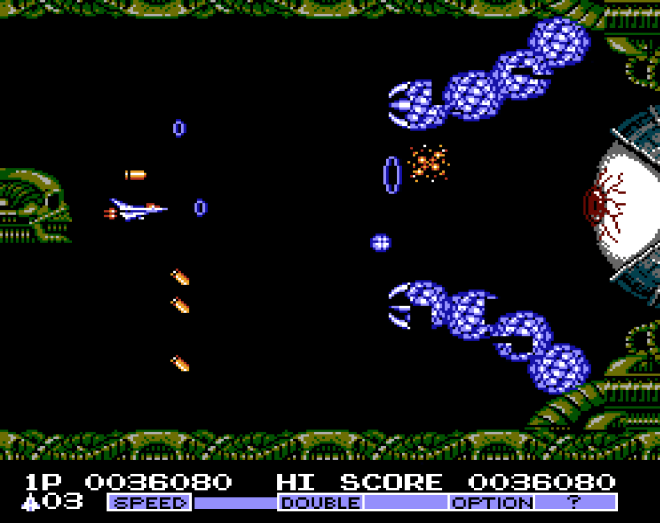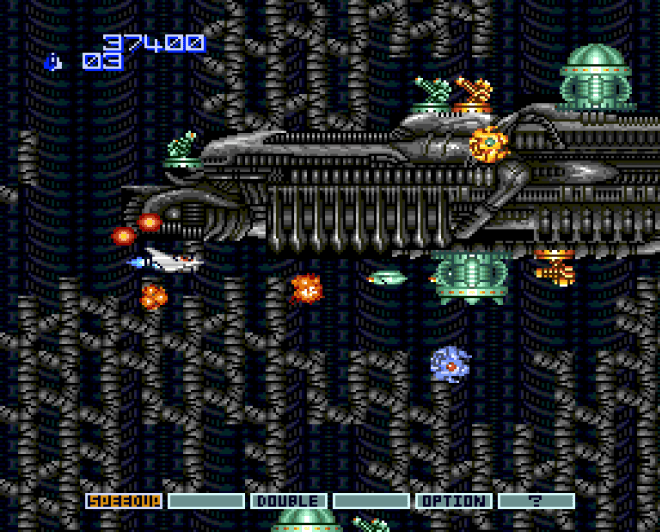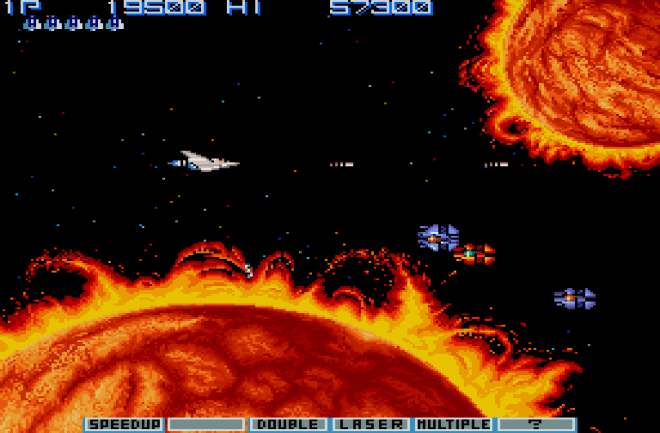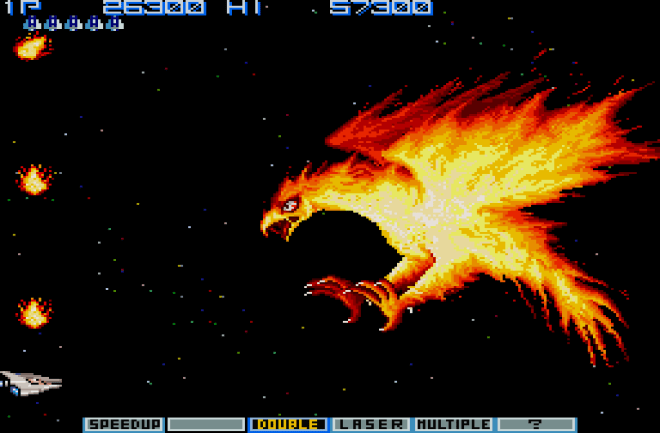Développeur : Burst
Éditeur : Virgin Interactive Entertainment (Europe) Ltd.
Testé sur : PC (Windows 9x)
Disponible sur : Linux, Macintosh, Windows
En vente sur : GOG. com
Version PC (Windows 9x)
| Date de sortie : Novembre 1996 |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langues : Allemand, anglais, français (version française intégrale) |
| Support : CD-ROM, dématérialisé |
| Contrôleurs : Clavier, souris |
| Version testée : Version dématérialisée émulée sous ScummVM |
| Configuration minimale : Processeur : Intel 80486 DX2 – OS : MS-DOS 5.0 – RAM : 8Mo – Vitesse lecteur CD-ROM : 2X (300ko/s) Modes graphiques supportés : SVGA, VESA, VGA Cartes sonores supportées : AdLib/Gold, chipset ARIA, Ensoniq Soundscape, ESS Audiodrive, General MIDI, Gravis UltraSound/Ace, I/O Magic Tempo, Microsoft Sound System, Pro Audio Spectrum, Reveal FX/32, Roland MT-32/LAPC-I/RAP-10, Sound Blaster/Pro/16/AWE 32, Sound Galaxy NX Pro 16, Thunderboard, Toptek Golden 16, Wavejammer |
Vidéo – L’introduction et l’écran-titre du jeu :
Aussi surprenant que cela puisse paraître, je serai parvenu à isoler au moins deux points communs entre le marketing et l’humour : l’un comme l’autre reposent dramatiquement sur une science du timing ainsi que sur une certaine capacité à saisir l’air du temps. Deux aspects qui, mal maîtrisés, peuvent au contraire rapidement virer à la tragédie. Vous en voulez un exemple ? Alors laissez-moi vous raconter l’histoire d’un jeu auquel vous n’avez probablement jamais joué.

Octobre 1993. Le point-and-click est au sommet de sa gloire. Alors que toutes les rédactions journalistiques se battent pour savoir s’il faut récompenser Day of the Tentacle ou Simon the Sorcerer à l’issue d’un cru exceptionnel, on s’attelle déjà à accueillir Sam & Max en s’enivrant des possibilités annoncées par Myst. Bref, à ce moment précis, l’aventure est reine, elle place des étoiles dans les yeux des joueurs, et on est encore loin de se douter qu’elle est en fait à un tournant de son histoire qui correspond à l’amorce d’une longue agonie. À tel point qu’une des équipes internes de Virgin Interactive se dit que le moment est parfaitement choisi pour lancer un projet d’une ambition rare, mêlant acteurs réels et animation 2D comme l’avait si bien fait Qui veut la peau de Roger Rabbit ? cinq ans plus tôt.

Et justement, pour bien s’inscrire dans une ère où le jeu vidéo commençait à prétendre pouvoir rivaliser avec le cinéma, quoi de plus parlant que d’aller chercher un acteur comme Christopher Lloyd, à l’affiche de ce même Roger Rabbit mais avant tout immortalisé par son rôle de Doc Brown dans Retour vers le futur ? Sur le papier, le succès est immanquable. Dans les faits, après avoir coûté la bagatelle de huit millions de dollars (un budget colossal pour l’époque), le jeu sera sorti en 1996 dans une indifférence polie, les joueurs étant alors massivement obnubilés par la 3D. Bide commercial, Toonstruck – car c’est le nom du projet en question – ne verra jamais la suite annoncée par sa fin ouverte entamer son développement, et aura au final largement contribué à mener Virgin Interactive Entertainment vers sa perte, sans doute pour être sorti deux ou trois ans trop tard par rapport au marché qu’il visait. Le timing et l’air du temps, je vous dis…

Bien, mais nous sommes à présent dans un XXIe siècle largement entamé, loin des considérations commerciales de l’époque. Et la vraie question qui nous intéresse aujourd’hui est la suivante : Toonstruck mérite-t-il d’être joué ? Pour y répondre, commençons par nous pencher sur l’introduction, visible en ouverture du test.

On y découvre donc un loser incarné par Christopher Lloyd et nommé Marc Blanc (la blague de son nom original, Drew Blank, étant pour l’occasion rendue tant bien que mal en français), sommé de dessiner une énième cargaison de petits lapins mignons pour un show intitulé « Les amis de Dorothée » (on se doute que la référence vient de la VF) qui l’emploie depuis dix ans. Car Marc est un dessinateur sur le retour qui avait autrefois rêvé de devenir le nouveau Walt Disney grâce à son personnage, Flux Radieux… et qui se retrouve désormais dramatiquement en panne d’inspiration au moment de créer de nouveaux personnages sans âme pour respecter sa deadline placée au lendemain matin. Seulement voilà, un événement imprévu le transporte dans son propre univers animé, où il apprend qu’un personnage néfaste nommé fort logiquement Néfarius est en train de transformer les toons mignons en monstruosités à l’aide d’une machine nommée « perfidificateur ». Pour recevoir l’aide du bon roi Hilarius, Marc devra donc commencer par trouver les éléments permettant de bâtir un « mignonnificateur » afin de contrer les effets de la machine de Néfarius, avant de se voir accorder le moyen de rentrer chez lui.

















Le jeu prend donc sans surprise la forme d’un point-and-click des plus classiques. L’interface est d’une simplicité à pleurer : votre curseur adoptera de lui-même la forme appropriée à chaque action sans que vous ayez besoin de lui indiquer la marche à suivre, un inventaire illimité fera rapidement son apparition en bas à gauche, et selon la philosophie popularisée par Ron Gilbert chez LucasArts, il est impossible de mourir ou de se retrouver irrémédiablement bloqué.

On pourrait d’ailleurs penser que le côté « guidé » de l’interface pourrait rendre le jeu trop simple : rassurez-vous tout de suite, il n’en est rien. Car pendant la vingtaine, voire la trentaine d’heures que devrait vous demander le titre pour voir sa (longue) séquence de fin, il faudra surmonter des énigmes à la logique réelle mais pas toujours évidente, composer avec des situations loufoques, dompter quelques mini-jeux, aligner des dialogues bien évidemment absurdes, et comprendre des associations d’idées heureusement parfaitement rendues par une version française d’une qualité rare.

Commençons par le premier contact : la réalisation en SVGA est clairement difficile à prendre en défaut. Le jeu pullule de séquences animées intégrant Christopher Lloyd et dont la qualité d’animation professionnelle (très loin au-dessus de titres à la King’s Quest VII) fait réellement plaisir à voir.

Découvrir l’univers de Toonstruck revient à se déplacer entre trois mondes : Mignonnia, Perfidia et Zanydu, qui déploient chacun leur propre humour en ne résistant hélas pas toujours à la tentation de verser dans la facilité et dans le graveleux, mais avec néanmoins de très nombreux morceaux de bravoures dont certains devraient bien parvenir à vous faire vous bidonner à un moment ou à un autre. On est réellement face à un univers à mi-chemin entre Roger Rabbit et Cool World, et il est difficile de ne pas développer une affection réelle pour certains lieux ou personnages, ni de ne pas se féliciter de la qualité globale de l’écriture qui réserve quelques dialogues savoureux et authentiquement bien vus. Le tout bénéficiant d’ailleurs d’une version française de qualité professionnelle menée avec maestria, et qui mérite que je me penche sur elle pendant au moins quelques lignes.

Continuons donc en saluant l’évidence : la qualité du doublage. Première bonne nouvelle : on a mobilisé les professionnels, et on n’est pas allé chercher les plus mauvais. Christopher Lloyd retrouve Pierre Hatet, sa voix française jusqu’à 2015 (Pierre nous a hélas quittés en 2019), et son timbre hyper-caractéristique qui aura également habité des personnages comme Cortex ou le Joker est toujours un véritable régal à entendre.

Autour de lui, c’est une vraie équipe de choc, avec notamment Luq Hamet – qui lui avait déjà donné la réplique en doublant Michael J. Fox dans Retour vers le futur ou Roger Rabbit dans le film éponyme – dont les quadragénaires se souviendront comme de l’animateur interprétant tous les personnages du Hanna-Barbera dingue-dong sur Antenne 2 dans les années 90. Signalons également Richard Darbois (voix française d’Harrison Ford) dans le rôle de Néfarius, ou Daniel Beretta (voix française d’Arnold Schwarzenegger) dans celui d’un chien culturiste, sans oublier Gilbert Lévy (Les Simpson) dont vous pourrez entendre la voix dès l’introduction, dans le rôle du patron de Marc Blanc, avant de le retrouver à plusieurs reprises en jeu. Sans même mentionner Micheline Dax, Michel Elias ou Annabelle Roux – de très bons acteurs qui ont en plus le mérite d’être bien dirigés, ce qui fait que les erreurs d’intention sont rares et que chaque dialogue est généralement un aussi grand moment que ce qu’on était en droit d’espérer.

Il serait néanmoins criminel de ne pas évoquer la qualité de la traduction en elle-même, qui se met littéralement en quatre pour retranscrire les nombreux jeux de mot de la V.O. et même en placer de nouveaux au détour de la moindre phrase.

Non seulement ceux-ci sont souvent excellemment trouvés, mais la localisation a même poussé le travail jusqu’à traduire les textes figurant dans le décor – le genre de luxe qui reste exceptionnel même aujourd’hui, où changer le texte d’une texture est pourtant infiniment plus facile que de redessiner une image ! Je confesse ainsi m’être esclaffé en lisant les grades de puissance de la machine à tester la force située dans la salle d’arcade, et m’être délecté de quelques uns des jeux de mot qui ne font certes pas tous mouche, mais l’effort est si considérable qu’on ne peut qu’applaudir. En y ajoutant une très bonne transcription des références culturelles (la simple présence d’une Dorothée devrait à ce titre être parlante, parmi des dizaines d’autres), on sent un travail fait avec amour par une équipe qui s’est vraiment creusé la tête, et ça fait plaisir. À ce niveau-là, le bilingue que je suis ne donnera pour une fois pas dans le pédantisme de mauvais aloi : jouez à Toonstruck en français, clairement !

Alors certes, tout n’est pas encore parfait dans l’univers animé du jeu : certaines énigmes sont tirées par les cheveux, d’autres sont franchement fastidieuses (ah, ce maudit téléphone à couleurs avec ses « numéros » à recomposer à chaque fois…), sans parler de celles qui ne sont tout simplement pas très inspirées (oh, un taquin, ça c’est original… ah, un jeu de mémoire, avec une séquence de pas moins de ONZE mouvements à retenir, super…).

Dans l’ensemble, il peut arriver qu’on soupire à force de tourner en rond et de ne plus trop savoir quoi faire, comme c’est souvent le cas avec ce type de jeu. Mais bon sang, il y a tellement de bons moments, de dialogues savoureux, d’animations délectables et d’idées grandioses qu’on peut bien pardonner quelques passages plus convenus ou quelques gags ratés ! De fait, si vous aimez les jeux d’aventure, pour moi le verdict est clair : il faut avoir joué à Toonstruck. Vous ne vivrez pas nécessairement un rêve éveillé d’un bout à l’autre, surtout si l’humour ne prend pas, mais il sera difficile de ne pas déceler une bonne partie des qualités évidentes d’un titre qui risque de faire chauffer vos méninges à plusieurs reprises. Pour tous les amateurs de Roger Rabbit, des Tiny Toons, de Tex Avery ou de Christopher Lloyd, faire l’impasse sur le jeu serait encore plus regrettable, à moindre d’être vraiment hermétique au genre du point-and-click. Parce qu’on tient à coup sûr un logiciel qui serait à n’en pas douter entré définitivement dans la légende s’il était simplement sorti quelques années plus tôt. À découvrir, et je serais vraiment surpris que vous puissiez le regretter.



























Vidéo – Quinze minutes de jeu :
NOTE FINALE : 17,5/20 Sorte d'équivalent vidéoludique de Qui veut la peau de Roger Rabbit ?, avec nul autre que Christopher Lloyd à l'affiche, Toonstruck est un jeu comme on n'en verra sans doute plus jamais, fruit d'une époque où une ambition sans limite se heurtait souvent aux cruelles contraintes de la réalité. Sorti à une période où les joueurs avaient largement déserté les point-and-click, le titre de Burst est passé tragiquement sous les radars d'un public qui le regardait déjà comme un vestige un peu dépassé de l'ancien monde. Pourtant, entre une réalisation inattaquable, un univers plein de charme, une aventure prenante, un humour qui fait souvent mouche et une version française de haute volée, Toonstruck est un logiciel qui mérite indéniablement une deuxième chance d'aller revendiquer sa place, vraiment pas très loin de titres comme Curse of Monkey Island ou Day of the Tentacle, et largement à la hauteur de jeux à la Discworld. Si vous êtes passé à côté à sa sortie - ou que vous n'en avez jamais entendu parler - alors laissez-vous tenter. Vous pourriez bien passer un très, très bon moment.
CE QUI A MAL VIEILLI : – Un humour qui tombe parfois dans la facilité, pour ne pas dire dans le lourdingue – Quelques énigmes franchement fastidieuses (le concours des Trois Belges...)
Bonus – Ce à quoi peut ressembler Toonstruck sur un écran cathodique :