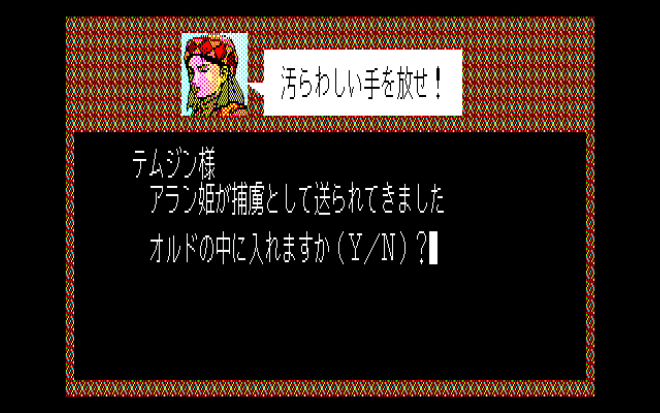Développeur : The Bitmap Brothers
Éditeur : Image Works
Titres alternatifs : Speedball 2 (Master System, Mega Drive – Europe) – Speed Ball II (PC, édition Kixx)
Testé sur : Atari ST – Amiga – Commodore 64 – Mega Drive – PC (DOS) – Game Boy – Master System – Acorn 32 bits – Amiga CD32
Disponible sur : Antstream, BlackBerry, Game Boy Advance, J2ME, Windows Mobile, Xbox 360 – Figure au sein de la ludothèque pré-installée du A500 Mini, du C64, du C64 Mini et du VIC20
Présent au sein des compilations :
- The Top League (1991 – Amiga, Atari ST)
- The Bitmap Brothers Volume I (1992 – Amiga, Atari ST, PC (DOS))
- Fun Radio La Compil Micro 2 (1992 – Amiga, Atari ST, PC (DOS))
- The Bitmap Brothers Compilation (1995 – PC (DOS))
- The Bitmap Brothers Collection 1 (2021 – Evercade)
Les remakes/remasters :
- Speedball 2 : Tournament (2007 – Windows)
- Speedball 2 : Evolution (2011 – Android, iPad, iPhone, PlayStation 3, PSP)
- Speedball 2 HD (2013 – Windows)
La série Speedball (jusqu’à 2000) :
- Speedball (1988)
- Speedball 2 : Brutal Deluxe (1990)
- Speedball 2100 (2000)
Version Atari ST
| Date de sortie : Décembre 1990 |
| Nombre de joueurs : 1 à 2 |
| Langue : Anglais |
| Support : Disquette 3,5″ double-face |
| Contrôleur : Joystick |
| Version testée : Version disquette testée sur Atari 1040 STe |
| Configuration minimale : RAM : 512ko Écran couleur requis |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Un deuxième opus, pour un jeu vidéo, c’est un peu comme un deuxième film dans une trilogie STAR WARS : l’occasion de capitaliser sur tout ce qui avait marché la première fois pour l’emmener jusqu’à un autre niveau… ou bien l’occasion de tout mettre par terre. Ce n’est sans doute pas un hasard si beaucoup de jeux marquants bénéficient d’un gros « II » dans leur nom : Street Fighter II, on s’en souvient, a totalement annihilé le souvenir de son prédécesseur, et il serait intéressant de savoir combien de nostalgiques, parmi ceux qui vous évoquent Xenon 2 avec une larme au coin de l’œil, ont un jour touché au premier épisode – sans doute assez peu.

Dans le cas de Speedball 2 : Brutal Deluxe, le suspense est éventé d’entrée de jeu : on aborde peut-être là le plus célèbre des titres développés par le plus célèbre des studios londoniens, à une époque où les Bitmap Brothers semblaient touchés par la grâce. À peu près tous les joueurs ayant possédé un Atari ST ou un Amiga à un moment de leur vie vous évoqueront le titre avec des trémolos dans la voix et le regard à l’horizon, mais la grande question est surtout de savoir si, pour un joueur du XXIe siècle biberonné à coups de séries sportives à la FIFA, la magie opère toujours, ou bien si ce Speedball 2 n’est, comme beaucoup de souvenirs, quelque chose qui n’est vraiment beau que dans la mémoire de ceux qui l’évoquent.

L’introduction place le cadre : gangréné par la violence et la corruption, le Speedball a fini par sombrer. Heureusement, il renait sous la forme du Speedball 2, un sport… encore plus violent, mais bon, apparemment c’était la corruption qui posait problème. Qu’importe : le menu est déjà dans le titre, et aussi dans le sous-titre : « Brutal Deluxe », c’est le nom d’une nouvelle équipe qui sera obligatoirement celle que vous incarnerez, et que vous chercherez à mener à la gloire – c’est d’ailleurs la première nouveauté du jeu, et elle n’est pas aussi anecdotique qu’elle en a l’air.

En plus des modes de jeu « traditionnels » du premier épisode (le mode « knockout » vous demande de vaincre des équipes de plus en plus difficiles à la suite en s’achevant à votre première défaite et le mode « cup » correspond à un tournoi à huit équipes), on remarquera en effet que le mode « Season » a été remplacé par un mode « League », lequel vous demandera de prendre les rênes de la fameuse équipe, au fin fond de la deuxième division, pour la mener jusqu’au titre suprême. Où est la différence, me demanderez-vous ? Eh bien cette équipe, il va falloir la gérer, et pas uniquement sur le terrain.

Il n’y a peut-être plus de corruption des arbitres, dans Speedball 2, mais c’est toujours l’argent qui fait tourner la machine. Et il aura ici une utilité très pragmatique : vous commencez n’importe quel mode de jeu avec une équipe de bras cassés ayant les valeurs les plus faibles dans toutes les caractéristiques du jeu (agressivité, endurance, vitesse, intelligence… huit au total), et il vous appartiendra donc d’investir entre les matchs pour équiper et entraîner vos joueurs afin de les rendre un peu plus compétitifs – voire pour en recruter de nouveaux, car vos joueurs de départ ont leurs limites, et même avec un investissement maximal, il sera très compliqué de leur faire toucher les étoiles.

Il y a donc un aspect « montée en puissance », que les amateurs de titres à la Blood Bowl ont pu apprendre à apprécier depuis lors, pleinement assumé dans le jeu. Tellement assumé, en fait, que non seulement il fait l’objet d’un mode « Manager » à part où vous serez purement spectateur des matchs de votre effectif, si le cœur vous en dit, mais qu’il est pour ainsi dire obligatoire : quel que soit le mode de jeu choisi, vous devrez repartir d’une équipe pourrie ou bien reprendre celle que vous aurez patiemment montée et sauvegardée. Vous espériez vous amuser tout de suite ? Je ne dis pas que c’est impossible, mais il va falloir garder à l’esprit que vous partirez obligatoirement avec un handicap – et qu’affronter des équipes aux caractéristiques très supérieures aux vôtres risque de représenter des matchs particulièrement exigeants, pour ne pas dire foncièrement injustes.

L’ambition aidant, on sent d’ailleurs que l’idée d’un jeu accessible auquel on comprend comment jouer en vingt secondes est un peu passée à la trappe ; Eric Matthews a eu des idées depuis le premier opus, et il tenait visiblement à nous en faire profiter. Première constatation : le terrain est facilement cinq ou six fois plus grand que dans Speedball, ce qui signifie que les équipes sont également plus grandes : neuf joueurs chacune, en comptant le gardien. Cela change déjà beaucoup de choses en termes de rythme et de possibilités tactiques, mais on pourrait penser que cela ne modifie pas grand chose quant à l’objectif fondamental, qui reste d’aller envoyer le ballon dans les cages adverses – or, c’est précisément là que les choses se compliquent.

Un but vous rapportera en effet la bagatelle de dix points ; un chiffre impressionnant, qui trahit le fait qu’il y a d’autres façons d’en marquer. Tirer dans un des « bumpers » placés sur le terrain vous en rapportera deux, par exemple – ce qui signifie que foncer vers les cages adverses pour tromper le gardien n’est plus l’unique façon de gagner : il est tout à fait possible de gratter des points au milieu de terrain pour forcer l’adversaire à se découvrir sous peine de match perdu. Mais ce n’est pas tout ! Il existe également des rampes, situées sur le côté du terrain, et qui agiront comme des multiplicateurs de score tant qu’elle seront activées, et qui pourront représenter une zone de bataille à part entière, votre adversaire pouvant être tenté de baisser votre bonus tout en s’efforçant de gonfler le sien. Et puis il y a des étoiles à allumer, qui enlèvent chacune deux points à l’adversaire, et puis il y a l’argent et les bonus temporaires qui apparaissent sur le terrain, et puis blesser les joueurs rapporte aussi des points, et puis… vous l’aurez compris : dorénavant, il y a beaucoup de choses à gérer. Vraiment beaucoup.

Je vous rassure tout de suite : il ne faudra pas des semaines de pratique intensive pour maîtriser les règles du jeu : vous devriez largement avoir pris vos marques au bout d’une heure. Vous le ferez d’ailleurs d’autant plus volontiers que la réalisation est particulièrement soignée : les sprites sont plus grands, les animations sont plus travaillées, le défilement est impeccable, l’action est frénétique, et surtout la jouabilité est toujours aussi instinctive.

En revanche, on pourra regretter que la plupart des errements du premier opus n’aient absolument pas été corrigés : il est toujours impossible de connaître la position de vos coéquipiers, ce qui vous oblige largement à jouer à l’aveugle, les joueurs des deux équipes se ressemblent trop, ce qui rend la lisibilité parfois confuse, il n’est pas facile de déterminer quel joueur on va contrôler, particulièrement quand ils sont plusieurs à équidistance de la balle, et nous faire contrôler le gardien lors de la demi-seconde où il apparait à l’écran lors d’un contre éclair n’est pas un cadeau non plus. On est souvent fou de rage de constater avec quelle facilité l’adversaire peut nous mettre un but simplement parce qu’on ne peut tout simplement rien anticiper faute de choisir qui on contrôle et à quel moment – d’autant que marquer un but est bien plus compliqué que dans le premier épisode, la faute à des cages très étroites et à des gardiens qui commettent peu d’erreurs… quand ce n’est pas vous qui les contrôlez, naturellement. Du coup, on a d’autant plus de raisons de monter une équipe surentraînée qui pourra se contenter de passer la balle au gardien adverse avant de lui aligner un gnon au moment où il la réceptionnera pour pousser le ballon dans le but vide. Au fond, la récompense ultime, c’est un peu celle-là : avoir enfin l’effectif qui vous permettra de rouler sur tout le monde avec un minimum d’efforts.

Il n’empêche que Speedball 2 perd ainsi fatalement ce qui est paradoxalement le charme des titres « à l’ancienne » : ce côté immédiat de la jouabilité à un bouton qui permet à n’importe quel ami, même celui n’ayant jamais approché un jeu de sport de son existence, de comprendre instinctivement comment on joue au bout de dix secondes.

En gonflant efficacement et intelligemment sa durée de vie, le logiciel des Bitmap Brothers a peut-être oublié un mode « allégé » se débarrassant définitivement de l’aspect gestion pour proposer une sélection d’équipes équilibrées, et ses règles touffues avec des façons de gagner des points dans tous les sens risquent d’intimider bien des nouveaux venus à qui vous essayez de faire découvrir un sport qui avait l’air simple à jouer et qui donne le sentiment d’avoir à apprendre les règles d’un tournoi de Quidditch. Rien d’insurmontable sur la durée, mais un aspect « too much » qui pourra aussi donner un petit coup de vieux à un logiciel qui est indéniablement resté amusant, mais qui est aussi un peu le cul entre deux chaises face à des logiciels modernes qui, quitte à être complexe, ont eu des décennies pour pousser tous les curseurs beaucoup plus loin. Un vrai bon jeu de sport à l’ancienne qui pourra encore facilement se fabriquer de nouveaux fans, mais pour ceux qui n’ambitionnaient que de se détendre cinq minutes au moment de l’apéro, peut-être que le premier opus a encore son charme, finalement.
Vidéo – Le premier match du jeu :
NOTE FINALE : 16,5/20 Au premier abord, Speedball 2 : Brutal Deluxe a toutes les caractéristiques d'une version dopée aux hormones du premier opus : plus long, plus grand, plus riche, plus dense. Dans les faits, le titre des Bitmap Brothers correspond aussi à un changement de philosophie : là où Speedball premier du nom misait avant tout sur l'accessibilité et le plaisir immédiat, son héritier direct est un jeu plus complexe, plus touffu et plus exigeant où la gestion des caractéristiques de vos joueurs et la connaissance de règles bordéliques seront primordiales que cela vous plaise ou non. Conséquence : si un joueur expérimenté s'éclatera après s'être patiemment monté une équipe capable d'écraser toutes les autres, il aura dû souffrir avant d'en arriver là, quitte à subir de longues rencontres à servir de punching-ball à des adversaires supérieurs en tous points. Une raison qui explique que ceux qui découvriront le logiciel de nos jours puissent, paradoxalement, lui préférer son grand frère plus abordable plutôt que de devoir subir de nombreux matchs frustrants avant d'avoir le droit de vraiment s'amuser. Néanmoins, en termes de contenu et de durée de vie, il n'y a clairement pas photo, et ceux qui ont vraiment envie d'investir du temps dans le sport du futur devraient immédiatement ce diriger vers cet épisode.
CE QUI A MAL VIEILLI : – Beaucoup de façons de gagner des points qui tendent à transformer un sport intrinsèquement simple en un bazar pas toujours limpide – Des matchs parfois extraordinairement frustrants face à des équipes aux caractéristiques très supérieures – Une action pas toujours très lisible sur un terrain très étendu où il est impossible de connaître la position de vos coéquipiers... – ...et non, nous faire contrôler le gardien n'est toujours pas une bonne idée – Aucune variété dans les environnements
Bonus – Ce à quoi peut ressembler Speedball 2 sur un écran cathodique :

Les avis de l’époque :
« Speedball II (sic) est un jeu d’une grande richesse, qui surclasse toutes les autres simulations de sport futuriste. Il faut reconnaître qu’à l’instar du programme précédent, Speedball II (re-sic) présente une excellente gestion des joueurs et que la jouabilité est un modèle du genre. En dépit de la présence de nombreux joueurs qui se déplacent en tout sens, le jeu reste toujours très clair. »
Alain Huyghues-Lacour, Tilt n°86, janvier 1991, 18/20
Version Amiga
| Développeur : The Bitmap Brothers |
| Éditeur : Image Works |
| Date de sortie : Décembre 1990 |
| Nombre de joueurs : 1 à 2 |
| Langue : Anglais |
| Support : Disquette 3,5″ |
| Contrôleur : Joystick |
| Version testée : Version disquette testée sur Amiga 1200 |
| Configuration minimale : Système : Amiga 1000 – OS : Kickstart 1.1 – RAM : 512ko Modes graphiques supportés : OCS/ECS |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Comme toujours avec les Bitmaps Brothers, Speedball 2 aura été développé parallèlement sur Atari ST et sur Amiga. Le premier Speedball avait profité, pour l’occasion, d’une résolution sensiblement plus élevée sur Amiga durant les matchs ; ce n’est pas le cas avec ce portage, mais cela n’empêche pas de constater que cette version, exactement équivalente à celle parue sur Atari ST en termes de contenu, tire néanmoins profit des capacités de la machine de Commodore.

Graphiquement, tout d’abord, il y a des couleurs en plus, et cela se sent dès l’interface qui est moins grisâtre. Les terrains sont plus détaillés : il y a des détails au sol, une grande étoile dans le rond central (il n’y a pas de rond au centre du terrain, mais vous m’aurez compris), des marqueurs pour indiquer à quelle distance du but vous vous trouvez, etc. Mais c’est clairement du côté du son que la différence est la plus sensible ; il y a bien plus de bruitages, des voix pour accompagner l’action – dont une, restée célèbre, qui crie « ice cream, ice cream ! » pendant les rencontres. Tout cela fait un bien fou à l’ambiance durant les matchs, qui semblent beaucoup plus vivants que sur Atari ST. Bref, tant qu’à faire, si vous voulez découvrir le jeu, c’est sans doute par là qu’il faut commencer.

NOTE FINALE : 17/20
Sur Amiga, Speedball 2 tire clairement son épingle du jeu. Plus coloré que sur Atari ST, le jeu profite surtout d’une ambiance sonore qui transporte le jeu dans une autre dimension et nous fait bien mieux ressentir l’action des matchs et la présence du public. Un vrai bon moyen de découvrir le jeu.
Version Commodore 64
| Développeur : The Bitmap Brothers |
| Éditeur : Image Works |
| Date de sortie : Septembre 1991 |
| Nombre de joueurs : 1 à 2 |
| Langue : Anglais |
| Support : Disquette 5,25″ |
| Contrôleur : Joystick |
| Version testée : Version disquette |
| Configuration minimale : RAM : 64ko |

En 1991, Le Commodore 64 n’était toujours pas mort – ce qui est un exploit remarquable, surtout quand on se rappelle que son successeur n’était pas appelé à connaître la même longévité. Speedball 2 y aura donc été porté – une nouvelle fois directement par les Bitmap Brothers, ce qui est plutôt de bon augure. Pour l’occasion, le titre aura bel et bien connu quelques coupes, comme on pouvait s’y attendre, mais celles-ci demeurent assez anecdotiques : l’introduction a disparu, et les replays après les buts sont également à oublier. La bonne nouvelle, c’est qu’une fois en match, la jouabilité, pour sa part, est restée excellente – et tous les modes de jeu sont toujours là, y compris le mode « Manager » (rebaptisé pour l’occasion « Team Mode »). Certes, on ne retrouve pas la formidable ambiance de la version Amiga, notamment du côté sonore où les quelques bruitages qui viennent perturber le silence sont purement fonctionnels, mais l’action est aussi nerveuse et aussi fluide que dans les versions 16 bits, et il y a vraiment matière à s’amuser à deux. Évidemment, le joueur moderne préfèrera sans doute découvrir le titre directement sur Amiga, mais pour ceux qui chercheraient le jeu de sport ultime sur Commodore 64, voici sans aucun doute un candidat très crédible.

NOTE FINALE : 15,5/20
Speedball 2 sur Commodore 64 n’est sans doute pas le meilleur jeu de sport de tous les temps, mais à l’échelle de la ludothèque de la machine, il y a débat ! Le contenu n’a pratiquement pas bougé, la jouabilité est excellente, et les quelques minimes coupes observées ne devraient de toute façon pas décontenancer les fans de la machine. Clairement un jeu à posséder sur C64.
Version Mega Drive
Speedball 2
| Développeur : John M. Philips |
| Éditeur : Virgin Games, Inc. |
| Date de sortie : Décembre 1991 (États-Unis) – 19 juin 1992 (Japon) – Décembre 1992 (Europe) |
| Nombre de joueurs : 1 à 2 |
| Langue : Anglais |
| Support : Cartouche |
| Contrôleur : Joypad |
| Version testée : Version européenne |
| Spécificités techniques : Cartouche de 4Mb Système de sauvegarde par mot de passe |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Parmi les machines aptes à accueillir Speedball 2, la Mega Drive était une candidate naturelle. Avec les Bitmap Brothers directement aux commandes, cette version (qui curieusement, sera arrivée en Europe un an après la version américaine) a l’avantage d’être assez proche des versions 16 bits qui l’avaient précédée, avec quelques nuances qui valent la peine d’être mentionnées.

En termes de contenu, pas de problème, tout est là – faute de pile de sauvegarde, il est naturellement impossible de conserver les replays, mais un système de mot de passe la remplace pour le mode « League », l’essentiel est donc préservé. Graphiquement, le jeu est à peu près semblable à la version ST – comprendre par là que les détails aperçus dans la version Amiga n’ont pas fait le trajet jusqu’ici, ce qui est d’autant plus dommage que la console avait largement les moyens de les afficher. En revanche, côté sonore, la Mega Drive fait mieux que la machine d’Atari ; même si les bruitages sont assez décevants, on récupère un certain nombre de voix digitalisées, et il est également possible de profiter d’un thème musical (celui de l’introduction) pendant le match (uniquement dans les versions européennes et japonaises). La jouabilité étant toujours irréprochable, on tient clairement ici une alternative solide, bien qu’elle ne se hisse pas encore tout à fait à la hauteur de la version Amiga.

NOTE FINALE : 16,5/20
Speedball 2 sur Mega Drive ne fait pas encore tout-à-fait aussi bien que la version Amiga du jeu, mais elle n’en est pas non plus à des kilomètres, ce qui reste la principale information à retenir. Si on pourra regretter que les graphismes ne fassent pas mieux que sur Atari ST, la réalisation sonore est déjà un peu plus ambitieuse.
Version PC (DOS)
| Développeur : The Bitmap Brothers |
| Éditeur : Image Works |
| Date de sortie : Octobre 1991 |
| Nombre de joueurs : 1 à 2 |
| Langue : Anglais |
| Supports : Disquettes 5,25″ et 3,5″ |
| Contrôleurs : Clavier, joystick |
| Version testée : Version disquette émulée sous DOSBox |
| Configuration minimale : Processeur : Intel 8088/8086 – OS : PC/MS-DOS 2.1 – RAM : 640ko Modes graphiques supportés : EGA, Tandy/PCjr, VGA (256 couleurs/monochrome) Cartes sonores supportées : AdLib, haut-parleur interne, Roland MT-32/LAPC-I, Sound Blaster, Tandy/PCjr |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
En 1991, le PC moyen commençait à avoir assez peu de complexes à nourrir face à un Amiga ou à un Atari ST – créant une problématique nouvelle pour les studios européens qui, jusqu’ici, avaient snobé la machine. Graphiquement, en tous cas, pas de problème : les 256 couleurs du VGA permettent d’afficher les mêmes détails que sur Amiga, et trouver un processeur assez puissant pour que l’action et le défilement demeurent fluide ne devrait pas exactement représenter un problème au XXIe siècle.

Niveau sonore, c’est un peu plus complexe : la Roland MT-32 donne de très bons résultats, tant pour la musique que pour les bruitages, mais vous obligera à vous passer des voix. Avec une Sound Blaster seule, vous pourrez bénéficier de tout le lot – la musique, les bruitages et les voix – mais dans une qualité inférieure. Dans les deux cas, ça n’atteindra pas tout à fait l’ambiance de la version Amiga, mais avec une Roland MT-32, cela reste pleinement satisfaisant, et il n’y a pas non plus matière à s’arracher les oreilles avec une Sound Blaster. La jouabilité restant de toute façon excellente, cette version reste au-dessus de la version Atari ST, et constitue une alternative tout-à-fait décente pour les joueurs qui sauraient mieux faire tourner DOSBox qu’un émulateur Amiga. Un portage qui aurait pu être meilleur, mais qui fait le travail.

NOTE FINALE : 17/20
Speedball 2 sur PC ne touche peut-être pas encore la perfection du doigt, mais elle n’a vraiment pas de raison de rougir face à l’intouchable version Amiga – l’ambiance est certes un peu inférieure, mais la réalisation sonore reste parmi les meilleures, surtout avec une Roland MT-32. La réalisation graphique étant pour sa part irréprochable, on ne va quand même pas se plaindre, non?
Version Game Boy
| Développeur : Spidersoft Limited |
| Éditeur : Virgin Games, Inc. |
| Date de sortie : 17 septembre 1992 (États-Unis) – 17 novembre 1992 (Espagne) – 25 décembre 1992 (France) |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Anglais |
| Support : Cartouche |
| Contrôleur : Console |
| Version testée : Version internationale |
| Spécificités techniques : Cartouche d’1Mb Système de sauvegarde par mot de passe |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Alors que Speedball avait été porté uniquement sur NES en ce qui concernait les machines de Nintendo, Speedball 2, pour sa part, aura tenté la Game Boy – pas de version Super Nintendo en vue, curieusement, mais lui préférer la Mega Drive était un choix relativement cohérent en 1992, surtout pour un jeu de sport. Quoi qu’il en soit, cette version a déjà l’avantage de préserver tout le contenu du jeu… moins le mode deux joueurs, passé à la trappe.

C’est à coup sûr la plus grosse perte, car pour ce qui est du reste, le titre ne s’en sort objectivement pas mal. Certes, le rythme est un peu plus lent, est l’action n’est pas toujours extrêmement lisible à cause de la réalisation en nuances de gris, mais on trouve assez vite ses marques et il faut bien reconnaître qu’on retrouve à peu près les sensations des versions 16 bits sans avoir à se lamenter de rééquilibrages douteux (même si le jeu m’a paru un peu plus simple). Évidemment, difficile de prétendre tenir la version ultime du jeu – surtout à présent que l’expérience est exclusivement solo, ce qui est quand même un peu dommage pour un jeu de ce type – mais pour ceux qui cherchaient une version de Speedball 2 à emporter partout, la mission était indéniablement remplie.

NOTE FINALE : 14/20
Speedball 2 sur Game Boy n’est sans doute pas la version ultime du titre des Bitmap Brothers, mais à l’échelle des jeux de sport à pratiquer sur la portable de Nintendo, il reste indéniablement dans le haut du panier. Supprimer le mode deux joueurs, en revanche, n’était sans doute pas la meilleure chose à faire.
Version Master Sytem
Speedball 2
| Développeur : The Bitmap Brothers |
| Éditeur : Virgin Games, Inc. |
| Date de sortie : Novembre 1992 (Europe) |
| Nombre de joueurs : 1 à 2 |
| Langue : Anglais |
| Support : Cartouche |
| Contrôleurs : Control Stick, joypad |
| Version testée : Version européenne |
| Spécificités techniques : Cartouche de 2Mb Système de sauvegarde par mot de passe |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Le premier Speedball sur Master System n’avait pas exactement laissé un souvenir mémorable, la faute à un gameplay abîmé, à un contenu charcuté et à un rythme que l’on qualifiera poliment de « poussif ». La grande question reste donc de savoir si le deuxième épisode aura fait mieux. Graphiquement, difficile d’accabler la Master System : c’est très coloré pour une console 8 bits, c’est lisible, et c’est indéniablement au-dessus de ce que pouvait proposer le Commodore 64.

La réalisation sonore est plus discrète, mais c’est une nouvelle fois au niveau du rythme que le titre ne mérite pas le nom de « Speedball » : ça cavale à une vitesse nettement plus mesurée que dans les autres versions – ça va même un peu moins vite que sur Game Boy ! Si cela abîme quelque peu la frénésie des matchs, cela n’endommage fort heureusement pas la jouabilité, et le jeu reste amusant à pratiquer, surtout à deux. Surtout, tous les modes de jeux répondent présent, et vous n’aurez pas cette fois à vous priver du principal mode solo. Néanmoins, si vous voulez vraiment adhérer aux sensations originales, le mieux n’est sans doute pas de commencer ici.

NOTE FINALE : 14/20
Bien qu’il ait du mal à débloquer l’accélérateur, Speedball 2 sur Master System offre indéniablement une expérience plus convaincante que celle livrée par son prédécesseur sur la même machine.
Version Acorn 32 bits
| Développeur : Krisalis Software Ltd. |
| Éditeur : Krisalis Software Ltd. |
| Date de sortie : 1994 |
| Nombre de joueurs : 1 à 2 |
| Langue : Anglais |
| Support : Disquette 3,5″ |
| Contrôleurs : Clavier, joystick |
| Version testée : Version disquette testée sur A4000 |
| Configuration minimale : – |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
En dépit de son statut d’ordinateur 32 bits, l’Archimedes semblait entretenir une sorte de lien privilégié avec l’Amiga – en partie grâce à la compagnie Krisalis, qui paraissait s’être donnée la mission de porter tous les hits de la machine de Commodore sur celle d’Acorn.

Comme souvent, la mission est remplie avec succès : Speedball 2 est pour ainsi dire identique à 99,9%, dans son itération Archimedes, à l’opus Amiga. Les rares différences sont à chercher dans le rendu sonore, ou du côté de quelques nuances dans les couleurs (voir l’écran-titre, par exemple), mais c’est tellement anecdotique qu’un néophyte serait bien en peine de parvenir à établir une nuance entre les deux versions. Pour le reste, c’est graphiquement identique, le contenu n’a pas changé d’un iota, et quoi qu’on puisse penser de la décision de commercialiser le jeu si tard et sur une machine aussi confidentielle, le fait est qu’on hérite d’un quasi-clone de la quasi-meilleure version du programme. Difficile, dans ces conditions, de faire la fine bouche.

NOTE FINALE : 17/20
L’Acorn était rarement pris au dépourvu au moment d’adapter des jeux venus de l’Amiga, et Speedball 2 en est une nouvelle démonstration : c’est pratiquement la copie carbone du jeu paru sur l’ordinateur de Commodore. La jouabilité est toujours aussi bonne, l’ambiance est toujours aussi réussie et la réalisation est toujours aussi efficace : que du bonheur.
Version Amiga CD32
| Développeur : The Bitmap Brothers |
| Éditeur : Renegade Software |
| Date de sortie : 1995 |
| Nombre de joueurs : 1 à 2 |
| Langue : Anglais |
| Support : CD-ROM |
| Contrôleur : Joypad |
| Version testée : Version européenne |
| Spécificités techniques : Système de sauvegarde par mot de passe |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
On ne va pas se mentir : en 1995, l’Amiga CD32 n’était pas exactement au sommet de sa forme. Pour sa défense, elle n’avait jamais vraiment été bien portante, et la situation n’était pas plus enthousiasmante depuis que sa maison-mère avait déposé le bilan. Mais les développeurs européens étaient des romantiques, et beaucoup avaient du mal à imaginer un monde sans l’Amiga, Speedball 2 aura donc fait le trajet jusqu’à une machine qui représentait plus que jamais un marché de niche.

La bonne nouvelle, c’est qu’on ne se sera pour une fois pas contenté de copier le contenu d’une disquette sur un CD-ROM : le titre s’avance cette fois dans une version AGA exclusive, et avec des pistes numériques en fond sonore, rien de moins ! Mine de rien, ce dépoussiérage en règle fait du bien à la réalisation : graphiquement, c’est beaucoup plus coloré qu’auparavant, à tel point qu’on ne sait parfois plus trop si on regarde un match ou un épisode de Bioman, mais la lisibilité est excellente. Mais alors du point de vue sonore, là, c’est carrément l’orgie : on a droit à un thème différent par menu, et s’il n’y a pas de musique pendant les matchs, les cris de la foule compensent ! La version Amiga est enfin officiellement battue – on est très loin de l’ambiance de cathédrale de la version ST, et il faut bien reconnaître que sortir enfin des teintes de gris/bleu pastels a également son charme. Bon, comme on peut s’en douter, les joueurs qui à la même période s’éclataient sur Battle Arena Toshinden ou sur Panzer Dragoon ne se seront pas exactement précipités sur cette version ni sur une machine que tout le monde avait déjà oubliée, mais pour le joueur du XXIe siècle qui cherche la version ultime du jeu, c’est peut-être bien le Graal.

NOTE FINALE : 17,5/20
Sorti discrètement sur une console à l’agonie, Speedball 2 sur Amiga CD32 n’en est pas moins la meilleure version du jeu : la plus belle, d’abord, même si ce déluge de couleurs vives ne plaira pas nécessairement à tout le monde, mais aussi la plus convaincante en termes d’ambiance. Si vous avez l’occasion de vous y essayer, foncez !