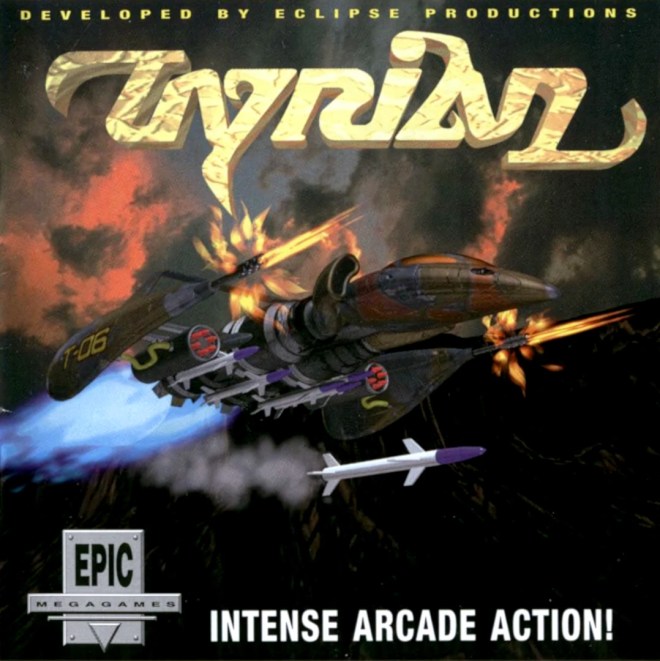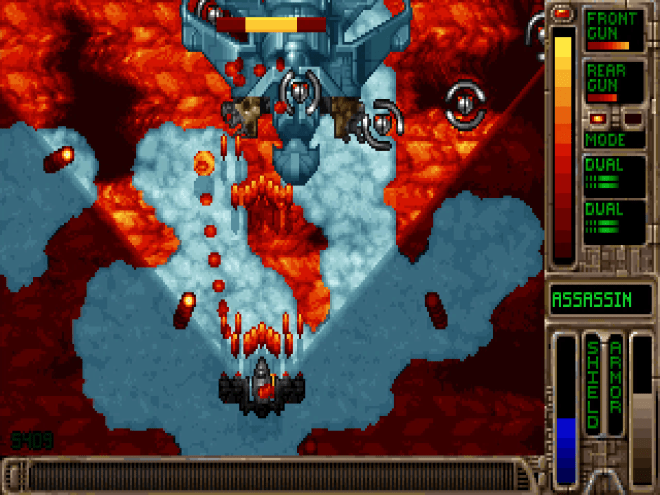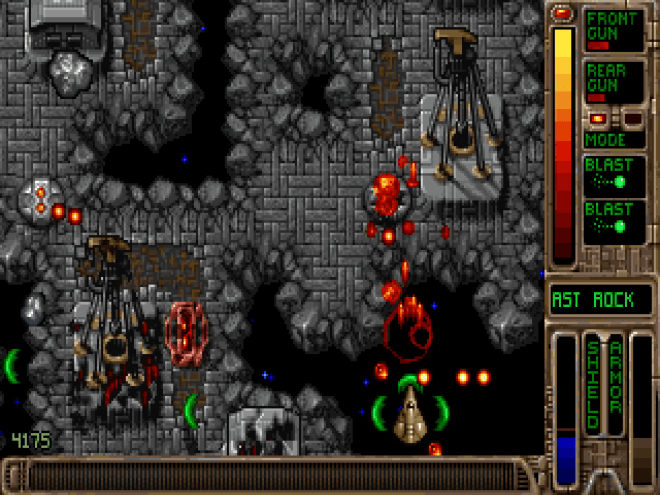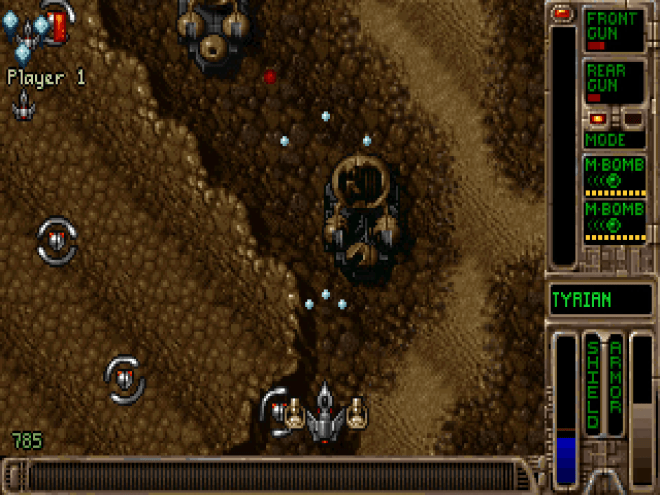Développeur : New World Computing, Inc.
Éditeur : New World Computing, Inc.
Titres alternatifs : Меч и Магия (Mech i Magija, Russie), 魔法門 (Chine)
Testé sur : Apple II – Commodore 64 – FM-7 – PC (DOS) – PC-88 – Macintosh – MSX – PC-98 – Sharp X68000 – NES
Version non testée : Sharp X1
Disponible sur : Windows
Présent au sein des compilations :
- Might and Magic I & II (1992 – Macintosh)
- Might ang Magic I, II, III, IV, V (1998 – PC (DOS))
- Might and Magic Sixpack (1998 – PC (DOS), Windows)
- Ultimate Might and Magic Archives (1998 – PC (Windows 9.x))
En vente sur : Gog.com (Windows)
La série Might and Magic (jusqu’à 2000) :
- Might and Magic – Book One : Secret of the Inner Sanctum (1987)
- Might and Magic II : Gates to Another World (1988)
- Might and Magic III : Les Îles de Terra (1991)
- Might and Magic : Les Nuages de Xeen (1992)
- Might and Magic : Darkside of Xeen – La Face Cachée de Xeen (1993)
- Might and Magic VI : Le Mandat Céleste (1998)
- Might and Magic VII : Pour le Sang et l’Honneur (1999)
- Might and Magic VIII : Day of the Destroyer (2000)
Version Apple II
| Date de sortie : Mars 1987 |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Anglais |
| Support : Disquette 5,25″ (x2) |
| Contrôleur : Clavier |
| Version testée : Version disquette testée sur Apple IIe |
| Configuration minimale : Système : Apple II+ – OS : Aucun – RAM : 64ko Mode graphique supporté : Haute résolution |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
On a déjà évoqué dans ces pages comment un modeste employé de magasin informatique nommé Richard Garriott avait programmé un jeu de rôles intitulé Akalabeth sur son temps libre avant de commencer à le copier et à le vendre dans des sacs Ziploc, encouragé en ce sens par le propriétaire de la boutique. Dans son cas, la chance avait voulu que, sur la dizaine d’exemplaires vendus, un finisse sur le bureau de la compagnie California Pacific Computer, lançant la carrière de celui qu’on appelait déjà Lord British.

Eh bien, voici à présent une histoire très semblable : celle de Jon Van Caneghem, qui passa trois ans à programmer un jeu de rôles extrêmement ambitieux nommé Might and Magic. Lui aussi aura initié une série majeure, originellement longue de neuf épisodes – sans compter les nombreux spin-offs, parmi lesquels les Heroes and Might and Magic, récemment devenus Might and Magic Heroes, ne sont sans doute pas les moins célèbres. Mais ceux-ci, tout comme le dixième épisode publié par Ubisoft en 2014, ne sont pas ce qui nous intéresse ici : revenons au tout début, au commencement, à l’origine, au secret du sanctuaire intérieur…

Might and Magic – Book One : Secret of the Inner Sanctum s’ouvre sur un parti-pris assez original : le manuel vous explique en grands détails comment composer votre équipe et jouer… et strictement rien d’autre. N’espérez même pas une ligne pour vous décrire le monde dans lequel vous vous trouvez, ou l’identité d’un éventuel grand méchant : au lancement du jeu, vous en savez autant que les personnages que vous aurez créés, à savoir : rien. Vous êtes dans un monde médiéval-fantastique, voilà pour les informations. Pour tout le reste, sa géographie, son histoire, sa faune et sa flore, son système politique et les éventuelles menaces qui pourraient peser sur lui, ce sera à vous de le découvrir – d’ailleurs, vous n’avez pas la moindre idée de ce qu’est ce fameux sanctuaire intérieur évoqué dans le titre, et il vous faudra certainement de très nombreuses heures de jeu au compteur pour en avoir une vague idée. Et pourtant, les événements mis en branle dans cet épisode ne trouveront leur conclusion que cinq épisodes plus tard. Ambitieux ? Oui, et c’est un mot qui reviendra souvent. Bienvenue dans Might and Magic.

Avant de partir à l’aventure, il faudra commencer par bâtir son groupe de six personnages. Six classes, cinq races, sept caractéristiques, trois alignements, deux sexes : le tout est évidemment plus qu’inspiré de Donjons & Dragons, même si on remarquera que la classe d’armure doit ici être la plus haute possible, et non la plus basse comme dans le jeu de Gary Gygax et Dave Arneson.

Tous ces aspects auront une importance : certaines armes sont réservées à certaines classes ou à certains alignements, et il peut arriver, comme dans la ville de Portsmith, que certains pièges ne touchent qu’un sexe précis au sein de votre équipe. Surtout, les combats reposant sur des jets de dés basés sur vos caractéristiques, attendez-vous à passer un long moment à créer l’équipe de vos rêves : tirage intégral de toutes les statistiques, aucun échange, aucune modification ; si jamais le résultat obtenu ne vous convient pas, le seul salut est de relancer les dés jusqu’à satisfaction. Conseil : prêtez une attention particulière à la vitesse et à la précision de vos personnages ; les combats, déjà relevés, sont encore beaucoup plus difficiles avec des personnages qui agissent en dernier ou qui ratent toutes leurs attaques.

La partie débutera ensuite dans la ville de Sorpigal, avec pas un rond en poche et des aventuriers en short disposant juste d’un gourdin dans leur inventaire. Votre visite s’effectuera à la première personne, à la Wizardry ou à la Bard’s Tale.

L’occasion de sortir le papier millimétré pour tenir vos plans : chaque ville, château ou donjon du jeu tient sur une grille de 16×16 cases, où vous aurez bien évidemment tout intérêt à fureter dans tous les coins à la recherche de trésors, de PNJs et de passages secrets. L’exploration est toujours récompensée – toutes les villes du jeu contiennent au moins un portail ou un personnage capable de vous téléporter ailleurs – mais comporte également ses risques. Car les affrontements (très inspirés de ceux de Wizardry, encore une fois) seront nombreux, et jamais faciles : les adversaires sont parfois présents en nombres délirants, peuvent vous maudire, vous endormir, vous pétrifier ou vous empoisonner, et avant de parvenir à réunir l’équipement et l’expérience nécessaires à faire face à la plupart des menaces, attendez-vous à passer de nombreuses heures à faire du grinding… pas trop loin d’une auberge, car c’est le seul endroit où vous pourrez sauvegarder le jeu.

Autant en profiter, d’ailleurs, pour évoquer la principale faiblesse de ce Might and Magic : son équilibrage. Sans surprise, le jeu est vraiment difficile – une norme à l’époque, et ce ne sont pas les épisodes de Wizardry qui viendront dire le contraire. Là où les choses sont plus délicates, c’est qu’il est également injuste : on peut tout à fait tomber régulièrement sur des rencontres signifiant l’éradication quasi-inéluctable de son groupe jusqu’à un stade très avancé du jeu.

Et pour ne rien arranger, fuir ne fonctionne pratiquement jamais, pas plus que soudoyer ses adversaires ! Surtout, les coffres et les portes piégées se comptent par centaines, et même avec un bon voleur dans le groupe, vous risquez souvent de vous prendre une volée de fléchettes empoisonnées ou une explosion au visage en cherchant à explorer ou même à récupérer votre butin durement gagné. Et évidemment, les soins coûtent cher et monter de niveau est payant, dans un jeu où gagner de l’argent est difficile… Au moins n’aura-t-on pas à composer avec la redoutable sauvegarde automatique en vogue alors, et qui aura causé la mort définitive de milliers de groupe prometteurs pour les joueurs n’ayant pas eu l’idée de la contourner en copiant leur disquette de personnages avant chaque expédition. Il n’empêche que les joueurs redoutant les combats au tour par tour reposant sur des lancers de dés feraient sans doute mieux de fuir à toutes jambes : Might and Magic est clairement un jeu de rôle à l’ancienne, et il l’assume.

Dans ce domaine, il pourra d’ailleurs faire bien des heureux auprès des fans du genre qui savent ce qu’ils sont venus chercher. L’ambition du titre est palpable rien qu’à sa surface de jeu : Wizardry proposait un donjon ? Bard’s Tale proposait une ville ? Might and Magic propose toute une planète ! Certes, le concept n’était pas exactement neuf – la série Ultima l’offrait depuis le début des années 80 – mais on appréciera le fait que le logiciel de Jon Van Caneghem vous propose de le faire à la première personne, avec une variété graphique fort appréciable pour un jeu programmé sur Apple II.

Forêts, montagnes, déserts, volcans, océans, cavernes, donjons et labyrinthes – tout cela est visitable, visible à l’écran, tout comme les quelques 200 monstres du programme ; il y a de la matière ! Surtout, le scénario du jeu, dispensé par bribes, parvient à réserver des surprises et à se montrer intéressant. Certes, comme souvent, les véritables révélations n’interviennent que dans le dernier tiers de l’aventure – et je ne les partagerai évidemment pas ici afin d’éviter les spoilers, même si les rôlistes expérimentés connaissent sans doute les spécificités de la saga depuis longtemps.

La grande force du jeu est néanmoins d’avoir été pensé depuis le début comme le premier épisode d’une série, et d’annoncer une longue épopée dont certaines questions ne trouveront leurs réponses que plus d’une décennie plus tard. Toujours est-il qu’on trouve déjà dans ce premier opus tout le cahier des charges de ce qu’on pourrait qualifier de « premier âge » de la saga : beaucoup de combats, énormément d’exploration, une carte de 6400 cases à écumer de long en large, des villes, des souterrains, des donjons, des quêtes, des secrets et des boss – l’essentiel !

Soyons honnêtes : si le jeu était originellement à destination des hardcore gamers prêts à consacrer des dizaines, voire des centaines d’heures à venir à bout de l’aventure, internet regorge aujourd’hui de site remplis de solution, de cartes, de conseils et d’astuces pour vous aider à vous composer un groupe solide en un temps record. La difficulté (redoutable) du jeu sera donc largement fonction de vos choix et de votre investissement : si vous voulez la jouer à la dure, préparez-vous à y passer des mois et à en baver. Dans le cas contraire, il est certainement possible de vaincre le titre en l’espace d’une semaine – ce qui serait quand même un peu dommage, la satisfaction d’être venu à bout du logiciel étant proportionnelle au temps que vous y aurez consacré. Dans tous les cas, si vous aimez les jeux de rôles à l’ancienne, avec leurs contraintes et leurs défis, passer à côté de Might and Magic serait criminel. Si jamais ces longues nuits englouties à dompter un monde redoutable à l’aide d’une poignée d’aventuriers vous manquent, ne cherchez pas plus loin.
Vidéo – Dix minutes de jeu :
NOTE FINALE : 15/20
Might and Magic – Book One : Secret of the Inner Sanctum commence par faire penser à un melting pot des meilleurs jeux de rôles à la Wizardry réalisé avec une ambition débordante, des règles très inspirées de Donjons & Dragons et une surface de jeu réellement colossale pour l'époque. À ce niveau, il touche sans peine au pinacle du jeu de rôles « à l'ancienne », avec une difficulté impressionnante, un grinding obligatoire et des dizaines d'heures de jeu en perspective pour espérer se monter un groupe digne de ce nom. Mais la meilleure surprise arrive par le biais du scénario, inexistant en début de partie, qui finit par se révéler rempli de suffisamment de bonnes idées pour alimenter la quasi-totalité de la saga et lancer une épique course-poursuite entre Corak et Sheltem appelée à durer jusqu'au terme du cinquième épisode. Mieux vaudra être extrêmement patient pour espérer parvenir au bout de l'aventure, mais pour ceux à qui les graphismes et les mécanismes datés à l'extrême ne font pas peur, l'épopée en vaut clairement la chandelle.CE QUI A MAL VIEILLI :
– Premières heures de jeu particulièrement difficiles...
– ...et ça n'est pas beaucoup mieux après
– Pratiquement impossible de fuir les combats
– Possibilité de vendre ou de détruire des objets indispensables
– Pas de sauvegarde possible en-dehors des auberges
Bonus – Ce à quoi ressemble Might and Magic sur un écran cathodique :

Version Commodore 64
| Développeur : The Connelley Group |
| Éditeur : New World Computing, Inc. |
| Date de sortie : Décembre 1987 |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Anglais |
| Support : Disquette 5,25″ (x2) |
| Contrôleur : Clavier |
| Version testée : Version disquette 2.0 |
| Configuration minimale : RAM : 64ko |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Comme pour la plupart des jeux de rôles de l’époque, difficile d’imaginer un titre développé sur Apple II ne pas faire le trajet jusqu’à l’autre ordinateur 8 bits star d’alors : le Commodore 64. Sans surprise, le titre débarque avec un contenu relativement semblable, même si quelques petits équilibrages peuvent apparaître d’une version à l’autre. Au rang des bonnes nouvelles, le titre est légèrement plus coloré, et on peut désormais entendre de la musique pendant l’écran-titre – pas après, hélas. Au rang des mauvaises, il faudra, comme souvent, composer avec des temps de chargement à rallonge – mais les utilisateurs de la machine doivent commencer à avoir l’habitude. Au final, à peu près la version qu’on était en droit d’attendre, même si le titre reste globalement beaucoup plus rapide à jouer sur Apple II.

NOTE FINALE : 14,5/20
Comme souvent, le véritable juge de paix du premier Might and Magic sur Commodore 64 sera votre (in)capacité à supporter des temps de chargement rédhibitoires. Si vous êtes patient, vous bénéficierez d’une version sensiblement équivalente à celle parue sur Apple II, dans le cas contraire, mieux vaut essayer le titre sur n’importe quelle autre machine.
Version FM-7
| Développeur : New World Computing, Inc. |
| Éditeur : StarCarft, Inc. |
| Date de sortie : Décembre 1987 (Japon) |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Japonais |
| Support : Disquette 5,25″ (x4) |
| Contrôleur : Clavier |
| Version testée : Version disquette |
| Configuration minimale : RAM : 64ko |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Comme on va vite s’en apercevoir, Might and Magic n’aura pas mis longtemps à suivre la trajectoire propre aux grandes sagas occidentales de jeux de rôle des années 80, à savoir être porté sur une large sélection d’ordinateurs japonais. Le FM-7 de chez Fujitsu aura donné le « la » pour toutes les portages commercialisés au Japon ; il présente des graphismes en 640×200 et en huit couleurs, ainsi que quelques thèmes musicaux – ce qui est déjà plus que ce qu’on pouvait espérer sur un Apple II. Le résultat a un cachet indéniable, qui correspond assez bien à l’atmosphère colorée propre à la saga, avec quelques petites illustrations (dans la petite fenêtre de jeu en haut à gauche) pour égayer le tout. Le résultat, sans toucher au sublime, reste globalement supérieure à ce qui sera observé dans la plupart des versions occidentales. La maniabilité se fait une nouvelle fois entièrement au clavier, avec les raccourcis nécessaires affichés en permanence à l’écran. En fait, le plus gros défaut de ce portage reste surtout d’être intégralement en japonais… Si cela ne vous dérange pas, ce portage représente une alternative qui en vaut bien une autre, dans le cas contraire, les quelques bonus cosmétiques ne valent sans doute pas la peine d’apprendre la langue.

NOTE FINALE : 15/20
Might and Magic était un jeu taillé pour les systèmes 8 bits, et on le sent indéniablement à son aise sur FM-7, où il bénéficie d’une réalisation plus fine et plus colorée. Dommage que celle-ci soit cantonnée au quart supérieur gauche de l’écran et que le titre soit intégralement en japonais.
Version PC (DOS)
| Développeur : New World Computing, Inc. |
| Éditeur : New World Computing, Inc. |
| Date de sortie : Décembre 1987 |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Anglais |
| Supports : Dématérialisé, disquettes 5,25″ (x2) et 3,5″ |
| Contrôleur : Clavier |
| Version testée : Version dématérialisée émulée sous DOSBox |
| Configuration minimale : Processeur : Intel 8088/8086 – RAM : 256ko Modes graphiques supportés : CGA, EGA, Hercules, Tandy/PCjr Carte sonore supportée : Haut-parleur interne |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
On sait à quoi s’attendre sur un PC en 1987 : pas grand chose. Ceci dit, on ne pourra pas reprocher à New World Computing de n’avoir pas tiré parti de ce qu’ils avaient à leur disposition : le jeu reconnait l’EGA (ce qui, en 1987, n’était pas nécessairement une évidence : demandez à La Quête de l’Oiseau du Temps sorti deux ans plus tard…), et aucune carte son, ce qui n’est pas franchement une anomalie si on se souvient que la Roland MT-32 était commercialisée la même année et que l’AdLib ne serait disponible qu’un an plus tard. En terme de réalisation, on ne peut pas dire que l’on sente les 16 couleurs : le titre n’est même pas à la hauteur de la version C64, mais de toute façon, on se doute qu’on n’y jouera pas pour la qualité de ses graphismes. la musique ne dépasse une nouvelle fois pas le stade de l’écran-titre – mais elle a le mérite d’exister. En revanche, le jeu tourne comme un charme sous DOSBox – vous n’aurez aucune raison d’être ennuyé par un quelconque temps de chargement, naturellement – et c’est tant mieux, puisque c’est la seule version encore disponible à la vente. Si vous êtes prêt à composer avec l’interface intégralement au clavier et avec les quelques couleurs à l’écran, n’hésitez pas.

NOTE FINALE : 15/20
La version PC de Might and Magic assure l’essentiel, sans faire de prouesses au niveau de la réalisation, mais on n’en attendait de toute façon pas beaucoup en 1987. Le jeu tourne en tous cas comme un charme, sans bug ni temps de chargement, et c’est bien là tout ce qu’on lui demande.
Version PC-88
| Développeur : New World Computing, Inc. |
| Éditeur : StarCraft, Inc. |
| Date de sortie : Décembre 1987 (Japon) |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Japonais |
| Support : Disquette 5,25″ (x4) |
| Contrôleur : Clavier |
| Version testée : Version disquette japonaise |
| Configuration minimale : RAM : 64ko |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Avec StarCraft toujours à la distribution, voici à présent la deuxième incursion de Might and Magic dans l’univers des ordinateurs japonais. Autant prévenir tout de suite : cela va aller vite (une constatation qui risque de rester vraie avec la plupart des machines nippones), et pour cause : le titre est une copie carbone absolue de la version publiée sur FM-7 à peu près au même moment : même résolution, même graphismes, mêmes thèmes musicaux, même interface. Une nouvelle fois, il s’agit donc d’un portage relativement agréable à parcourir dès l’instant où on parle (et surtout où on lit) le japonais, mais dans tous les autres cas de figure, quelques couleurs et quelques notes de musique en plus risquent de ne pas justifier de s’imposer une interface et une aventure dont on ne comprendra pas un traître mot.

NOTE FINALE : 15/20
Aucune surprise pour Might and Magic sur PC-88, qui délivre une expérience rigoureusement identique à celle qui pouvait être observée au même moment sur FM-7. C’est toujours aussi fin, ça a toujours un certain cachet, et c’est surtout toujours intégralement en japonais.
Version Macintosh
| Développeur : New World Computing, Inc. |
| Éditeur : New World Computing, Inc. |
| Date de sortie : Octobre 1988 |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Anglais |
| Support : Disquette 3,5″ |
| Contrôleurs : Clavier, souris |
| Version testée : Version disquette testée sur Macintosh Plus |
| Configuration minimale : Processeur : Motorola 68000 – RAM : 512ko |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Après l’Apple II, quoi de plus naturel que de voir l’autre ordinateur d’Apple accueillir à son tour Might and Magic ? Comme souvent, le jeu aura disposé pour l’occasion d’une version tirant parti de ses capacités, à savoir la haute résolution et surtout une interface intégralement à la souris. De ce côté-là, le gain en terme de confort est évident, même si on aurait apprécié que le jeu vous laisse choisir les sortilèges par leur nom plutôt que de rester cantonné au système de numéros. Dans le même ordre d’idée, les graphismes sont certes plus détaillés grâce à la résolution, mais on ne sent malgré tout pas le même soin que dans des titres comme Bard’s Tale – ça reste assez basique, mais on s’en contentera. Dommage que la fenêtre de jeu soit aussi réduite. En revanche, on sera heureux non seulement de profiter d’un thème musical à l’écran-titre (d’ailleurs entièrement redessiné pour l’occasion, comme tout le reste du jeu) mais aussi d’une série de « jingles » en jeu lors des actions marquantes (comme au début des combats). Bref, si vous cherchez la version la plus facile à prendre en main, vous venez sans doute de trouver votre bonheur.

NOTE FINALE : 15,5/20
Comme souvent sur Macintosh, Might and Magic y débarque avec une interface à la souris et une réalisation en haute résolution qui rendent le jeu infiniment plus simple à prendre en main que sur les autres ordinateurs. Si les graphismes en noir et blanc ne vous font pas peur, c’est clairement la version à privilégier.
Version MSX
| Développeur : New World Computing, Inc. |
| Éditeur : StarCraft, Inc. |
| Date de sortie : 1988 (Japon) |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Japonais |
| Support : Disquette 3,5″ |
| Contrôleur : Clavier |
| Version testée : Version disquette japonaise |
| Configuration minimale : Système : MSX 2 |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Quitte à faire la tournée des systèmes populaires au Japon, il aurait été étonnant que Might and Magic fasse l’impasse sur le MSX. Difficile de ne pas sentir immédiatement qu’on a affaire à un portage réalisé exactement dans le même moule que les autres versions japonaises ; néanmoins, on composera ici avec les caractéristiques de la machine de Microsoft, à la résolution native plus faible. Conséquence : bien que l’interface n’ait pas changé d’un pouce, les graphismes sont ici moins fins et moins colorés que sur les autres ordinateurs nippons, mais la musique, pour sa part, est toujours présente. Très sincèrement, ces quelques différences demeurent furieusement anecdotiques, surtout pour un jeu dont l’intérêt n’a jamais été bâti sur la réalisation. Naturellement, le logiciel est une fois de plus en japonais.

NOTE FINALE : 15/20
Might and Magic sur MSX est le même jeu que sur les autres ordinateurs japonais, mais avec une résolution adaptée aux capacités de la machine. Les graphismes sont donc moins fins, mais à ce détail près, on trouve exactement ce qu’on pouvait attendre – exclusivement en japonais, encore une fois.
Version PC-98
| Développeur : New World Computing, Inc. |
| Éditeur : StarCraft, Inc. |
| Date de sortie : 1988 (Japon) |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Disponible en français : Non |
| Disponible en anglais : Non |
| Support : Disquette 3,5″ (x2) |
| Contrôleur : Clavier |
| Version testée : Version disquette japonaise |
| Configuration minimale : – |

À ce stade, les lecteurs de l’article devraient avoir décelé un certain schéma sous-jacent concernant les portages japonais de Might and Magic. La question est donc probablement sur toutes les lèvres : cette itération PC-98 est-elle oui ou non une copie conforme du portage paru sur FM-7 ? Oui. Je cherche péniblement comment broder à partir de ce stade, mais les faits sont têtus : cette version est la copie carbone et pour ainsi dire pixel perfect (en un peu plus fin, malgré tout) de celle qui avait été commercialisée sur la machine de Fujitsu l’année d’avant (au détail près que, pour une raison quelconque, je ne serais jamais parvenu à en tirer une seule note de musique). Du coup, pas grand chose de neuf à en dire : vous savez ce que vous lancer, et pour peu que vous parliez japonais, vous ne devriez pas avoir à le regretter.
NOTE FINALE : 15/20
À version identique, constat semblable : Might and Magic livre sur PC-98 exactement la même performance que sur la quasi-totalité des systèmes japonais ayant hébergé le jeu. Si vous êtes capable de surmonter la barrière de la langue, foncez.
Version Sharp X68000
| Développeur : New World Computing, Inc. |
| Éditeur : StarCraft, Inc. |
| Date de sortie : 15 octobre 1988 (Japon) |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Japonais |
| Support : Disquette 5,25″ (x3) |
| Contrôleur : Clavier |
| Version testée : Version disquette japonaise |
| Configuration minimale : – |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Les habitués du site doivent commencer à connaître les vertus de l’impressionnante machine de Sharp. Du coup, il aurait quand même été dommage de se contenter d’offrir une simple copie carbone des autres portages japonais du jeu sur le Sharp X68000, non ? Rassurez-vous : Might and Magic tire bel et bien parti de la résolution supérieure de la machine pour ajouter… un grand cadre autour de la fenêtre de jeu. Et non, hélas, je ne plaisante pas. Le contenu comme la réalisation n’ont autrement pas bougé d’un bit. Bon, ce n’est objectivement pas un drame pour un jeu qui est intéressant bien au-delà de sa réalisation, mais si vous espériez découvrir ici la version ultime du jeu, disons que c’est raté.

NOTE FINALE : 15/20
Petite déception pour cette version Sharp X68000 de Might and Magic, qui préfère ajouter un gros cadre autour de la fenêtre de jeu que tirer parti des capacités de la machine. Cela ne pénalise pas pour autant un jeu de rôle qui reste agréable à jouer quelle que soit sa réalisation, mais cela ne devrait pas pour autant vous donner une raison d’investir dans ce portage non plus.
Version NES
Might & Magic : Secret of the Inner Sanctum
| Développeur : G. Amusements Co., Ltd. |
| Éditeur : American Sammy Corporation |
| Date de sortie : 31 juillet 1990 (Japon) – Août 1992 (États-Unis) |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langues : Anglais, japonais |
| Support : Cartouche |
| Contrôleur : Joypad |
| Version testée : Version américaine |
| Spécificités techniques : Cartouche de 4Mb Système de sauvegarde par pile |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Comme les deux autres épisodes de la trilogie originelle, Might & Magic premier du nom aura également fait le trajet sur consoles. Sur NES, tout d’abord, soit la version qui nous intéressera ici, puis sur PC Engine Duo, dans une itération assez différente mais jamais sortie du Japon ni traduite en anglais, ce qui lui vaut de ne pas être testée ici ; elle disposera en temps voulu de son propre article. Retour à la NES, donc : on arrivait alors en 1990, à un moment où la saga préparait déjà son troisième épisode. On sent bien que l’idée de donner un petit coup de polish au titre original a fait du chemin entretemps, et c’est peut-être pourquoi on constatera que cette version a été rééquilibrée. Traduit en clair : la difficulté a été clairement revue à la baisse ; les pièges sont moins dangereux, il est devenu très facile de fuir les combats, les fontaines qui vous accordent des boosts permanents de caractéristique offrent un gain doublé… N’allez pas croire pour autant qu’il s’agisse d’une version au rabais – tout le contenu du jeu est toujours là, et le fait qu’il soit moins difficile ne veut pas dire qu’il est devenu simple.

En revanche, les très nombreux petits changements apportés au titre le rendent indéniablement un peu mieux pensé et nettement moins punitif (il est ainsi impossible de quitter la ville de départ avant d’avoir atteint le niveau 2) – même si les « puristes », eux, ne jureront que par l’expérience originale. Soyez prêt, en tous cas, à ne commencer la partie qu’avec un seul personnage – les autres seront à récupérer à l’auberge, et il est même possible de changer de classe. Il y a même une carte automatique consultable avec la touche Select ! L’interface à deux boutons demande de passer très souvent par un menu activable grâce au bouton A. Au détail près qu’équiper ses personnages passe maintenant par l’action « CAMP », les utilisateurs des autres versions ne devraient pas être décontenancés très longtemps. Sinon, on se déplace avec les flèches, naturellement, et on prend le pli en quelques minutes. Du côté de la réalisation, on a affaire à une refonte graphique totale, avec des décors plus détaillés, des monstres et des PNJs dans un style beaucoup plus japonisant, et surtout des thèmes musicaux – d’ailleurs assez réussis – pendant l’intégralité de la partie. Autant dire que les joueurs intimidés par l’interface au clavier, la difficulté et la réalisation austère de la plupart des versions informatiques feraient bien de jeter un œil à cette itération – ils devront en revanche composer avec de nombreuses coquilles, le monde du jeu s’appelant désormais « Barn », par exemple ; ce qui, pour ceux qui en connaissent la signification originale, aura de quoi énerver. Les rôlistes les plus exigeants – ceux qui ne tolèrent pas, par exemple, qu’on ne les laisse plus créer leur groupe en intégralité, préfèreront sans doute se tourner vers la version Macintosh.

NOTE FINALE : 15/20
Might and Magic sur NES aura intelligemment choisi une voie que beaucoup d’autres conversions du même type auraient mieux fait de choisir : préserver le contenu, repenser l’interface, soigner l’équilibrage, retravailler la réalisation. Si certains changements ne plairont pas à tout le monde – notamment à ceux qui n’aiment pas qu’on leur propose une version plus simple – cela reste une des meilleures portes d’entrée pour les joueurs désirant découvrir l’univers de la saga sans risquer la mort à chaque tournant. À découvrir.