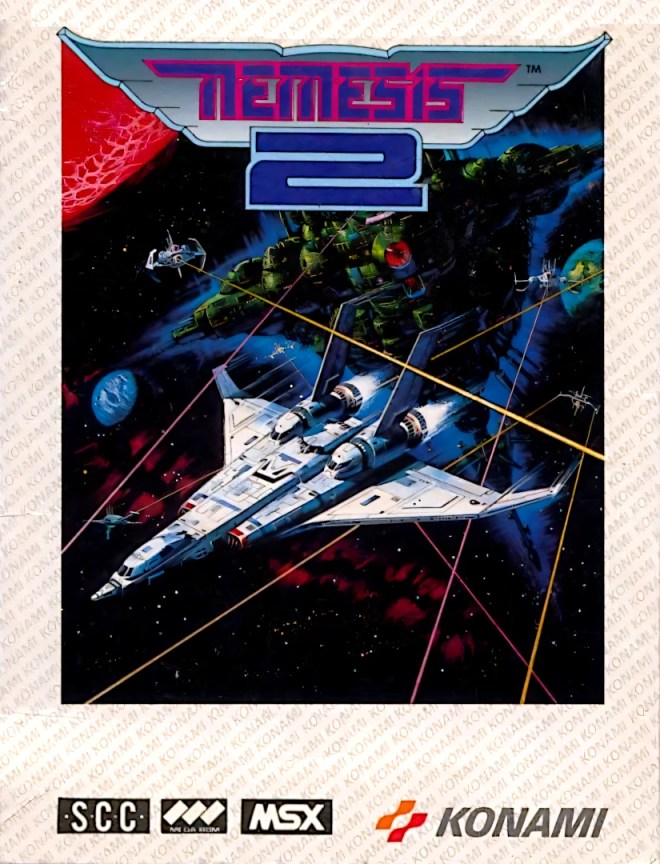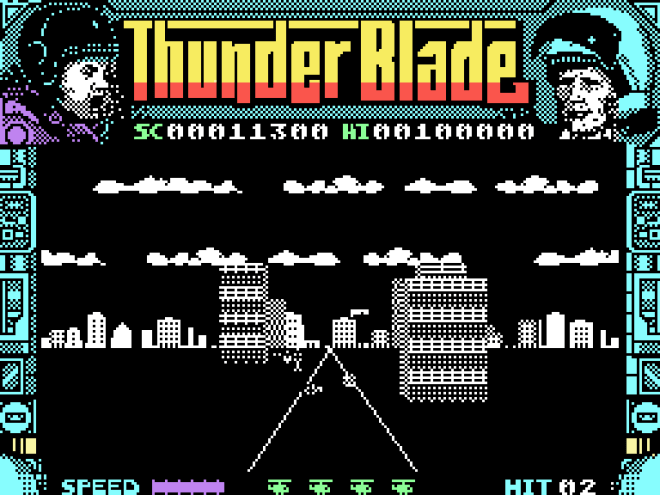Développeur : Westone
Éditeur : SEGA Enterprises, Ltd.
Titre original : スーパーワンダーボーイ モンスターワールド (Super Wonder Boy : Monster World, Japon)
Titres alternatifs : Super Wonder Boy in Monster Land (versions développées par Images Design), Bikkuriman World (PC Engine – Japon), Wonder Boy in Monster Land (Master System) SEGA AGES : Wonder Boy – Monster Land (Switch – international), SEGA AGES ワンダーボーイ モンスターランド (Switch – Japon)
Testé sur : Arcade – PC Engine – Master System – Amiga – Amstrad CPC – Atari ST – Commodore 64 – ZX Spectrum
Disponible sur : Switch, Wii – PlayStation 2 (au sein de la compilation Monster World Complete Collection) – PlayStation 3, Xbox 360 (au sein de la compilation SEGA Vintage Collection : Monster World)
En vente sur : Nintendo eShop (Switch)
La Série Wonder Boy (jusqu’à 2000) :
- Wonder Boy (1986)
- Wonder Boy : Monster Land (1987)
- Monster Lair (1988)
- Wonder Boy III : The Dragon’s Trap (1989)
- Wonder Boy in Monster World (1991)
- Monster World IV (1994)
Version Arcade
| Date de sortie : Août 1987 |
| Nombre de joueurs : 1 à 2 (à tour de rôle) |
| Langue : Anglais |
| Support : Borne |
| Contrôleur : Un joystick (huit directions) et deux boutons |
| Version testée : Version britannique |
| Hardware : SEGA System 2 Processeurs : Zilog Z80 20MHz ; Zilog Z80 4MHz Son : Haut-parleur ; SN76489A 2MHz, SN76489A 4MHz ; 1 canal Vidéo : 512 x 224 (H) 60,096154Hz |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
L’histoire du jeu vidéo aura connu quelques modes suffisamment limitées dans le temps pour qu’on puisse parfois deviner la date de sortie d’un titre rien qu’à son gameplay. L’année 1987 aura ainsi été celle d’une obsession pour un genre extrêmement ciblé : le jeu d’action/plateforme en vue de profil avec des éléments de jeu de rôle.

Oui, c’est atrocement précis, mais l’évocation des titres concernés devrait immédiatement vous aider à cerner de très nombreux points communs entre eux, jugez plutôt : Zelda II chez Nintendo, Simon’s Quest chez Konami, Faxanadu chez Hudson Soft et Nihon Falcom… et, histoire de s’éloigner de la NES, un titre made in SEGA qui est lui aussi une suite et qui aura lui aussi décidé de s’éloigner de la formule de l’opus original (décidément !) : Wonder Boy : Monster Land – distribué, lui, dans les salles d’arcade, ce qui le rend encore un peu plus spécial.

Tom-Tom revient donc aux affaires, après que son sauvetage héroïque de sa dulcinée lui a fait gagner le titre honorifique de Wonder Boy. Dix ans après son aventure, un dragon vient s’installer dans le royaume de Wonder Land pour en faire une terre maléfique, et devinez qui s’y colle pour aller vaincre la bête ?

Notre héros part donc les mains et les poches vides, sans même sa hache ou son skateboard, jusqu’à ce qu’à l’instar d’un certain Link, il trouve un vieux sage dans la première maison visitée pour lui offrir une épée. Charge à lui de parcourir les onze niveaux du jeu, de récolter de l’or, de vaincre les boss et de dénicher les passages secrets pour s’en aller vaincre le dragon et démontrer que son titre n’est définitivement pas usurpé.

Le titre se présente donc par le biais d’une vue de profil et d’une interface simplissime à deux boutons : un pour sauter, l’autre pour frapper.

Le déroulement, linéaire au début et un peu plus ouvert par la suite, vous impose généralement d’avancer vers la droite (mais parfois vers la gauche, également), de vaincre les adversaires sur votre route à l’aide de votre épée, de faire face à quelques séquences de plateforme, et de visiter les différents lieux qui se présenteront à vous sous forme de portes derrière lesquelles vous trouverez des marchands aptes à vous vendre des pouvoirs ou de l’équipement, des sages qui vous délivreront des conseils, des hôpitaux qui vous soigneront, ou bien des bars qui vous permettront à la fois de vous refaire une santé et d’obtenir quelques précieux indices. Le nerf de la guerre sera ici l’or lâché par les monstres – qui vous octroieront également des points, des bonus de soin, du temps supplémentaire et même quelques objets temporaires renforçant votre vitesse, votre attaque ou votre défense – histoire de vous renforcer un peu avant d’affronter une opposition qui ne va pas tarder à devenir très coriace. Mais quitte à faire du grinding, prenez garde à la limite de temps présentée en bas à gauche : à chaque tour de sablier, vous perdrez un cœur…

Le concept est donc très proche de celui des titres évoqués au début de l’article : explorer, se renforcer, combattre. Bien évidemment, l’épopée sera d’autant plus intense qu’il faut bien garder en mémoire qu’on parle d’une borne d’arcade : pas question d’une aventure à rallonge vous imposant de faire usage d’un mot de passe ou d’une sauvegarde ici.

Le jeu peut théoriquement être bouclé en moins d’une heure, mais autant dire qu’à moins d’être extraordinairement bon, il vous faudra énormément de pratique avant de pouvoir prétendre aller très loin avec un ou deux crédits en poche. Savoir dénicher les nombreux emplacements où de l’argent apparait lorsqu’on fait sauter le personnage pourra également être un très bon moyen de faciliter les choses, tout comme de trouver les passages secrets (parfois signalés par votre personnage lui-même) qui se révèlent en poussant le stick vers le haut, car il est évident qu’être plus résistant, plus rapide et plus puissant grâce à votre équipement pourra avoir un effet dramatique sur votre espérance de vie – mais la pression du temps étant constante, et la chance ayant également son rôle à jouer (ah, quand un monstre lâche un bonus de soins juste avant un boss !), ce sera à vous de trouver le rythme optimal pour espérer progresser dans le jeu.

Le résultat, pour exigeant et frustrant qu’il puisse se montrer, est malgré tout parfaitement efficace, et initie à la perfection les mécanismes qui resteront pertinents pendant l’ensemble de la série des Monster World. L’arcade est pour une fois un frein plutôt qu’un avantage, dans le sens où on signerait volontiers pour une aventure longue de plusieurs heures où l’on pourrait à la fois sauvegarder et se débarrasser de cette pression du temps imposée par le support – ce qui sera d’ailleurs fait dès l’excellent Dragon’s Trap sur Master System.

Reste qu’en dépit d’un certain manque de renouvellement dans les situations – et d’une difficulté pensée, comme souvent, pour vous faire cracher des pièces – le charme agit très vite, et on se surprend à avoir envie que la partie se prolonge au-delà de la monnaie qu’on était initialement prêt à glisser dans la borne. Pour la petite histoire, SEGA n’était d’ailleurs pas convaincu que le concept du jeu plaise en occident, raison pour laquelle il comptait cantonner le titre au marché japonais… jusqu’à ce que le succès rencontré par une version pirate du jeu distribuée en Angleterre (on parle de « bootleg », pour les bornes d’arcade) ne fasse changer la firme d’avis ! Si, de nos jours, les nouveaux venus préfèreront sans doute commencer par des opus plus avancés tels que Wonder Boy in Monster World ou le Dragon’s Trap évoqué plus haut, Wonder Boy : Monster Land reste un très bon moyen de faire connaissance avec cet embranchement particulier de la série des Wonder Boy et, pourquoi pas, de tomber définitivement sous le charme.










Vidéo – Cinq minutes de jeu :
NOTE FINALE : 15,5/20 Surprise ! Pour sa deuxième aventure, Wonder Boy : Monster Land arrive sous une forme assez inattendue : un jeu d'action/plateforme mâtiné de RPG, le tout sur une borne d'arcade ! L'idée, bien inscrite dans l'air du temps, avait malgré tout de quoi engendrer sa propre série – ce qu'elle aura fait – et propose une épopée assez dépaysante au cours de dix niveaux récompensant autant l'adresse que l'exploration et la planification minutieuse de vos dépenses. Ironiquement, le titre a également la faiblesse de son support : on sent immédiatement que pareil concept serait infiniment plus à l'aise sur une cartouche avec une pile de sauvegarde et vingt heures de durée de vie que sur une borne où la partie est pensée pour vous mettre à mal au bout de deux minutes. Reste en tous cas un titre plaisant et original qu'on aurait juste aimé un peu moins dur et un peu plus varié, et une très bonne initiation à la série des Monster World.
CE QUI A MAL VIEILLI : – Une partie à mener d'un trait et sans sauvegarde, arcade oblige – Beaucoup de grinding à faire pour espérer être décemment équipé alors même que le temps est limité – Difficulté rapidement frustrante – Le labyrinthe final, absolument infect – Des situations rapidement répétitives
Version PC Engine
Bikkuriman World
| Développeur : Escape |
| Éditeur : Hudson Soft Company, Ltd. |
| Date de sortie : 30 octobre 1987 (Japon) |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langues : Japonais, traduction en anglais par Demiforce, traduction en français par Nec-Ro-Pole |
| Support : HuCard |
| Contrôleur : Joypad |
| Version testée : Version japonaise |
| Spécificités techniques : HuCard de 2Mb |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Petite surprise : le premier portage de Wonder Boy : Monster Land n’aura pas été pour la Master System de SEGA mais bien… pour la PC Engine de NEC. Peut-être une survivance de l’histoire de droit qui aura permis à la série Adventure Island de voir le jour ? Toujours est-il que le titre aura débarqué la même année que la borne, via un portage assuré par Hudson Soft, sous le titre de Bikkuriman World.

Si le logiciel et son déroulement sont identiques à ceux de la borne originale, on remarquera néanmoins quelques modifications, comme le look de votre héros, le design des boss, et l’apparence des différents personnages et vendeurs qui s’adresseront à vous. Pour le reste, les monstres sont identiques au pixel près, les décors sont très proches, et la réalisation graphique comme sonore est largement à la hauteur de celle de la borne – c’est peut-être même un peu plus beau ! La jouabilité n’a pas changé, pas plus que la difficulté, il faudra donc bien vous accrocher pour espérer voir le bout du jeu, mais on ne pourra qu’applaudir la qualité de l’adaptation, qui faisait jeu égal avec la borne l’année même de sa sortie ! Seul inconvénient : pour profiter des rares indices du jeu, il faudra cette fois obligatoirement parler japonais (sauf à utiliser la traduction de fans, naturellement), mais pour ce qui est de tout le reste, difficile de placer la barre plus haut.




NOTE FINALE : 15,5/20
L’année même de la sortie de la borne, la PC Engine pouvait déjà se permettre de rivaliser avec elle via ce Bikkuriman World absolument irréprochable. Certes, le look de quelques protagonistes a changé, et il faudra cette fois se dépatouiller par défaut avec un jeu en japonais, mais tout le reste fait au moins largement jeu égal avec la borne. Respect !
Version Master System
Wonder Boy in Monster Land
| Développeur : Escape |
| Éditeur : SEGA Enterprises Ltd. |
| Date de sortie : 31 janvier 1988 (Japon) – Août 1988 (Amérique du Nord) – 1988 (Europe) |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langues : Anglais, traduction en français par Macrotrads |
| Support : Cartouche |
| Contrôleur : Joypad |
| Version testée : Version européenne patchée en français |
| Spécificités techniques : Cartouche de 2Mb |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Il aura donc fallu attendre un an pour voir Wonder Boy in Monster Land débarquer sur la console 8 bits de SEGA. Sans surprise, la vaillante Master System ne peut espérer se hisser aux hauteurs de la version PC Engine… mais s’en sort malgré tout très bien.

La réalisation est très colorée, la musique reste sympathique, et si certains passages ont été réadaptés pour compenser la disparition du défilement vertical, la fenêtre de jeu est en revanche plus grande, et la jouabilité tout comme les sensations de jeu restent extrêmement proches de celles de la version arcade. À un détail près, cependant : la difficulté a été revue à la baisse ; les monstres comme les boss sont moins résistants, Tom-Tom a davantage de vie, les bonus de soins tombent plus régulièrement… en revanche, pas question de compter sur le moindre continue ici, il faudra donc être particulièrement prudent d’un hôpital à l’autre, tout en prenant garde à la limite de temps. Bref, un excellent compromis qui a dû faire très plaisir aux joueurs de l’époque.






NOTE FINALE : 15/20
En débarquant sur Master System, Wonder Boy in Monster Land perd peut-être quelques fioritures sur le plan de la réalisation, mais il bénéficie également d’une difficulté mieux équilibrée. Les néophytes feraient sans doute mieux de commencer par cette version, qui reste de toute façon largement assez exigeante pour contenter la plupart des joueurs.
Version Amiga
Super Wonder Boy in Monster Land
| Développeur : Images Design |
| Éditeur : Activision, Inc. |
| Date de sortie : Décembre 1989 |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Anglais |
| Support : Disquette 3,5″ |
| Contrôleur : Joystick |
| Version testée : Version disquette testée sur Amiga 1200 |
| Configuration minimale : Système : Amiga 1000 – RAM : 512ko Modes graphiques supportés : OCS/ECS |

En 1989, Wonder Boy in Monster Land sera arrivé sur les ordinateurs domestiques via une distribution assurée par Activision, sous le titre Super Wonder Boy in Monster Land (bien que l’écran-titre, lui, curieusement, ait conservé le titre original). En jetant un œil à l’équipe responsable du portage sur Amiga, on peut nourrir quelques espoirs, avec notamment un certain David Whittaker (qui composerait la même année la B.O. de Shadow of the Beast) à la musique. On sent que le titre essaie de coller fidèlement à la borne, ce qu’il ne fait pas trop mal, la plupart du temps. Certes, graphiquement, on voit que la palette a été pensée pour l’Atari ST, mais la réalisation reste à la hauteur de ce qu’on pouvait trouver sur Master System. Les thèmes musicaux sont fidèles à ceux de la borne, et les bruitages sont présents sans avoir à choisir entre eux ou la musique. Côté jouabilité, la précision des sauts pâtit clairement de ne plus avoir de bouton dédié, et le fait de devoir appuyer sur espace pour ouvrir une porte n’est pas très pratique non plus. Le tout demeure cohérent, même si on sent bien que les patterns des boss ont été reproduits au jugé : selon les cas, ils seront plus difficiles ou plus faciles que sur la borne, et les collisions n’étant pas très bien gérées dans cette version, on se retrouve au final avec une conversion plutôt plus exigeante qu’une borne qui était déjà difficile. Bref, du travail honnête, mais pas de quoi donner des complexes aux versions parues sur consoles.




NOTE FINALE : 13,5/20
Avec ce Super Wonder Boy, Activision aura confié l’adaptation de la borne à une équipe sérieuse qui aura fait le travail correctement, à défaut de tirer pleinement parti des capacités de l’Amiga. Si on peut réellement s’amuser sur cette version, on regrettera une maniabilité dégradée, et surtout une difficulté générale encore plus frustrante que sur les itérations consoles.
Version Amstrad CPC
Super Wonder Boy in Monster Land
| Développeur : Images Design |
| Éditeur : Activision (UK) Limited |
| Date de sortie : Décembre 1989 |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Anglais |
| Supports : Cassette, Disquette 3″ |
| Contrôleurs : Clavier, joystick |
| Version testée : Version disquette testée sur Amstrad CPC 6128 Plus |
| Configuration minimale : Système : 464 – RAM : 64ko |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Le CPC était souvent le mal-aimé des ordinateurs 8 bits, particulièrement au sein du marché anglo-saxon, où la machine d’Amstrad passait systématiquement derrière le ZX Spectrum. Ce n’est hélas pas cette version de Super Wonder Boy qui viendra changer la donne : d’emblée, le titre affiche une réalisation en deux couleurs, et pas une de plus, directement portée depuis la machine de Sinclair. Pour ne rien arranger, la musique ne dépasse pas l’écran-titre, et la jouabilité souffre d’une inertie absolument délirante, heureusement compensée par la lenteur générale du jeu, qui rend cette version plutôt plus simple que les autres. Ce n’est certes pas le pire jeu de la ludothèque du CPC, mais on aura du mal à s’esbaudir devant cette adaptation extrêmement paresseuse. À oublier.

NOTE FINALE : 09/20
Super Wonder Boy in Monster Land sur CPC est un de ces énièmes portages fainéants bâclés à partir d’une version ZX Spectrum qui montrait déjà de sérieuses limites. C’est moche, c’est lent, mais ça reste à peu près jouable – difficile de trouver une raison objective de privilégier cette version si vous en avez une autre sous la main, cela dit.
Version Atari ST
Super Wonder Boy in Monster Land
| Développeur : Images Design |
| Éditeur : Activision, Inc. |
| Date de sortie : Décembre 1989 |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Anglais |
| Support : Disquette 3,5″ simple face |
| Contrôleur : Joystick |
| Version testée : Version disquette testée sur Atari 1040 STe |
| Configuration minimale : Système : 260 ST – RAM : 512ko Écran couleur requis |

S’il est un type de portage qui laisse encore moins de suspense que ceux publiés sur CPC, c’est bien les adaptations sur Atari ST. Prenez la version Amiga, réduisez la fenêtre de jeu, diminuez la qualité sonore, et voilà un logiciel rondement programmé (comme d’habitude, on pourra m’opposer que c’est plutôt l’Amiga qui reprend la version ST avec une meilleure musique, mais cela reste le centre du grand débat de l’époque pour savoir si c’était le ST qui tirait les jeux Amiga vers le bas ou juste les programmeurs qui étaient des feignants). Aucune surprise, donc.



NOTE FINALE : 12,5/20
Super Wonder Boy sur Atari ST n’est rien de plus que le calque de la version Amiga, avec une fenêtre de jeu plus petite et une musique de moins bonne qualité.
Version Commodore 64
Super Wonder Boy in Monster Land
| Développeur : Images Design |
| Éditeur : Activision (UK) Limited |
| Date de sortie : Décembre 1989 |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Anglais |
| Supports : Cassette, disquette 5,25″ |
| Contrôleur : Joystick |
| Version testée : Version disquette |
| Configuration minimale : RAM : 64ko |

Tom-Tom aura également fait le trajet jusque sur C64, où il livre pour l’occasion une performance mi-figue mi-raisin. Du côté de la réalisation, on ne peut pas dire que les graphismes soient époustouflants, avec notamment un héros ridicule, mais la fenêtre de jeu est relativement grande et les boss sont de belle taille. La musique ne figurera as non plus parmi les plus grands thèmes de la machine, mais elle n’en est pas moins nettement meilleure que sur Atari ST. Niveau jouabilité, le jeu fait l’essentiel, mais les masques de collision sont vraiment mauvais, ce qui peut causer pas mal de problèmes face à des boss autrement pas très dangereux. Dans l’ensemble, on sent qu’on a vraiment affaire au minimum vital et à pas grand chose de plus.
NOTE FINALE : 10/20
Super Wonder Boy sur Commodore 64 est une adaptation qui ne restera pas dans les mémoires : c’est jouable sans être fantastique, la réalisation est correcte mais sans plus, et préférer cette version à n’importe laquelle de celles parues sur consoles demandera à coup sûr une bonne dose de nostalgie ou de mauvaise foi.
Version ZX Spectrum
Super Wonder Boy in Monster Land
| Développeur : Images Design |
| Éditeur : Activision (UK) Limited |
| Date de sortie : Décembre 1989 |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Anglais |
| Support : Cassette |
| Contrôleurs : Clavier, joysticks Cursor, Kempston et Sinclair |
| Version testée : Version cassette testée sur ZX Spectrum 128k |
| Configuration minimale : RAM : 48ko |

Comme souvent, le portage sur CPC a déjà vendu la mèche et on sait à quoi s’attendre avec ce Super Wonder Boy in Monster Land (à vos souhaits !) sur ZX Spectrum. En fait, c’est même encore pire : le titre est cette fois intégralement monochrome, et la jouabilité ne s’étant pas franchement améliorée, on se retrouve avec un titre profondément médiocre, décevant même pour son support. Ajoutons qu’en plus, la version testée avait le mauvais goût de planter au bout d’une minute… bref, un portage à oublier pour tout le monde, y compris pour les mordus de l’ordinateur de Sinclair.
NOTE FINALE : 08,5/20
Le ZX Spectrum n’était déjà pas un monstre technique, alors quand en plus il est utilisé par-dessous la jambe… Ce portage médiocre de Wonder Boy in Monster Land ne devrait pas combler grand monde, et il constitue de toute façon la plus mauvaise version du jeu. À oublier.