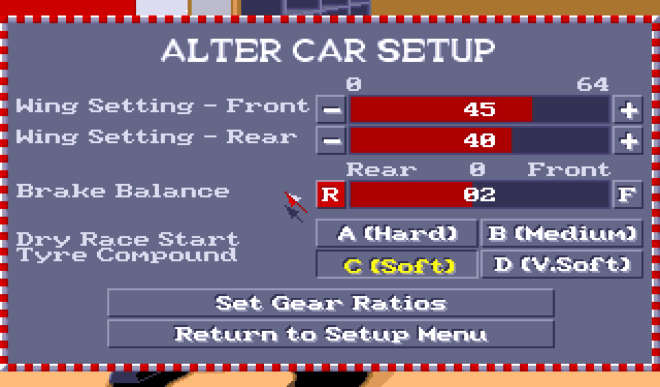Développeur : Vectordean Ltd.
Éditeur : Millenium Interactive Ltd.
Titres alternatifs : Super James Pond II (Super Nintendo), Super James Pond (Game Boy, SNES – États-Unis), James Pond II : Codename : RoboCod (écran-titre), James Pond II (Mega Drive – Japon), ジェームス ポンドII (graphie japonaise, Mega Drive), James Pond : Codename : RoboCod (DS, Game Boy Advance – Europe), スーパー・ジェームス ポンドII (Super Famicom – Japon)
Testé sur : Amiga – Atari ST – Mega Drive – Commodore 64 – Amiga CD32 – Game Boy – Game Gear – Master System – PC (DOS) – Super Nintendo
Version non testée : Acorn 32 bits
Disponible sur : DS, Game Boy Advance, PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, PSP, Switch
Présent dans la compilation : Excellent Games (1993 – Amiga, PC (DOS))
En vente sur : Nintendo.com (Switch)
La série James Pond (jusqu’à 2000) :
- James Pond : Underwater Agent (1990)
- James Pond 2 – Codename : RoboCod (1991)
- New Aquatic Games starring James Pond and the Aquabats (1992)
- James Pond 3 (1993)
Version Amiga (OCS/ECS)
| Date de sortie : Novembre 1991 (version OCS/ECS) – Août 1993 (version AGA) |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Anglais |
| Support : Disquette 3,5″ |
| Contrôleur : Joystick |
| Version testée : Version disquette testée sur Amiga 500 |
| Configuration Minimale : Version OCS/ECS : Système : Amiga 1000 – RAM : 512ko Modes graphiques supportés : OCS/ECS Système de protection de copie par consultation du manuel Version AGA : Système : Amiga 1200 – RAM : 2Mo Mode graphique supporté : AGA Installation sur disque dur supportée Système de protection de copie par consultation du manuel |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
L’affirmation ne fera sans doute pas que des heureux parmi les fans irréductibles de l’Amiga (que je salue au passage), mais au sein d’une époque phagocytée par la forme éblouissante des consoles 16 bits, il est difficile d’énumérer une longue liste de jeux de plateforme ayant vu le jour sur la machine de Commodore et pouvant être considérés comme des titres « majeurs » du genre.

Il faut dire qu’à défaut d’avoir du pétrole ou des idées, à l’époque, on avait souvent de l’opportunisme à revendre, et faute d’avoir des Super Mario Bros. ou des Sonic the Hedgehog à disposition, on n’hésitait pas à en programmer des clones pour commercialiser des Great Giana Sisters ou des Zool, et que le poste de programmeur était alors bien plus en vogue que celui de game designer. Du côté de Vectordean et surtout de Chris Sorell, qui avait programmé pratiquement à lui tout seul le sympathique mais imparfait James Pond, on n’avait peut-être pas l’ambition de révolutionner l’histoire du jeu vidéo, mais on avait déjà celle de tracer sa propre route sans chercher à adapter les grands succès de la concurrence à sa propre sauce. Une approche qui aura trouvé sa récompense avec ce qui restera comme le plus grand succès critique et commercial de l’éphémère studio, un jeu dont seul le nom, pour le coup, singe deux autres grandes sagas : James Pond 2 : Codename : RoboCod.

Stupeur ! Les jouets de Noël ont été volés par le diabolique Dr. Maybe, qui en a profité pour kidnapper au passage quelques pingouins. N’écoutant que son contrat, James Pond se lance à l’assaut du château du père Noël pour en explorer chaque atelier, dans une quête qui respire fréquemment l’hommage à Castle of Illusion. Et les pingouins ? Ah, ça, c’est juste du placement produit pour une marque de biscuits au chocolat (on se souvient que le procédé était à la mode à l’époque, de Cool Spot à Zool en passant par Push-Over), mais ce sera aussi un excellent prétexte, dans certains niveaux, pour vous envoyer tous les libérer avant de pouvoir prétendre accéder à la sortie.

À ceux qui craindraient déjà de revivre les harassantes phases de collectes du premier James Pond, rassurez-vous : le titre choisit cette fois d’alterner les phases de plateforme classiques avec des séquences de collecte, des phases de labyrinthe, des stages à défilement forcé et ainsi de suite, ce qui fait que la variété est de mise. Une variété qu’on retrouve d’ailleurs dans le déroulement du jeu, avec près d’une quarantaine de stages s’étalant sur plus de 2500 écrans ! Autre bonne nouvelle, la limite de temps est également passée à la trappe, et vous serez donc libre d’explorer le jeu à votre rythme… en prévoyant du temps pour le faire, car toute l’expédition sera à accomplir d’une traite, faute de sauvegardes ou de mots de passe. Et sachant que les passages secrets et les stages bonus sont légion, vous allez avoir de quoi vous occuper !

Mais au fait, pourquoi « Codename : RoboCod » ? En-dehors du jeu de mot facile (« cod » signifie « morue » en anglais), cela permet de doter notre agent secret d’une armure qui fera en fait davantage penser à une possession de l’Inspecteur Gadget qu’au célèbre robot-flic.

Sa fonction ? Permettre à notre poisson de s’étirer à la verticale sans aucune limite et ainsi d’aller s’accrocher aux plafonds, un très bon moyen de repenser un peu le level design et d’offrir au joueur l’opportunité d’aller mettre son nez dans des recoins qu’il n’aurait pas l’habitude de chercher à rejoindre dans les autres jeux de plateforme. Une idée à la fois simple, relativement originale et efficace, même si on ne peut s’empêcher de la considérer comme légèrement sous-exploitée par un logiciel qui reste généralement dans les clous traditionnels du genre, avec des adversaires dont on disposera en leur sautant dessus, avec des dégâts bonus en poussant le stick vers le bas, tiens, un peu comme dans… Castle of Illusion, encore une fois.

Tout cela est plaisant, mais sur le papier, ça ne fait pas nécessairement un titre apte à déplacer les foules, surtout à une ère où les jeux de plateforme pullulaient. De fait, le principal génie de ce James Pond 2 est plutôt à chercher du côté de son efficacité : on a beau avoir affaire à du classique à toutes les sauces, le tout est suffisamment bien agencé, suffisamment équilibré et suffisamment fun pour qu’on mette du temps à reposer le joystick.

On ne sent pas ici une prétention d’en mettre plein la vue à la Jim Power : la réalisation est très efficace, très colorée, mais elle reste avant tout au service d’un gameplay beaucoup plus satisfaisant que celui du premier épisode et avec lequel on ne s’ennuie pour ainsi dire jamais. Les stages sont assez courts pour ne pas lasser, le jeu assez permissif pour ne pas être frustrant, le défi assez exigeant pour ne pas être galvaudé… bref, ce RoboCod parvient à placer tous les curseurs aux bons endroits, ce qui fait de lui pratiquement un messie dans le domaine de l’europlatformer, où l’équilibrage et le level design étaient souvent les plus gros points faibles. Ici, on se laisse entraîner par la curiosité, et puis on ne décroche plus, la meilleure partie étant que chaque type de joueur devrait y trouver à peu près son compte, depuis le fouineur convulsif à la recherche de secrets jusqu’au speedrunner en passant par l’adepte de scoring. Seule exception : les amateurs de concepts révolutionnaires, qui risquent pour le coup de se retrouver attristés par l’absence quasi-totale d’idées neuves. Mais pour à peu près tous les autres, James Pond 2 constituera à n’en pas douter la garantie d’un excellent moment, particulièrement sur une machine où peu de titres du même genre peuvent prétendre se hisser à son niveau.
















Vidéo – Le premier niveau du jeu :
L’anecdote qui tue :
On sait à quel point le piratage aura causé du tort aux jeux vidéo, particulièrement sur ordinateur, au cours du siècle dernier. En revanche, on évoque moins souvent un autre facteur qui pénalisait les ventes : la grosse bourde. En effet, James Pond 2 aura fait partie de la première génération de titres à être distribués sous la forme de version démo dans les magazines – une version démo qui contenait l’intégralité du jeu, mais en ajoutant une limite pour que seul le premier « monde » soit visitable. Le problème ? Oh, un minuscule oubli : en employant le cheat-code lui aussi copieusement partagé dans les magazines et permettant d’accéder à tous les niveaux… on débloquait alors tout le contenu du jeu, y compris des niveaux absents de la version finale ! Un bon moyen pour les joueurs un peu plus rusés que la moyenne d’hériter d’un titre gratuit, et une erreur qui aura sans doute coûté quelques milliers de ventes à Millenium et à Vectordean.
NOTE FINALE : 16/20 Parfois, on n'a besoin ni d'une idée géniale, ni d'un déroulement haletant qui ne vous laisse jamais souffler, ni d'un accomplissement technique à décrocher la mâchoire : mélanger les bons ingrédients dans les bonnes proportions suffit, et qu'importe qu'on les ait déjà employés dans mille autres jeux auparavant. C'est un peu la leçon délivrée par James Pond 2 : Codename : RoboCod, plus grand succès de la saga du poisson imaginé par Vectordean – succès d'ailleurs indéniablement mérité. En dépit d'un gameplay à un bouton où le seul mécanisme vaguement original est la possibilité d'étirement de votre héros, le titre corrige toutes les erreurs du premier épisode grâce à un level design bien ficelé, une grande variété dans les stages et une ambition véritable (plus de 2500 écrans !) qui, mêlés à la chasse aux passages secrets et aux bonus, font de cette deuxième aventure la plus marquante du lot, et de loin. Ajoutez-y une réalisation irréprochable et une véritable patte dans l'univers graphique, et vous obtiendrez l'un des meilleurs représentants des europlatformers. Clairement un titre à posséder sur Amiga.
CE QUI A MAL VIEILLI : – Des masques de collision pas toujours très précis – Un système de mot de passe n'aurait vraiment pas fait de mal – Un compteur pour savoir combien de pingouins il nous reste à ramasser non plus, tant qu'à faire – Quelques « sauts de la foi » dont on aurait pu se passer – Une inertie parfois énervante
Bonus – Ce à quoi peut ressemble James Pond 2 sur un écran cathodique :

Version Amiga (AGA)
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Petite parenthèse pour évoquer la version AGA du jeu, parue pour sa part en 1993 (l’Amiga 1200 n’existait pas encore au moment de la sortie du jeu, en 1991). Comme beaucoup de développeurs de l’époque, Vectordean a dû trouver une raison de vendre son jeu, pensé pour un Amiga 500, sur la nouvelle génération de chez Commodore – la réponse évidente étant de tirer parti des 256 couleurs de l’AGA. Petit problème : comme beaucoup de développeurs de l’époque, Vectordean ne voyait aucune raison de s’amuser à redessiner des graphismes dont ils étaient déjà très contents, et « l’apport » de l’AGA se sera au final limité à quelques dégradés plus fins dans le fond, dont on ne peut même pas affirmer qu’ils soient singulièrement plus beaux que ceux de la version de base.

En fait, l’apport le plus intéressant de cette version est bel et bien à chercher du côté du contenu : comme sur certaines des versions parues entretemps, celle-ci intègre en effet de nouveaux stages en plus de ceux du titre original. Un bon moyen de gonfler encore la durée de vie d’un jeu déjà assez bien fourni en la matière, comme on l’a déjà vu. Tant qu’à faire, on bénéficie également de quelques nouveaux bruitages, comme le petit cri que pousse James lorsqu’il est touché, et le jeu ne connait plus les quelques ralentissements qu’on pouvait trouver sur Amiga 500. Si les nouveaux stages m’ont parus moins bien pensés que les autres, on se retrouve malgré tout avec une version suffisamment enrichie pour avoir de bonnes raisons de la privilégier à la première. Inutile de se priver.

NOTE FINALE : 16,5/20
Porté sur Amiga 1200, ce n’est ironiquement pas du côté de la réalisation que James Pond 2 : Codename : RoboCod profite de l’opération. Si le jeu tourne un peu mieux et profite de quelques ajouts très mineurs, le fait d’y découvrir de nouveaux stages constituera pour l’occasion la seule vraie raison de se laisser tenter par ce portage.
Version Atari ST
| Développeur : Vectordean Ltd. |
| Éditeur : Millenium Interactive Ltd. |
| Date de sortie : Novembre 1991 |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Anglais |
| Support : Disquette 3,5″ simple face |
| Contrôleur : Joystick |
| Version testée : Version disquette testée sur Atari 1040 STe |
| Configuration minimale : Système : 520 ST – RAM : 512ko Optimisé graphiquement pour le STe |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Si on pouvait encore s’interroger quant à l’avenir de l’Amiga en 1991, le grand rival de chez Atari, lui, était clairement sur une pente descendante qu’on commençait à deviner fatale. Autant dire que les joueurs d’alors ont dû être assez heureux de voir débarquer James Pond 2 sur leur machine, qui plus est dans une version qu’on ne sent pas bâclée n’importe comment. Sur le plan graphique, pour commencer, l’équipe de Vectordean a plutôt bien limité la casse.

La fenêtre de jeu a beau être (beaucoup) plus petite, la résolution plus basse (ce qui pénalise énormément l’anticipation) et les décors de fond purement supprimés, on reste malgré tout dans les clous de la version Amiga et ce n’est clairement pas de ce côté qu’on trouvera les différences les plus marquantes. La musique n’est bien évidemment pas à la hauteur de ce que permettait la puce Paula, mais elle reste très correcte – dommage, en revanche, que tous les bruitages aient disparu. Si la jouabilité n’a pas trop souffert du portage, on remarquera néanmoins un framerate bien plus erratique que sur Amiga 500 : sans être perclus de ralentissements, le jeu est clairement moins fluide, et la réactivité du personnage s’en ressent. Il arrive d’ailleurs fréquemment que le défilement ne soit plus totalement centré sur James, ce qui vient encore pénaliser une anticipation qui souffrait déjà de la réduction de la fenêtre de jeu. Dans l’ensemble, l’essentiel est préservé, mais on sent bien qu’on tient là une version clairement inférieure à l’originale malgré tout. Suffisamment pour qu’on la réserve aux nostalgiques aujourd’hui, les autres joueurs ayant tout intérêt à se diriger vers le jeu de base ou vers les versions plus tardives, plus riches en contenu.

NOTE FINALE : 13,5/20
L’Atari ST n’était pas encore mort en 1991, mais des titres comme James Pond 2 aidaient à mesurer la réelle différence entre la machine d’Atari et un Amiga bien programmé. Un peu moins beau, un peu moins fluide, un peu moins jouable, le titre reste sympathique mais n’a aujourd’hui que peu de raison d’attirer les retrogamers n’étant pas passionnés spécifiquement par l’Atari ST.
Version Mega Drive
| Développeur : Vectordean Ltd. |
| Éditeur : Electronic Arts, Inc. |
| Date de sortie : 18 août 1991 (États-Unis) – Novembre 1991 (Europe) – 9 juin 1993 (Japon) |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Anglais |
| Support : Cartouche |
| Contrôleur : Joypad |
| Version testée : Version européenne |
| Spécificités techniques : Cartouche de 4Mb |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
La Mega Drive et l’Amiga auront toujours entretenu une relation plus ou moins privilégiée qui tenait principalement à des similitudes dans une partie de leurs composants, le processeur n’étant pas le moindre. Il arrivait néanmoins fréquemment (et le premier James Pond en était un parfait exemple) que des programmeurs très à l’aise avec l’Amiga ne s’embarrassent pas à tirer le meilleur d’une console pourtant largement apte à rivaliser avec un Amiga 500 et offrent un portage inférieur alors qu’il aurait largement pu prétendre à faire mieux que la version originale.

La bonne nouvelle, c’est que ce n’est pas le cas ici : on perd certes les dégradés colorés de la version Amiga… mais ceux-ci sont souvent remplacés par des décors plus détaillés, en défilement parallaxe, et ayant la bonne idée d’être assez sombres pour ne jamais pénaliser la lisibilité du premier plan. D’accord, ce ne sont souvent que des sprites du premier plan reproduits sous forme de motif, mais ça fait le travail. En résulte une ambiance légèrement moins acidulée, mais le jeu fait également moins « vide ». Du côté sonore, la Mega Drive fait également mieux que se défendre, et les thèmes musicaux sont peut-être encore meilleurs dans ce portage que sur Amiga – les bruitages, eux, sont toujours là, avec quelques petits nouveaux. Surtout, la jouabilité est ici totalement irréprochable, bien aidée par les trois boutons de la manette et surtout par une fluidité absolument impossible à prendre en défaut, à 60 images par seconde. James répond au quart de tour, la résolution offre une fenêtre de jeu maximale, et on se retrouve avec l’une des versions les plus agréables à prendre en main. Un portage clairement supérieur à l’original, pour une fois.





NOTE FINALE : 17/20
Si James Pond 2 a gagné quelque détails en débarquant sur Mega Drive, ce sont néanmoins sa fluidité parfaite et son maniement à toute épreuve qui en font encore aujourd’hui l’une des meilleures versions du jeu. Le seul défaut est de ne pas profiter ici des stages supplémentaires des versions plus tardives, mais très honnêtement, vu la quantité de contenu déjà présente dans la version « de base », c’est à peine un handicap. Du très beau boulot.
Version Commodore 64
| Développeur : Data Design Interactive Ltd. |
| Éditeur : Millenium Interactive Ltd. |
| Date de sortie : Juillet 1992 |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Anglais |
| Support : Disquette 5,25″ |
| Contrôleur : Joystick |
| Version testée : Version disquette |
| Configuration minimale : RAM : 64ko |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Signe de l’extraordinaire popularité du Commodore 64 : en 1992, à une époque où même les systèmes 16 bits s’approchaient de leur inéluctable retraite, il continuait d’héberger des portages de jeux là où la plupart des ordinateurs 8 bits étaient déjà partis rejoindre les oubliettes de l’histoire.

L’occasion de profiter d’une version de James Pond 2 sur laquelle on portera naturellement un regard sensiblement plus critique que les joueurs de l’époque. Graphiquement, le titre fait ce qu’il peut, mais même si le tout est plutôt plus coloré que ce à quoi nous avait habitué le C64, on ne sait plus trop si on dirige une loutre ou un poisson. La musique s’en sort nettement mieux, et on a même le droit aux bruitages – prends ça, Atari ST ! Le contenu n’ayant pas été raboté, lui non plus, on aurait de quoi être satisfait si la jouabilité générale n’était pas devenue médiocre, la faute à des temps de réponse dégradés, à une inertie plus pénible que jamais, et à des masques de collision réalisés au marteau-piqueur qui font que le jeu a très peu de chance de parler aujourd’hui à qui que ce soit d’autres qu’aux fans du Commodore 64. Un beau baroud d’honneur pour la machine, mas sur le plan ludique, on ira clairement voir du côté des versions 16 bits.

NOTE FINALE : 09,5/20
Même si les joueurs du Commodore 64 ne préféraient pas trop y penser en 1992, le principal mérite de cette version de James Pond 2 est d’exister. En dépit d’un contenu préservé et d’une réalisation fonctionnelle, cette version est tout simplement trop poussive, trop lente, trop imprécise et trop moche pour présenter le moindre intérêt de nos jours face aux itérations 16 bits. À réserver aux nostalgiques.
Version Amiga CD32
| Développeur : Vectordean Ltd. |
| Éditeur : Millenium Interactive Ltd. |
| Date de sortie : Novembre 1993 (Europe) |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Anglais |
| Support : CD-ROM |
| Contrôleur : Joypad |
| Version testée : Version européenne |
| Spécificités techniques : – |
Vidéo – L’introduction et l’écran-titre du jeu :
L’Amiga CD32 aura souffert de n’être pas grand chose de plus qu’un Amiga 1200 avec un pad et un lecteur CD dont personne n’avait envie de se fouler à tirer parti alors qu’il existait un marché mille fois plus florissant pour les disquettes de l’Amiga 500. Pour Vectordean comme pour beaucoup d’autres studios, l’Amiga CD32 était surtout l’occasion de rentabiliser la version AGA via un simple portage – après tout, on parlait du même hardware.

Mais on ne pourra pas accuser l’équipe de Chris Sorell d’un excès d’opportunisme : histoire de justifier l’emploi du support CD-ROM, le jeu intègre désormais un petit dessin animé en guise d’introduction et surtout des pistes sonores de qualité numérique… en plus d’un pub pour James Pond 3, tant qu’à faire. Même si on regrettera de se coltiner le même thème en boucle tout au long d’un niveau plutôt que d’entendre les pistes changer au sein d’un même niveau (et que le nouveau thème principal donne plus dans la parodie de James Bond que dans l’ambiance enfantine du jeu original), force est de reconnaître que le jeu tourne très bien, que la jouabilité est inattaquable, et qu’on profite surtout des niveaux supplémentaires introduits par la version AGA (même si je ne suis décidément pas fans du level design de ces nouveaux stages). Bref, on a affaire ici à une version sérieuse qui peut prétendre à rivaliser avec l’intouchable version Mega Drive, voire même à la surpasser, ce qui situe immédiatement son niveau.



NOTE FINALE : 17/20
Vectordean aurait pu se contenter de porter la version AGA de James Pond 2 sur CD32, ils auront eu le mérite de tirer parti du support en ajoutant une introduction animée et des pistes CD. Si on pourra disserter du charme comparé des nouveaux thèmes et des nouveaux niveaux par rapport à la version originale, le fait est que la réalisation comme la jouabilité du titre sont inattaquables, et que ce portage mériterait d’être mieux connu. Dommage que les acheteurs aient attendu un peu plus de l’Amiga CD32, en 1993, qu’un portage d’un jeu 16 bits sorti deux ans auparavant avec quelques bonus et de la musique CD.
Version Game Boy
Super James Pond
| Développeur : Data Design Interactive Ltd. |
| Éditeur : Ocean Software Ltd. |
| Date de sortie : 16 juillet 1993 (Royaume-Uni) – 23 juillet 1993 (Espagne) – 19 août 1993 (France) |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Anglais |
| Support : Cartouche |
| Contrôleur : Console |
| Version testée : Version européenne |
| Spécificités techniques : Cartouche d’1Mb |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
En débarquant sur Game Boy, James Pond 2 aura décidé de devenir rien de moins que Super James Pond ! Une affirmation un rien prétentieuse mais qui laisse à imaginer que le jeu sera arrivé sur la portable de Nintendo avec une certaine ambition… Laquelle ne se retrouve clairement pas dans la réalisation. Le jeu est relativement moche, mais il faut reconnaître qu’il a sans doute fait le bon choix en conservant une vue aussi éloignée que possible de l’action. La fluidité n’a évidemment rien à voir avec celle des versions 16 bits, mais on reste néanmoins des kilomètres au-dessus de la version C64 dans ce domaine, avec des masque de collision beaucoup plus précis et une inertie bien moins importante.

Par contre, en termes de contenu, difficile de comprendre ce que Data Design Interactive a cherché à faire, le jeu s’ouvre sur un premier monde doté d’un unique stage qui peut littéralement être bouclé en moins de trois secondes, après quoi on enchaine avec… le premier boss ! Heu, déjà ? Suit ensuite un deuxième monde un peu plus dense mais qui ne devrait pas vous occuper plus de cinq minutes, avant de se retrouver face… au premier boss. Encore. Hé, ce serait dommage de ne pas l’affronter deux fois en dix minutes ! D’ailleurs, vous feriez bien de vous y habituer, car pendant la malheureuse demi-heure que durera le jeu, ce sera le seul boss que vous croiserez en-dehors du boss final, et à pas moins de six reprises (!!!). Autant dire que ce contenu massacré ne rend pas franchement hommage à la surabondance de stages du jeu originel, et qu’on réservera cette version à ceux n’ayant vraiment pas envie de jouer à autre chose qu’à leur Game Boy.

NOTE FINALE : 10,5/20
Confier des portages 8 bits à Data Design Interactive était décidément une assez mauvaise idée, et il y a de quoi s’interroger sur la réflexion qui aura poussé à amputer cette itération Game Boy de Super James Pond de facilement les 2/3 du contenu du jeu original, avec un premier boss qui revient pas moins de six fois pour boucher les trous ! Si le jeu est jouable et peut se montrer intéressant à l’échelle de quelques parties, il est désormais trop court, trop répétitif, pas assez lisible et franchement oubliable. À éviter.
Version Game Gear
| Développeur : Tiertex Ltd. |
| Éditeur : U.S. Gold Ltd. |
| Date de sortie : Août 1993 (États-Unis, Europe) |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Anglais |
| Support : Cartouche |
| Contrôleur : Console |
| Version testée : Version européenne |
| Spécificités techniques : Cartouche de 4Mb |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Pour cette itération Game Gear de James Pond 2, au moins une bonne nouvelle : ce n’est plus Data Design Interactive aux commandes. Mauvaise nouvelle : c’est Tiertex, pas exactement connu pour la qualité de ses portages de l’arcade, qui hérite du bébé. On lance donc la cartouche avec une certaine appréhension… laquelle s’efface un peu devant la réalisation.

Autant le dire : c’est très joli, très coloré, et franchement pas très loin de la version Amiga, mais cela a également un prix avec une vue extrêmement proche de l’action. Déjà que les « sauts de la foi » étaient assez énervants à la base, que dire d’un jeu où vous ne voyez pas à plus de deux mètres devant vous ? Si cela peut être très pénalisant pour les habitués de la version de salon, on estimera de toute façon que ce n’était pas le public visé par ce portage, qui aura donc de son côté tout le temps de s’habituer à progresser plus lentement – mais le fait est que la difficulté monte en flèche, et surtout qu’elle est fondamentalement injuste puisque vous ne pouvez jamais rien anticiper. C’est d’autant plus dommage que le jeu n’aurait normalement pas trop à rougir de la comparaison avec la version Amiga – même si on constatera que non seulement il n’intègre aucune des nouveautés de la version AGA, mais qu’il perd également quelques stages sans pour autant subit le charcutage en règle de la version Game Boy. Toujours est-il le côté die-and-retry qui ne correspond pas exactement à la philosophie originale du titre réservera ce portage à des joueurs prêts à en baver.

NOTE FINALE : 11,5/20
Ah, bon sang ce que quelques pixels peuvent changer, en termes de jouabilité… En choisissant de préserver les graphismes – d’ailleurs très réussis – au détriment de l’anticipation, la version Game Gear de James Pond 2 aura passé une sorte de pacte avec le diable. Alors oui, la réalisation est inattaquable, mais le jeu est devenu infiniment plus difficile maintenant qu’on a le nez collé sur l’action et qu’on ne voit pour ainsi dire jamais où est-ce qu’on va atterrir à chaque fois qu’on saute – un détail extrêmement pénalisant pour un jeu de plateforme ! Les joueurs les plus patients pourront s’accrocher, mais pour les autres, le constat est sans appel : restez sur les machines de salon.
Version Master System
| Développeur : Tiertex Ltd. |
| Éditeur : U.S. Gold Ltd. |
| Date de sortie : Novembre 1993 (Europe) – Novembre 1996 (Brésil) |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Anglais |
| Support : Cartouche |
| Contrôleur : Joypad |
| Version testée : Version européenne |
| Spécificités techniques : Cartouche de 4Mb |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Le plus gros problème de la version Game Gear de James Pond 2 tenant à la taille de la fenêtre de jeu, la version Master System ressemblait au moyen idéal de corriger le problème avec un minimum d’efforts. Ce qui est d’ailleurs le cas… en partie.

Niveau réalisation en tous cas, les 8 bits de la Master System font des merveilles, et le jeu serait tout prêt de pouvoir rivaliser avec la version Amiga si la vue n’était pas centrée différemment, un peu plus rapprochée, et la résolution moins large que sur Mega Drive – ce qui n’empêche pas ce portage de faire plutôt mieux que la version Atari ST dans le domaine. Les décors restent très agréables quoiqu’un peu vides, et les masques de collision connaissent les mêmes errements que sur la version de base, mais ce n’est pas trop grave. Ce qui l’est davantage, en revanche, c’est que cette version intègre les coupes de la version Game Gear, avec un premier monde très court (deux stages maximum) et facilement vingt à trente minutes de jeu en moins au total. Difficile de croire qu’une cartouche Master System ne pouvait pas intégrer du contenu qui tenait sur une unique disquette 3,5 pouces, mais le fait est que cette version est sensiblement plus courte que les itérations 16 bits. Dommage, car pour le reste, elle était difficile à prendre en défaut.

NOTE FINALE : 14/20
Techniquement, la version Master System de James Pond 2 accomplit pratiquement un sans-faute. La jouabilité étant elle aussi à la hauteur de la version Amiga, on ne peut que regretter que le contenu, lui, se soit vu amputer de nombreux stages alors que ce n’était clairement pas une nécessité. Un bon jeu, mais préférez-lui les versions 16 bits.
Version PC (DOS)
| Développeur : Intellectual Software Consultants Limited |
| Éditeur : Millenium Interactive Ltd. |
| Date de sortie : Juillet 1993 |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Anglais |
| Supports : Disquettes 5,25″ et 3,5″ |
| Contrôleurs : Clavier, joystick |
| Version testée : Version disquette émulée sous DOSBox |
| Configuration minimale : Processeur : Intel 80286 – OS : PC/MS-DOS 3.1 – RAM : 640ko Mode graphique supporté : VGA Cartes sonores supportées : AdLib, Sound Blaster |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Soyons honnête : le PC avait beau être devenu, en 1993, un système plus populaire, plus puissant et plus compétitif qu’il ne l’était trois ans plus tôt, ce n’était clairement pas la machine qu’on associait en premier aux jeux de plateforme, sauf à avoir découvert le genre avec des Commander Keen plutôt qu’avec des Super Mario Bros. On pourra donc être surpris de voir James Pond 2 débarquer sur la machine d’IBM, mais hé, après tout, une chose était certaine : les PC de l’époque étaient plus que capables de faire tourner des programmes conçus sur Amiga.

Comme avec d’autres adaptations de l’époque également venues de l’Amiga, on sent immédiatement une certaine fainéantise : aucun programme de configuration, et une gestion sonore limitée à l’AdLib et à la Sound Blaster – autant dire le minimum vital à une époque où les deux cartes sonores étaient des modèles largement dépassés. Fort heureusement, le rendu est au moins à la hauteur de ce qui pouvait être entendu sur Amiga. Autre conséquence plus dommageable de l’absence de configuration : je ne serai tout simplement jamais parvenu à trouver le moyen de jouer avec un joystick ! Ce qui est d’autant plus dommage que le jeu est graphiquement très réussi, reprenant le déroulement de la version AGA avec des teintes un poil plus colorées et des décors un peu plus psychédéliques. Le titre était assez gourmand pour l’époque, fort heureusement ça ne devrait pas représenter une difficulté aujourd’hui, mais n’espérez pas pour autant le voir tourner à 60 images par secondes comme sur Mega Drive. Dans tous les cas et vu la rareté des représentants du genre sur PC, on ne sera pas trop méchant avec celui-ci, qui n’a clairement pas à rougir de la comparaison avec la version AGA.




NOTE FINALE : 16,5/20
Le PC n’aura jamais été le système de prédilection des jeux de plateforme, mais James Pond 2 aura au moins eu le mérite d’y débarquer sans offrir de perte de qualité par rapport à la version Amiga 1200. Ça aurait pu être un peu plus fluide, les motifs de fond auraient pu être un peu plus travaillés, la configuration aurait pu être plus intuitive, mais dans tous les cas cela reste une conversion fidèle et c’est sans doute ce qu’on pouvait espérer de mieux.
Version Super Nintendo
Super James Pond II
| Développeur : Vectordean Ltd. |
| Éditeur : Ocean Software Ltd. |
| Date de sortie : Juillet 1993 (États-Unis) – Octobre 1993 (Europe) |
| Nombre de joueurs : 1 |
| Langue : Anglais |
| Support : Cartouche |
| Contrôleur : Joypad |
| Version testée : Version européenne |
| Spécificités techniques : Cartouche de 4Mb (États-Unis, Europe) ou de 8Mb (Japon) |
Vidéo – L’écran-titre du jeu :
Parmi la deuxième fournée d’adaptations de James Pond 2, la Super Nintendo aura vu la sienne arriver précédée d’un pompeux « Super » qui ne présage en tout cas pas du contenu du titre, les stages de la version AGA n’ayant pas voyagé jusqu’à cette version.

En termes de réalisation, en tous cas, on tient à n’en pas douter une des plus belles versions du jeu : c’est coloré, c’est détaillé, c’est lisible, et même si la résolution est plus faible que sur Mega Drive, la console de Nintendo pourrait sans doute prétendre remporter cette bataille… si elle n’avait pas à souffrir de nombreux ralentissements. On a donc affaire ici à deux écoles très différentes entre l’extrême fluidité et la jouabilité inattaquable de la version Mega Drive et la réalisation légèrement supérieure de la Super Nintendo. Niveau sonore, c’est également du très haut niveau. Très honnêtement, les deux se valent et on prend immédiatement du plaisir à s’essayer à n’importe laquelle des deux, mais les fans irréductibles de chaque machine auront chacun des arguments à verser à leur crédit. Dans tous les cas, les deux consoles reines de l’ère 16 bits se livrent un nouveau combat au sommet, et c’est plutôt le joueur qui en ressort gagnant. Une très bonne nouvelle.








NOTE FINALE : 17/20
Nouvelle bonne surprise avec ce Super James Pond II sur Super Nintendo, qui accomplit une prestation remarquable en dépit de quelques petits soucis de ralentissements. Dommage également que le contenu ne profite pas des ajouts aperçus sur Amiga 1200 ou sur PC.